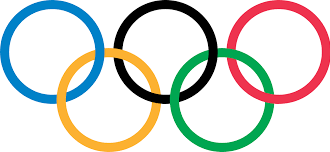Les beaux discours
En 1989, j’étais directrice d’une firme de recrutement et de placement de personnel. Dans le cadre de mes fonctions, je devais régulièrement faire des présentations sur nos services à des gestionnaires en ressources humaines, dans diverses entreprises. Un jour, alors que j’accompagnais une de mes collègues pour rencontrer un client potentiel, elle se mit à me parler des clubs Toastmasters et m’encouragea vivement à me joindre à l’un d’eux.
Une parenthèse ici : comme plusieurs d’entre vous, je croyais que Toastmasters était simplement une marque de grille-pain et autres petits appareils électroménagers. Détrompez-vous! Elle faisait référence à l’organisation Toastmasters International, qui offre un programme de formation pratique sur le leadership et la parole en public.
Le mouvement Toastmasters a démarré en Californie dans les années 1920, grâce à un certain Docteur Ralph Smedley. Ainsi donc, en pleine prohibition, des hommes exerçant diverses professions avaient pris l’habitude de se réunir secrètement, afin de trinquer et discuter entre eux. Or, le docteur Smedley s’aperçut rapidement que non seulement ses amis ne maîtrisaient pas l’art de porter un toast, mais ils manquaient également d’éloquence pour faire valoir leurs points de vue de façon succincte. Par conséquent, il rédigea une série de règles pour mieux structurer leurs rencontres et enseigner les bases d’une prise de parole efficace. Ainsi, ses collègues apprirent à mieux s’exprimer et devinrent des maîtres du toast. Un premier club Toastmasters venait de naître.
Le mouvement a pris de l’ampleur, des clubs se formèrent un peu partout, et le programme du Docteur Smedley se peaufina au fil des ans. Aujourd’hui, il existe des milliers de clubs Toastmasters partout à travers le monde, grâce auxquels des hommes et des femmes de divers milieux apprennent à mieux communiquer devant un auditoire.
Fin de la parenthèse.
Ma collègue Antoinette était membre du club Toastmasters de Saint-Eustache. Elle m’invita à participer à une rencontre à titre d’invitée. Curieuse, j’acceptai.
J’ai été séduite par la formule. Lors des rencontres hebdomadaires, des membres se portaient volontaires pour livrer un discours préparé d’une durée maximale de sept à dix minutes, ce qui leur permettait de développer divers aspects de l’art oratoire : la structure, l’argumentation, l’humour, la voix, les gestes. Des collègues plus expérimentés donnaient une rétroaction immédiate sur leur performance et des conseils pour qu’ils puissent s’améliorer. Pendant la période des improvisations, les membres développaient leur habilité à parler de façon impromptue sur un sujet donné. Tous les participants avaient une tâche assignée pendant la réunion, ce qui leur donnait l’opportunité de prendre la parole à chaque rencontre.
L’atmosphère était conviviale et captivante, surtout parce qu’autour de la table, on retrouvait des gens de tous âges et de divers milieux : avocats, ingénieurs, politiciens, gens d’affaires, représentants des ventes, artistes, enseignants… Les sujets abordés dans les discours étaient donc variés et intéressants.
Je suis devenue membre.
C’est ainsi que chaque semaine, j’ai participé aux rencontres, j’ai appris, pratiqué et j’ai perfectionné ma façon de m’adresser à un auditoire, de communiquer mes opinions et de donner des rétroactions avec tact et empathie, des atouts qui allaient me servir pendant tout mon cheminement professionnel.
J’étais la plus jeune du club de Saint-Eustache. Il y avait deux de mes collègues dans la trentaine, mais sinon, tous les autres avaient au moins passé le cap de la quarantaine. Je revenais de chaque rencontre galvanisée. J’apprenais à canaliser cette poussée d’adrénaline qu’on ressent avant une prestation. Après chaque réunion, je lisais toutes les rétroactions que j’avais reçues sur mes performances et j’essayais de mettre en application les conseils qu’on me donnait. Pendant la semaine qui suivait, j’élaborais avec soin mes discours, en choisissant des sujets pertinents et m’assurant que je rencontrais les objectifs fixés. Je pratiquais leur livraison en les répétant à voix haute, devant un miroir.
Un certain mois d’octobre, un jeune homme dans la vingtaine, membre d’un autre club Toastmasters à Montréal, vint participer à l’une de nos rencontres, à titre d’invité. Dynamique, pince sans rire, il s’exprimait très bien. Il faut dire qu’il avait déjà plusieurs années d’expérience dans le mouvement. À la grande surprise de tous, à la fin de la rencontre, il annonça son intention de devenir membre du club de Saint-Eustache.
Au fil des semaines, nous avons appris à le connaître. Ses discours traitaient de sujets percutants, ils étaient bien préparés et souvent teintés d’une note humoristique. Ses évaluations étaient justes et encourageantes. Son enthousiasme, lorsqu’il prenait la parole, était contagieux.
Lors d’une session d’improvisation, on lui donna le sujet suivant :
« On vous annonce la fin du monde, mais vous serez épargné en allant sur une île déserte. Vous pouvez amener seulement deux personnes avec vous. Qui amenez-vous et pourquoi? »
Pris au dépourvu par le sujet, ne voulant pas paraître trop macho (du moins, c’est l’excuse qu’il a donnée!), il a répondu qu’il amènerait son père et son meilleur ami. Son évaluateur ne s’est pas gêné pour le taquiner et lui faire remarquer que grâce à lui, ce serait la fin de l’espèce humaine. Tout le monde a bien ri.
Mais c’est à la suite de cette performance que ma collègue Antoinette a appris qu’il était célibataire…
Elle avait décidé de jouer à l’entremetteuse. Le lendemain de chaque rencontre, au travail, elle me parlait de lui, avec des sous-entendus à peine voilés :
« Il donne vraiment de beaux discours, n’est-ce pas ? »
Et il semble qu’à mon insu, elle lui a laissé savoir que j’étais aussi célibataire, et elle lui a même donné quelques encouragements. Ciel! Je n’étais pas dans un club Toastmasters pour draguer!
J’ai fait partie du mouvement Toastmasters jusqu’en 1995 et au fil des ans, je me suis impliquée à divers niveaux : j’ai élaboré des projets de discours avancés, j’ai participé à des concours oratoires, donné des ateliers de formation, suis devenue présidente de mon club, ai fait partie du conseil d’administration du district, ai fait du mentorat, parrainé de nouveaux clubs.
Aujourd’hui, je peux affirmer que l’expérience Toastmasters a marqué ma vie de bien des façons. D’abord, ma vie professionnelle a pris un tournant inattendu. Dans les années 1990, j’ai été embauchée par la compagnie Fred Pryor pour donner des séminaires sur le leadership, le service à la clientèle et la gestion du temps, devant des auditoires de plus de 100 personnes, un peu partout au Québec. Puis j’ai donné des formations en bureautique dans des entreprises du Québec, de l'Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Évidemment, les techniques d’art oratoire que j’ai apprises m’ont été utiles tout au long de ma carrière en éducation, que ce soit en tant qu’enseignante ou gestionnaire. Elles m’ont même aidé à gérer mon stress lors de mes prestations en chant choral!
Mais Toastmasters a aussi mis sur ma route mon partenaire de vie. Car oui, c’est au club de Saint-Eustache, grâce aux manigances de ma collègue, que mon histoire avec Chéri a commencé, et elle dure toujours.
Que voulez-vous… Encore aujourd’hui, il sait me faire de très beaux discours!
Le grand départ
À la session d'orientation à Montréal. Prêts pour le départ. Je suis dans la 3e rangée (debout), cinquième à partir de la gauche.
Je venais d’avoir seize ans et je vivais un grand moment d’incertitude, voire d’angoisse. Dans quelques mois, j’obtiendrais mon diplôme d’études secondaires et je m’interrogeais sur la suite de mon parcours scolaire.
Comme toutes mes collègues, j’avais rencontré la conseillère d’orientation. Un rendez-vous de moins de trente minutes, qui devait m’aider à choisir un parcours, un métier, un avenir…
Puisque j’avais horreur des mathématiques et des sciences, j’allais m’inscrire au cégep en sciences humaines, sans maths. Pour faire quoi ensuite ? Mystère ! J’étais tentée par l’enseignement, mais la conseillère m’avait dit que les chances d’employabilité dans ce domaine étaient très minces et m’avait fortement encouragée à penser à un plan B.
Ce qu’elle ne savait pas, c’est que pour moi, le cégep était un plan B. Je caressais un autre projet : j’avais posé ma candidature pour participer à AFS, un programme d’échanges étudiants à l’international. Je désirais ardemment partir à l’étranger pendant un an pour vivre une aventure hors du commun, et ainsi repousser l’échéancier du choix de carrière.
Fondé il y a plusieurs décennies, AFS Interculture (American Field Service) est un organisme offrant des programmes d’échanges conçus pour des étudiants âgés de 15 à 18 ans. En fait, l’origine d’AFS remonte à la première guerre mondiale. Des étudiants américains, coincés en Europe en raison du conflit, organisèrent un service de transport des blessés sur les champs de bataille. Ces jeunes bénévoles constatèrent rapidement que la souffrance n’avait pas de nationalité. Le même service fut organisé pendant la deuxième guerre, et c’est quelques années plus tard, soit en 1948, qu’AFS élabora le concept de l’accueil d’étudiants étrangers dans des familles. Le programme d’échanges avait pour but de permettre à des jeunes et des communautés d’accueil de se familiariser avec d’autres cultures, et ainsi favoriser la paix mondiale.
J’avais posé ma candidature à l’automne précédent. Après avoir rempli maints formulaires, joint les lettres de recommandation, passé une entrevue... il ne me restait plus qu’à attendre. En décembre, AFS m’avait appelée pour m’offrir de partir en Amérique latine dès le mois de février. J’y ai sérieusement songé, d’autant plus que j’avais étudié l’espagnol pendant deux ans, mais mes parents tiquaient à cette idée : ils évoquèrent le climat politique instable dans certains de ces pays, le fait que je n’aurais pas obtenu mon diplôme, que je partirais et reviendrais, en février, au beau milieu d’une année scolaire… Finalement, j’ai renoncé et j’ai décidé d’attendre pour un départ en août.
Juin est arrivé. La fin de l’année et la graduation m’entraînèrent dans un tourbillon d’émotions. J’étais admise au cégep, mais je n’avais eu encore aucune nouvelle d’AFS. À ce point, je m’étais pratiquement résignée au fait que je prendrais la route du collégial. Après mes examens du Ministère, ayant été choisie pour représenter le Québec au Forum pour jeunes canadiens, je suis partie pendant une semaine à Ottawa, oubliant tout le reste.
À mon retour, mes parents m’annoncèrent que je devais rapidement faire les démarches pour obtenir mon passeport. Ils avaient reçu un appel pendant mon absence : j’étais admise au programme AFS États-Unis. Mon départ était prévu pour le 3 août.
Je ne savais pas encore quelle serait ma destination finale, car pour l’apprendre, je devais recevoir le dossier de la famille qui allait m’adopter pendant un an. Vivait-elle en Oklahoma, en Alaska, à Hawaï ou au Vermont ? Or, il y avait un petit problème : le service postal canadien était en grève. Il faut se rappeler qu’en 1981, il n’y avait pas de communication par fax et encore moins par Internet. La poste demeurait le seul moyen d’expédier des documents. À quelques semaines de mon départ, je n’avais pas la moindre idée d’où j’allais passer la prochaine année, ni avec quelle famille. Devais-je apporter manteaux et gilets ? Je me suis mise à étudier minutieusement la carte des États-Unis. Pour ajouter un peu de piquant au suspense, parents et amis se sont mis à parier sur ma destination. Moi, sans raison particulière, j’étais persuadée que j’atterrirais au Michigan…
Le siège social d’AFS à New York a finalement expédié les dossiers des familles d’accueil par service de messagerie au bureau de Montréal. C’est ainsi que par un bel après-midi de juillet, j’ai reçu un appel : je devais passer sur la rue Sherbrooke pour aller chercher toutes les informations sur ma famille et mon école. Dans l’énervement, je n’ai rien demandé au téléphone, j’ai raccroché et j’ai couru annoncer la nouvelle à mes parents. Nous avons sauté dans l'auto et avons fait la route de Fabreville jusqu’au bureau d’AFS. Quand je suis arrivée, Richard Fitzgerald, le président, m’accueillit avec un grand sourire.
«Ah, c’est toi la grande chanceuse qui s’en va à Santa Barbara, en Californie !»
Je me rappelle d’avoir vu, dans un éclair, la carte des États-Unis que j’avais tant regardée, et l’endroit précis où se trouvait Santa Barbara.
J’allais laisser mes manteaux et mes gros gilets au Québec!
De retour chez moi, j’ai consulté en détail le dossier de ma famille : les Uphoff, Bob et Inge, avaient deux filles, Karin de deux ans mon aînée et Denine, qui avait mon âge. J’irais au San Marcos High School, en 12e année.
J’eus à peine deux semaines pour me préparer au grand départ. Le 3 août 1981, je fis de brefs adieux à ma famille et je suis partie avec mes deux valises et ma guitare, insouciante, comme si je partais pour une fin de semaine à la campagne. À ce moment, je n’étais pas encore consciente de ce que j’allais vivre. J’étais trop excitée, transportée dans une bulle de rêve.
Avec tous les participants AFS du Québec, je devais d’abord participer à une session d’orientation de deux jours à Montréal. Nous étions une quarantaine de jeunes, réunis dans un centre afin qu’on nous prépare à notre expérience à l’étranger. Mais la session fut écourtée et dès le lendemain, les étudiants à destination des États-Unis montèrent dans un autobus pour se rendre au campus de l’université CW Post à Long Island pour une autre orientation, celle-là organisée par notre pays d’accueil.
Le magnifique campus fourmillait d’étudiants AFS de partout dans le monde. Nous avons bien ri quand on nous a emmenés à notre dortoir pour nous attribuer nos chambres. Pour les américains, le premier prénom est le prénom usuel. Ainsi, pour eux, toutes les filles du Québec s’appelaient Marie et tous les garçons, Joseph. Ils devaient trouver que nos parents manquaient d’originalité ! Par conséquent, sur la porte de ma chambre, on avait inscrit Marie Brunette.
À l’heure des repas, dans la cafétéria, on retrouvait des centaines d'étudiants tenant des conversations en langues diverses et pour la première fois, je me suis sentie dépaysée. Cependant, malgré nos différences, nous avions quelque chose en commun : nous allions tous vivre l’expérience AFS pendant une année, quelque part aux États-Unis.
À la fin de la première journée, les étudiants de chaque pays représenté étaient invités à donner un spectacle sur un grand terrain extérieur. Je me rappelle que certains avaient revêtu leur costume national et avaient présenté des danses folkloriques.
Après le spectacle, alors que la nuit tombait, nous nous étions tous réunis pour entonner des airs des Beatles. C’était la plus belle des chorales internationales.
Si mon orientation à New York devait durer près de cinq jours, elle prit fin après moins de 48 heures. Le 6 août, je montai dans un autobus en direction de l’aéroport JFK de New York et je pris un avion pour Los Angeles.
Hélas, ma famille d’accueil ne m’attendait pas avant la mi-août et le comité AFS de Santa Barbara n’avait pas eu l’information à l’effet que mon arrivée serait devancée d’au moins une semaine. Ainsi, à l’aéroport de Los Angeles, tous les étudiants AFS furent accueillis par leur famille… sauf moi. Deux jeunes gens, un garçon et une fille à peine plus âgés que moi, tenaient une affiche sur laquelle était inscrit «Marie Brunette». Après l’expérience du campus du CW Post, je me doutais qu’il s’agissait de moi. Je me suis dirigée vers eux.
«Es-tu Marie ?»
-«Oui, mais non. Mon nom est véritablement Elaine Brunette. »
-«Oh désolée, Elaine. » dit le jeune homme. «Je me nomme Tom. Et voici Elaine», ajouta-t-il en pointant sa collègue. «Comme toi, elle s’appelle aussi Elaine».
Ils m’expliquèrent que ma famille n’était pas arrivée, mais qu’ils essaieraient de la joindre. En attendant, ils s’occuperaient de moi.
Je suppose que j’aurais dû être inquiète à ce point. J’étais fatiguée, à plus de 3000 km de chez moi, avec de purs inconnus. Mais étonnamment, je me sentais en confiance. Les deux jeunes gens étaient sympathiques et rassurants.
D’un téléphone public, ils joignirent mon «père» adoptif vers 21h30 et lorsqu’on lui annonça que je l’attendais à Los Angeles, il fut complètement abasourdi. Finalement, Santa Barbara se situant à deux heures de route, il fut convenu que je passerais la nuit chez ma nouvelle amie, Elaine Merchant, à Manhattan Beach et que ma famille viendrait me chercher le lendemain, vers l’heure du diner.
En sortant de l’aéroport, je me rappelle avoir été impressionnée à la vue des palmiers. C’était la première fois que j’en voyais.
Ma nouvelle amie et moi avons discuté jusqu’aux petites heures de la nuit, puis elle m’installa dans sa chambre et je dormis comme un loir. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux, elle m’amena à la plage et j’eus mon premier coup d’oeil sur le Pacifique.
Bob, que j’allais appeler «Dad», et Karin, ma «sœur» aînée, arrivèrent, comme prévu, peu après midi. Je fis mes adieux à mon amie Elaine après l’avoir remerciée à profusion, et je montai à bord de l’Oldsmobile bleue de Dad pour me rendre à ma destination finale, Santa Barbara.
Au lieu de prendre l’autoroute 101 qui passait dans les terres, Dad emprunta la route 1 longeant l’océan. C’était une journée magnifique. J’admirais le soleil qui faisait miroiter la mer, les falaises qui bordaient la route, la végétation luxuriante. J’ai traversé pour la première fois des endroits mythiques comme Santa Monica et Malibu. J’étais épatée de croiser Sunset boulevard et de voir des «Chips», ces policiers en moto, comme si je m’attendais à ce que l’un d’eux soit l’agent Poncherello. En bonne groupie, je me suis exclamée quand j’ai vu une affiche annonçant la route pour Ojai, la ville où demeurait Jamie Sommers, la femme bionique. À chacune de mes réactions, je sentais l’amusement de Karin et Dad.
À New York, les étudiants suédois en costumes traditionnels nous présentent leur numéro, une danse folklorique.
Ma nouvelle amie, Elaine Merchant, qui m'a hébergée chez elle, à Manhattan Beach, un quartier de Los Angeles.
Pendant le trajet, j’ai dû me pincer une vingtaine de fois : j’étais en Californie ! Mon arrivée avait été devancée d’une bonne semaine et j’avais déjà dû palier à plusieurs imprévus, mais c’était le début d’une belle aventure. J’allais passer les douze prochains mois dans ce paradis. J’étais prête… et ravie.
Les deux côtés du mur
1984, devant la porte de Brandebourg avec mes deux soeurs de Californie. Je suis à gauche. Derrière, une affiche dit : Attention, vous quittez Berlin-Ouest.
À l’été 1984, j’ai parcouru l’Europe avec mes deux «sœurs» californiennes. Nous avions planifié notre itinéraire en fonction des gens que nous connaissions là-bas, parce que nous avions envie de les voir, bien sûr, mais aussi parce qu’ils nous offraient l’hébergement gratuit, un détail non négligeable pour des étudiantes de vingt ans. Avec, pour tout bagage, un sac à dos, mon EurailPass, et un maigre budget de 40 dollars par jour, je suis partie à l’aventure.
En Allemagne, nous avons décidé de faire un saut à Berlin afin de visiter mon ami Lars. Un grand sportif aux cheveux blonds presque blancs, il avait étudié au même high school que moi dans le cadre d’un échange étudiant en Californie, et lorsque je lui avais annoncé que nous séjournerions en Europe, il avait insisté pour que nous allions passer quelques jours chez lui.
Il faut se rappeler qu’à l’époque, l’Allemagne était encore divisée. Nous partions de Hambourg, dans la partie ouest, pour nous rendre à Berlin située en plein cœur de la République démocratique allemande.
Dans les années 1980, donc avant même la création de l’Union européenne, traverser les frontières des pays de l’Europe de l’ouest était généralement un jeu d’enfant… À bord du train, c’est à peine si le contrôleur regardait notre passeport. Pour cette raison, j’ai été passablement saisie quand le train s’est arrêté à la frontière de l’Allemagne de l’est, notre dernier arrêt avant Berlin. Les toilettes ont été verrouillées. On ne voulait surtout pas que quelqu’un puisse s’y cacher ! Tous les passagers dont la destination finale n’était pas Berlin-Ouest devaient obligatoirement descendre du train. Par la fenêtre, nous pouvions apercevoir des soldats déambuler sur le quai de la gare, mitraillette à la main, chiens de garde en laisse. Chaleureux comme accueil… Bienvenue en République démocratique allemande !
Deux hommes en uniforme à l’air sévère montèrent à bord de notre wagon. Pendant qu’un d’eux inspectait chaque compartiment, l’autre interrogeait les passagers. Arrivé à nous, il nous demanda sèchement, en allemand, notre nom, notre pays d’origine, notre profession, et la raison de notre voyage. Puis il a pris nos passeports pour en étudier minutieusement chaque page, inspectant les étampes des divers pays que nous avions visités. Il porta ensuite une attention particulière à notre photo, puis nous dévisagea longuement. J’ai ressenti une drôle d’émotion s’emparer de moi, quelque chose que je n’avais jamais expérimenté auparavant : un mélange de peur, d’indignation, d’impatience… Tout ce cirque pour simplement avoir le droit de traverser leur territoire ? Enfin, une fois leur inspection terminée, les hommes sont descendus, les toilettes ont été déverrouillées, l'atmosphère s'est détendu, et le train a pu repartir et filer jusqu’à notre destination.
Berlin-Ouest me fit bonne impression. C’était une ville agréable, en pleine effervescence, avec ses néons, son architecture moderne qui s’accordait avec les monuments historiques, ses magnifiques parcs, ses balcons fleuris, ses grandes avenues. Nous avons fait les boutiques du Kurfürstendamm, avons flâné au Tiergarten, bu de la bière sur les terrasses, visité les musées. Nous avions la chance d’avoir un guide exceptionnel en la personne du père de mon ami Lars, un vrai berlinois qui était né juste avant la dernière grande guerre. Il en savait donc beaucoup sur sa ville qui avait prospéré pour ensuite être détruite par les bombes, assaillie par les soldats soviétiques, et enfin divisée en secteurs occupés par les pays vainqueurs.
Bien sûr, il nous a parlé de l’impact de vivre dans une ville emmurée. Omniprésent, on ne pouvait manquer de le voir, ce symbole honteux qu’était le mur. Faisant environ dix pieds de haut, il frôlait des édifices, scindait des rues, délimitant de sa laideur le territoire est-allemand. Du côté ouest, il avait été recouvert de graffitis, comme si on avait tenté de lui donner un sens. Par endroits, on pouvait grimper sur des plateformes pour observer de l’autre côté. Et c’est ainsi qu’on comprenait que le mur, c'était bien plus que des hautes dalles de béton.
Du côté est, on pouvait voir de vastes terrains déserts qu’on croyait minés, des clôtures dotées de dispositifs d’alarme, un large corridor de barbelés, une route éclairée sur laquelle circulaient régulièrement des soldats armés et des chiens. C’était sans compter les miradors aux 500 mètres, où étaient postées des sentinelles qui, avec leurs jumelles, épiaient chaque mouvement suspect… incluant ceux des touristes de l’ouest qui les regardaient à partir des plateformes!
La porte de Brandebourg, autrefois le centre de la ville et un lieu de rendez-vous privilégié par les berlinois, avait été cédée à la RDA. On pouvait l’apercevoir derrière une clôture placardée d’affiches qui nous prévenaient de ne pas la franchir… De toute façon, de voir les soldats armés qui faisaient les cent pas au pied de la porte ne nous incitait guère à défier les avertissements.
Lars nous a expliqué qu’il y avait des tours guidés qui permettaient aux touristes de passer à Berlin-Est pour la visiter. Après réflexion, nous avons décidé de tenter l’expérience. Moyennant quelques Marks, nous avons obtenu un visa d’un jour et nous sommes montées à bord d’un autobus avec d’autres braves touristes. Direction Checkpoint Charlie.
Ce poste frontière de la Friedrichstrasse était réservé aux étrangers qui désiraient traverser le mur. Du côté ouest, on ne passait que devant une simple guérite, alors que du côté est, notre autobus devait circuler dans un labyrinthe de voies encadrées par des barbelés, des tours, des gardes armées et de nombreux postes de contrôle. Des hommes montèrent dans l’autobus et encore une fois, nous avons dû nous soumettre à un bref interrogatoire, présenter visa et passeport, pendant qu’à l’extérieur, des soldats nous observaient. Par trois fois, on nous prévint qu’il était absolument interdit de photographier quoique ce soit. Inutile de prendre de risques : je gardai ma caméra sagement rangée.
Une fois officiellement passé à l’est, notre autobus s’est arrêté pour que notre guide, Klaus, monte nous rejoindre. Notre visite commençait enfin.
J’ai dû me pincer, abasourdie. C’était comme si, en franchissant le mur, j’avais reculé dans le temps ! On se croyait dans un mauvais film tourné à la fin de la guerre. La ville s'étalait en tons de beige et gris. Certains édifices tombaient en décrépitude, alors que les plus récents se dressaient en blocs sans style et sans âme. Alors que dans l’Ouest circulaient de rutilantes Mercedes, Audi, BMW et Porsche, à Berlin-Est, on ne voyait que des Lada, principalement blanches.
Klaus, nul doute bien formé pour son rôle de guide, nous parlait de sa ville comme si c’était le paradis. On ne pouvait pas l'en blâmer. Puisqu’il n’avait pas encore trente ans, il n’avait probablement jamais connu de réalité autre que celle de la RDA. Comment aurait-il pu comparer? Il n’y avait pas encore d’internet, et il n’avait probablement jamais eu le droit de visiter l’Ouest. Il nous vanta l’efficacité des transports en commun qui ne coûtaient pratiquement rien, nous montra des appartements très accessibles et abordables. Il nous parla longuement qu’en dépit du fait que les avortements et la contraception pour les femmes étaient libres et gratuits, le taux de natalité demeurait exceptionnel. En prime, il n’y avait pas de chômage et ni de décrochage scolaire à Berlin-Est. Un monde idéal, je vous le dis ! C’était à se demander pourquoi autant de berlinois avaient risqué de franchir le mur pour traverser à l’ouest ! Quand nous passions près de files de gens attendant pour entrer dans une boutique ou devant un édifice en ruines, Klaus attirait notre attention sur un banal monument ou une église dans la direction opposée. Il évitait habilement de répondre à nos questions en nous récitant des phrases toutes faites, ayant une saveur de propagande. C’était à la fois frustrant et fascinant.
Pendant notre tour guidé, nous avons eu droit à un seul arrêt : nous sommes descendus quelques minutes au parc Treptower où se trouve un mémorial soviétique érigé en souvenir des valeureux soldats morts pendant la deuxième grande guerre. On nous a fait admirer la statue représentant la mère patrie – l’Union soviétique – pleurant ses enfants. Puis, Klaus a offert de nous emmener à une boutique de souvenirs réservée aux touristes, mais personne n’en a manifesté l’intérêt. Et bien sûr, il était hors de question d’aller flâner par nous-mêmes dans les rues de la ville. De toute façon, nous en avions assez. Pour ma part, je me sentais à la fois inconfortable et agacée et j’avais hâte de retourner à l’ouest.
À Checkpoint Charlie, l’expérience fut un peu plus énervante au retour. Avant de quitter la partie Est, il a fallu se soumettre à une nouvelle vérification des papiers officiels, évidemment. Puis, des soldats avec des chiens renifleurs fouillèrent tous les recoins de notre autobus : chaque banc, les compartiments à bagages et même le dessous de l’engin à l’aide de miroirs. Et si un est-berlinois avait eu la mauvaise idée de se cacher quelque part ? Je n’osais même pas penser au sort qu’on lui aurait réservé.
C’est avec soulagement que j’ai retrouvé Berlin-Ouest.
Jusqu’à ce que je vive cette escapade de l’autre côté du mur de Berlin, j’avais toujours eu le sentiment que je pouvais penser et agir, sans contrainte. Mais ce jour-là, j’ai compris qu’il faut parfois être privé de quelque chose pour en saisir toute l’importance qu’on lui accorde.
Je suis partie de Berlin avec la conviction que le mur serait là pour rester et qu’il diviserait la ville à tout jamais. L’histoire m’a donné tort. C’est avec incrédulité et espoir que je l’ai vu s’écrouler en 1989. Ce jour-là, j’ai eu une pensée pour mon ami Lars, pour son père surtout, et je me suis réjouie de voir les berlinois enfin réunis.
En 2011, je suis retournée à Berlin et j’ai été éblouie par la capitale allemande. On ne pouvait plus distinguer les
parties Est et Ouest. Tout était reconstruit, moderne, embelli et unifié.
Du mur, il ne reste que quelques panneaux qu’on a réchappés pour en faire un monument commémoratif. Toutefois, des pierres de couleur imbriquées
dans le pavé nous indiquent encore son ancien emplacement et on peut ainsi en suivre le tracé. Cette fois-là, quand j’ai franchi la porte de Brandebourg, j’ai dansé et j'ai ri aux éclats. Mes enfants ont pensé
que j’étais folle. Mais il fallait avoir vu et traversé le mur de Berlin pour comprendre à quel point on se portait mieux, sans lui.
L'île de feu
J’ai entendu parler d’elle pour la première fois en 2013, alors que je lisais un article dans la revue EnRoute d’Air Canada. Et c’est ainsi qu’a commencé ma fascination pour l’île Fogo, à Terre-Neuve. Nous nous étions promis, Chéri et moi, que nous irions l’explorer un jour.
L’île, qui fait 25 kilomètres de long par un peu moins de 15 kilomètres de large, compte aujourd’hui un peu plus de 2000 habitants, regroupés dans une dizaine de communautés qui, jusqu’au moratoire de 1992, vivaient principalement de la pêche à la morue.
Fogo Island, qui signifie Île de feu, fut nommée ainsi par les portugais qui la découvrirent au 16e siècle… Quoi qu’on suspecte que les Vikings y avaient foulé le sol bien avant! Au fil du temps, elle a été visitée par des explorateurs français, italiens, espagnols, mais ce sont les anglais et les irlandais qui l’ont véritablement colonisée au 18e siècle. D’ailleurs, dans certains villages, l’oreille avertie perçoit des accents britanniques de l’ère Élisabéthaine et des vieux dialectes irlandais.
Les colons s’installaient dans des baies profondes qui avaient un brise-vagues naturel à l’entrée, comme des îlots, par exemple, pour se protéger des rigueurs de la mer. D’ailleurs, les rochers érodés le long de la côte sont la preuve que l’Atlantique et les glaces font leur oeuvre.
Jusqu’à encore récemment donc, les gens de Fogo vivaient de la pêche et des légumes qu’ils faisaient pousser. Ils bâtissaient des celliers sous terre pour conserver, dans des barils, leurs pommes de terre, navets, carottes et choux. Pendant longtemps, le troc - et non l’argent - était utilisé par les habitants de l’île pour obtenir certaines denrées : ils échangeaient leur morue salée contre farine, légumineuses, sucre, etc. Et jusque dans les années 1960, il n’y avait ni électricité ni eau courante : les habitants allaient chercher leur eau au puits du village.
Aujourd’hui, le meilleur moyen de découvrir les charmes de l’endroit, c’est d’emprunter l’un des nombreux sentiers pédestres de Fogo, et de savourer, le visage fouetté par le vent marin, les paysages paisibles mais arides, ce que nous avons fait. Nous avons eu la chance d’avoir une guide extraordinaire, en la personne de Claire, une dame de 72 ans qui est née, a grandi et a vécu toute sa vie sur l’île, dans le village de Tilting. Pendant plusieurs heures, nous l’avons suivie avec intérêt, alors qu’elle gambadait d’un pas alerte à travers la toundra et jusque sur les rochers, tout en nous racontant en quoi consistait la vie à Fogo, et partageant histoires et légendes sans même perdre le souffle…
L’île Fogo est un gros rocher, essentiellement du granite, mais on y trouve aussi beaucoup d’autres types de roches qui ont été transportées par les icebergs. On verra des arbres dans la partie sud de l’île, mais sinon, c’est la toundra qu’on y retrouve comme formation végétale : mousses, graminées, arbrisseaux comme le pain-de-perdrix et le plaquebière qui produisent des petits fruits. D’ailleurs, lors de notre séjour, nous avons aperçu des villageois accroupis en train de cueillir diverses variétés de myrtilles et d’airelles, car les pots de confitures maison se vendent bien aux touristes. Claire nous a fait découvrir et goûter quelques espèces tout au long de notre expédition.
Les petits villages entourent un bras de mer ou une baie et par conséquent, ont pratiquement tous un côté nord et un côté sud… Ou « ce côté » et « l’autre côté » de la baie. Claire nous racontait qu’à Tilting, lorsqu’elle était jeune fille, le magasin général se situait de «l’autre» côté, alors que l’école et l’église, s’érigeaient de «ce côté». Comme il n’y avait pas de route jusque dans les années 1960 à Fogo, les enfants de l’autre côté venaient à l’école en bateau. Les maisons typiques des villages de Fogo sont construites sur pilotis : ainsi, quand les habitants voulaient déménager, c’est la maison au complet qu’ils déplaçaient, souvent en la faisant flotter sur des barils ou en les faisant glisser sur la glace, vers un autre lieu. On reconnaît les vieilles maisons typiques par leur couleur, d’un brun rougeâtre: en effet, pour protéger le bois extérieur, on enduisait les planches d’huile de loutre et de morue, ce qui donnait cette teinte particulière au bois. À l’intérieur, les habitants couvraient les murs de papier peint afin de sceller les murs mal isolés et ainsi réduire les courants d'air. Tout près de leur maison, sur le bord de l’eau les habitants construisaient une remise à bateau et une cabane qui leur servaient d’endroit pour saler la morue. Afin de repérer leurs bâtiments dans la pénombre, les gens peignaient un énorme point blanc sur la porte. C’est une tradition qui s’est perpétuée au fil des ans.
Nous remarquons, pendant notre randonnée, que les habitants entourent leur jardin potager de clôture en piquets de bois. Claire nous explique que c’est pour le protéger des animaux qui circulent en toute liberté sur l’île : moutons, canards, vaches, chèvres, poules, caribous… Et il y a aussi des coyotes, mais ces derniers sont arrivés sur l’île en traversant par les glaces…
Il fut une époque où on chassait aussi le phoque, pour sa viande et l’huile, mais cette pratique a été abandonnée parce qu’impopulaire. Notre guide nous décrit ces journées d’hiver où les hommes allaient sur des grands blocs de glace qui s’approchaient de la rive, habillés en blancs, pour leurrer les phoques. Ils devaient faire attention à la direction du vent : si le vent tournait pour souffler vers la mer, ils devaient vite rentrer sur la terre ferme, sinon, ils risquaient de prendre le large au péril de leur vie. C’est arrivé à l’oncle de Claire : il a été sauvé in extremis par des hommes qui l’ont attrapé à partir d’une jetée, alors qu’il voguait à la dérive sur un amas de glace.
En traversant un terrain vague, Claire nous a fait remarquer des tombes qu’on arrive à distinguer avec peine dans les herbes folles. Elle nous a raconté qu’il y a environ un siècle, près de l’îlot aux Pigeons au nord de Fogo, un bateau anglais a fait naufrage et presque la totalité des passagers sont morts noyés. On les a enterrés ici, non loin de la mer. Cependant une dame qui a été réchappée, a décidé, après la tragédie, de s’établir au village de Tilting, où elle a vécu le reste de sa vie. Selon l’histoire, il s’agissait d’une dame disposant d’une grande fortune. Quand elle est décédée plusieurs années plus tard, elle a été enterrée, selon ses volontés, sur le même terrain que les autres passagers du bateau qui avaient péri lors du naufrage. Or, un marin sans scrupules aurait déterré la dépouille de la dame pour lui dérober les bijoux qu’elle portait dans son cercueil et encore aujourd’hui, des gens qui marchent non loin des tombes disent qu’ils rencontrent son fantôme. Je vous rassure, je ne l'ai pas vu.
Pendant la deuxième guerre mondiale, les américains ont installé une station radar sur Fogo. En effet, l’île était considérée comme un endroit stratégique pour défendre l’accès au continent nord-américain. Les soldats organisaient des fêtes dans un pavillon au bord du petit lac, près de John’s Batt Arm, et par la suite, les villageois ont longtemps continué d’y tenir des soirées dansantes. Les yeux pétillants, notre guide nous parle de la délicieuse crème glacée qu’on y vendait sur la grève lorsqu’elle était toute jeune.
Un certain professeur de l’université McGill, Robert Mellin, s’est intéressé à l’histoire de Fogo, notamment sur l’architecture et le mode de vie des gens de la communauté de Tilting. Il a recueilli des témoignages de personnes âgés et a écrit plusieurs essais sur le sujet et il amène régulièrement plusieurs de ses étudiants faire des travaux de restauration de bâtiments sur l’île. Il aime tellement l’endroit qu’il y possède maintenant une maison.
Notre randonnée guidée s’achève; non loin, nous apercevons l’hôtel Fogo Island Inn, qui a été construit par la fondation de Zita Cobb, une multimillionnaire qui a grandit sur l’île et qui a décidé de redonner à sa communauté en stimulant l’économie locale. L’hôtel, qui emploie plusieurs centaines de locaux, se dresse sur un roc au bord de l’océan, complètement isolé. Nous avons l’impression d’être au bout du monde…
L’île Fogo nous avait longtemps intrigués à travers les articles que nous avions lus à son sujet. Maintenant, elle nous enchantait par son histoire, sa culture et ses paysages, mais surtout par la gentillesse et fierté de ses habitants et leur détermination à préserver leur mode de vie.
Par une fraction de point, une fraction de seconde...
Je l'avoue, je suis une «accro». Accro aux jeux olympiques. J'aimerais dire que je le suis en tant qu'athlète. Hélas, si la nature — ou la génétique — m'a pourvue de bien des talents, je dois admettre que je suis absolument nulle aux sports. Je manque de coordination et d’agilité. Seule ma détermination m'a permis de me démarquer dans certains sports.
SI je suis accro aux jeux olympiques, c'est à cause de l'émotion. Alors que la torche des jeux de Tokyo vient tout juste de s'éteindre, je ne peux m'empêcher de repenser avec émerveillement aux beaux moments que les athlètes de partout dans le monde, et pas seulement les canadiens, nous ont fait vivre. Le sauteur du Qatar qui a partagé sa médaille d'or avec son compétiteur italien. Quelle générosité! La coureuse néerlandaise qui est tombée pendant le 1500 mètres, qui s'est relevée et a réussi à passer de la dernière à la première place. Quelle persévérance! La gymnaste américaine qui a décidé que son bien-être et sa sécurité passaient avant la gloire. Quelle sagesse! Il faut surtout se rappeler que tous ces athlètes se sont entraînés pendant — et malgré — une pandémie, au prix de grands sacrifices. Par exemple, plusieurs ont dû se pratiquer dans installations de fortune, renoncer à voir leurs conjoints, leurs familles pendant de nombreux mois. Et tout cela sans savoir si les jeux auraient finalement lieu…
Ce ne sont pas les records, le tableau des médailles, les performances herculéennes, les statistiques ou les drapeaux qui m’impressionnent le plus. C’est l’aspect humain, l’histoire derrière les athlètes. C’est l’endurance dont ils font preuve, la douleur qu’ils surmontent, la chaleur torride qu'ils combattent, la rigueur qu’ils se sont imposée, les sacrifices qu’ils ont faits. Ce sont les émotions qui font qu’aux quatre ans — aux deux ans maintenant, puisque les jeux d’hiver ont été décalés — je reste collée à mon écran pour suivre les exploits des athlètes olympiques.
Ce que je regrette lorsque je regarde les jeux à la télévision, c’est que le temps d’antenne est pratiquement réservé aux meneurs et aux sports les plus spectaculaires. On nous montre les compétitions de ceux qui monteront vraisemblablement sur le podium, on reçoit en entrevue les athlètes qui ont gagné des médailles ou ceux qui auraient dû en gagner. Le coureur qui arrive au dixième rang n’a-t-il pas fourni autant d’effort que celui qui est arrivé premier? Mérite-t-il moins son moment de gloire? Je suppose qu’on doit favoriser ce qui génère de bonnes cotes d’écoute... Et je ne parle même pas des jeux para-olympiques qui sont pratiquement boudés. Mais je rêve du jour où nous pourrons décider et choisir de suivre les compétitions et les athlètes qui nous intéressent, comme si nous étions sur place, dans les gradins.
En 1976, les jeux olympiques se sont tenus chez nous, à Montréal. Jusqu’à la dernière minute, presque tout le monde doutait que les jeux auraient lieu. En effet, quelques semaines avant l'ouverture officielle, les installations, et en particulier le stade, étaient loin d'être prêtes. Et pourtant, à peu près tout rentra magiquement dans l'ordre, juste à temps. Mes parents se dirent que nous ne pouvions pas passer à côté de l’occasion de vivre ce moment unique. Ce n’est pas tous les jours que des jeux olympiques se déroulent dans sa ville! Ma mère fit donc la file au magasin La Baie du centre-ville, entourée de gens de partout dans le monde, pour nous procurer des billets. Oui, je suis fière de dire que je suis allée aux jeux olympiques! Je n’avais pas tout à fait douze ans et je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai assisté à des compétitions d’athlétisme dans le grand stade : je nous revois nous installer, en famille, sur les bancs jaunes, je me rappelle des sons, des images, l’atmosphère magique, mon attention sollicitée par mille détails, par chaque compétition. C’est un évènement qui restera toujours ancré dans ma mémoire.
Si les jeux olympiques, au fil du temps, ont vu leur réputation entachée par les scandales, la politique, le dopage, les déficits, il n’empêche qu’ils sont un grand rassemblement planétaire qui perdure et cela malgré des guerres, des boycotts, des actes terroristes. Ils mettent en lumière de grandes qualités humaines : le dépassement de soi, la persévérance, la résilience, la compassion, l’effort, l’esprit sportif, la fraternité, l’entraide, le respect, la reconnaissance...
C’est pourquoi j’ai toujours une pensée pour tous les athlètes qui sont restés dans l’ombre pendant les jeux olympiques. Ceux qu’on n’a pas vus parce qu’ils n’étaient pas dans le peloton de tête au triathlon ou parce qu’ils ne se sont pas qualifiés pour la finale au saut à la perche. Ceux qui, parce qu’ils ont fait une contreperformance, sont moins «héroïques». Ceux qui ne sont jamais monté sur le podium, qui ont perdu une médaille par une fraction de seconde... Ils sont des champions, ils sont inspirants et je les remercie pour les émotions qu’ils m’ont fait vivre.
Par une fraction de seconde, on t’a devancé.
Par une fraction de points, l’autre l’a remporté.
Pendant des années, tu t’es
sacrifié, tu as donné le meilleur de toi-même, sans compter.
Les amis t’ont appuyé, ta famille t’a encouragé à aller plus haut, plus loin.
Et tes efforts ont été couronnés
quand au sein de l’équipe olympique, tu as été accepté.
Nous avons fondé nos espoirs en toi, notre vedette, notre fierté.
Et tu n’as que quelques glorieuses minutes, pour nous prouver
que nous avions raison d’y croire. Tu te mesures aux plus grands athlètes du monde, mais tu te dois d’être le meilleur.
Et moi, bien installée en pantoufles, callée dans mon fauteuil, devant la télévision,
je crie, je t’encourage…
Car tu monteras certainement sur la plus haute marche. On nous l’a dit, tu es un espoir de médaille.
Moi, je ne m’intéresse aux jeux olympiques que pendant deux semaines, aux quatre
ans.
Pour toi, les olympiques, c’est ta vie.
Tu étais héro et une fraction de seconde trop tard, une fraction de seconde en moins, tu es devenu déception.
On t’a pourtant souvent répété
que l’important, c’était de participer. Alors pourquoi te parle-t-on aujourd’hui, de l’or que tu as failli remporter ?
Au bout du compte, ce sont les larmes que j’ai vues dans tes yeux,
C’est la poignée
de main amicale que toi et ton rival avez échangée,
C’est ton visage épuisé à la fin de la compétition qui prouve que tu es allé au bout de tes forces,
C’est de penser que tu as tenu le
pays entier en haleine,
Que tu as donné l’exemple à des milliers de jeunes,
Que tu as ouvert la voie à de futurs champions,
Qui font que je te considère aujourd’hui,
Comme un grand héro.
Mon arrière grand-mère Emma
Par un concours de circonstances tout à fait inattendu, j’ai récemment retracé l’histoire de mon arrière grand-mère anglaise, Emma Jane Herring, née Green. C’est une femme que j’ai connue, mais dont je ne garde que de vagues souvenirs puisqu’elle est décédée alors que je n’avais qu’onze ans.
Quand je pense à elle, j’ai l’image d’une dame bien en chair, robuste, aux cheveux blancs. Nana, comme on l’appelait, vivait avec sa sœur Florence dans le sud-ouest de Montréal, dans le même quartier où elle, son mari et sa famille s’étaient installés au début du 20e siècle. Bien qu’elle ait toujours été gentille avec moi, elle demeurait une énigme, probablement parce qu’il m’était impossible de converser avec elle; en effet, enfant, je ne parlais pas anglais et de son côté, malgré qu’elle ait résidé pendant plus de cinquante ans à Montréal, elle n’avait jamais appris à dire autre chose en français que «maudit cochon».
Il y a quelques années donc, grâce à la magie de l’internet, je suis tombée par hasard sur un site de généalogie et j’ai constaté qu’un certain Leslie Green, un octogénaire de Birmingham, était à la recherche des descendants de mon grand-père Freddy. Il s’agissait, en fait, d’un de mes arrières-petits cousins britanniques qui tentait de compléter l’arbre généalogique des familles Green et Herring qu’il avait lui-même constitué et qui remontait jusqu’au 16e siècle. J’ai donc pris contact avec lui et, à son grand bonheur, je l’ai aidé à rajouter quelques branches manquantes à son arbre. C’est grâce à lui que j’ai appris l’histoire de mon arrière grand-mère, près de 50 ans après sa mort.
Emma Jane Green est née en 1890, à Birmingham dans le nord de l’Angleterre. Elle et sa sœur aînée Florence vivaient dans la maison de leurs grands-parents maternels située sur Gate Street, dans le quartier ouvrier et pauvre de Saltley, avec leur mère Clara. Elles sont nées de père inconnu, ce qui était considéré comme un scandale à l’ère victorienne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on a longtemps laissé croire que les grands-parents, propriétaires d’une cordonnerie, étaient les parents des deux petites filles. Toutefois, en 1901, leur mère s’est mariée avec un certain David Meddings et elles sont toutes trois déménagées pour s’établir avec lui jusqu’à son décès, cinq ans plus tard.
En 1909, Emma s’est mariée avec mon arrière grand-père William James Herring, de trois ans son aîné. Les Herring étaient originaires de Wanborough, qui fait partie aujourd’hui de la ville de Swindon, dans le Wiltshire, une région à l’ouest de Londres. Le père de mon arrière grand-père, un forgeron en quête d’une vie meilleure, a décidé de déménager toute sa famille à Birmingham au début du XXe siècle. Ils ont été fort probablement déçus, car la vie était loin d’y être facile. Les Herring et leur huit enfants se sont installés dans une petite maison au 92 Phillimore Street, également dans le quartier de Saltley, à deux pas de la maison où demeurait Emma. Mon arrière grand-père William James devint également forgeron et travailla à la compagnie Metropolitan Carriage Works, qui fabriquait des locomotives et des wagons de train.
Avant la Première guerre mondiale, plusieurs jeunes britanniques se mariaient et émigraient, dans le but surtout d’échapper à un quartier gris et une vie miséreuse. Après la naissance de leur premier enfant, Bill junior, William décida donc de partir seul en éclaireur, en 1911, afin d’explorer la possibilité de s’établir au Canada. Il trouva un logement à Montréal sur la rue Drake, et commença à travailler pour la Canadian Car and Foundry.
Puisqu’il avait trouvé un toit et un emploi, sa famille pouvait venir le rejoindre. Emma et son fils, le petit Bill, s’embarquèrent sur le SS Victorian, le 10 mai 1912, au port de Liverpool. Mon arrière grand-mère était quelque peu craintive de traverser l’Atlantique, d’autant plus que le Titanic avait sombré seulement quelques semaines auparavant. Mais elle arriva sans encombre le 18 mai au port de Québec, avant de se rendre à Montréal auprès de son mari.
En 1913, Emma, enceinte, retourna en Angleterre avec son fils, alors que William resta à Montréal. Elle voulait donner naissance à son deuxième enfant à Birmingham, où elle aurait le soutien de sa famille. Le petit Leonard arriva à l’automne et Emma profita de la compagnie de sa mère et de sa sœur pendant plusieurs mois, si bien qu’elle se trouvait toujours en Europe avec ses deux fils en bas âge lorsque la guerre éclata à l’été 1914. Alors qu’elle faisait des tentatives pour traverser au Canada, elle reçut une note de son mari : «Ne rentre pas à la maison, je me suis enrôlé.»
Mon arrière grand-père fut un des premiers à se porter volontaire pour devenir soldat et fit donc partie du Corps expéditionnaire canadien. Après un entraînement sommaire à Val-Cartier, il se retrouva basé en Angleterre, puis il fut déployé en France où il a combattu tout le temps de la guerre. Cependant, il dut avoir droit à des permissions et visiter son Emma à Birmingham de temps à autres, puis qu’en août 1917, mon grand-père, Frederick Charles vit le jour.
Après la guerre, toute la famille Herring revint au Canada. Ils arrivèrent au port d’Halifax, avant de prendre la direction de Montréal. En 1919, William James Herring, qui avait repris son boulot à la Canadian Car, faisait un revenu annuel de 1200 $. Lui, Emma Jane et leurs trois fils vivaient dans un appartement de quatre pièces, au 2431 Jacques-Hertel, au coin de la rue Beaulieu, dans le quartier Ville-Émard à Montréal. Le loyer était de dix dollars par mois. La sœur d’Emma, Florence, vint également s’établir à Montréal. Son premier époux était mort dans les Dardanelles pendant la guerre et elle n’avait pas d’enfant. Elle se remaria beaucoup plus tard, à l’âge de 42 ans, avec un canadien d’origine écossaise.
Emma et William eurent un autre fils en 1921, Robert, le premier de leurs enfants à naître en sol canadien. En août 1926, une première fille, Georgina, fit son arrivée dans la famille, mais elle ne survécut que quelques jours. Finalement, Edward a vu le jour en 1929, mais il est mort un mois plus tard.
Pour Emma, la famille était ce qui comptait le plus. Elle est toujours restée très proche de sa sœur, Florence et elle est retournée en Angleterre, pour assister au second mariage de sa mère, Clara, et visiter la parenté. Elle a vu ses fils se marier, et elle est devenue grand-mère, puis arrière grand-mère. Mais si elle a connu des jours heureux, elle a aussi eu droit à son lot de malheurs : son fils aîné Bill faisait de la sclérose en plaque et il est décédé à l’âge de 46 ans. Son deuxième fils Leonard a été tué en 1960 dans un accident tragique, la gorge tranchée par une pièce qui s’était détachée d’un train en marche alors qu’il passait sous un viaduc. Quant à Frederick, mon grand-père, il avait de sérieux problèmes cardiaques. Il est d’ailleurs mort à l’âge de 59 ans, après avoir subi trois interventions à cœur ouvert. Le fils cadet, Robert, est allé s’établir avec sa famille à Calgary.
Emma est devenue veuve en 1964, quelques mois avant ma naissance. Pendant plusieurs années, elle a habité un logement sur la rue De Champigny avec sa sœur. C’est là que j’allais la visiter quand j’étais jeune. Elle est morte au printemps de l’année 1976, à l’âge de 86 ans, à Calgary, alors qu’elle visitait son fils Robert. Son corps a été rapatrié à Montréal puisque son souhait était d’être enterrée avec son mari William. Je me rappelle être allée au service et ensuite au cimetière. Aujourd'hui, je suis contente d’en avoir appris davantage sur cette aïeule qui, sans avoir mené une vie extraordinaire, a quand même fait preuve d’audace et de détermination. Même si c’était dans l’espoir d’un meilleur avenir, elle a dû avoir recours à de grandes doses de courage et de résilience pour partir à l’aventure vers un nouveau continent et s’y établir, laissant derrière elle sa parenté. De plus, elle a connu le tournant d’un siècle, deux guerres mondiales et une crise économique. Bien sûr, je ne peux qu’imaginer les commentaires qu’elle a dû entendre dans sa jeunesse du fait qu’elle n’avait pas de père, la honte qu’elle a dû ressentir parfois. Je pense à la peur qu’elle a surmontée lorsqu’elle a fait la traversée de l’Atlantique ou quand son mari s’est retrouvé sur les champs de bataille. Elle a aussi sûrement eu beaucoup de chagrin chaque fois qu’elle a vu un de ses enfants rendre l’âme. Je me demande enfin ce qu’elle dirait de notre monde aujourd’hui et surtout, si elle serait fière de ses descendants, de ce qu’ils sont devenus.
Je l’espère certainement.
Nana, mon arrière grand-mère, posant avec moi le jour de ma première communion.
Rendez-vous à l'aveugle
Alors que j’étais célibataire dans ma jeune vingtaine, j’ai eu, dans mon entourage, quelques personnes bien intentionnées, qui s’étaient donné comme mission de m’aider à trouver l’âme sœur.
Invariablement, toute conversation sur le sujet commençait par un commentaire du genre : «Tu ne mérites pas d’être seule. Je connais justement un gars qui est célibataire…»
Évidemment, comme toute jeune personne, je supposais, qu’un jour, j’aurais un amoureux. La notion de «quand» était plutôt vague. Je n’étais pas pressée, le célibat n’étant pas une punition pour moi. J’avais un appartement coquet, un boulot, et un bon cercle d’amis. Je sortais, je voyageais et je profitais grandement de ma jeunesse. Au fond, j’aimais mieux être célibataire que mal assortie.
Je dois ajouter que je n’étais pas très à l’aise avec les jeux de séduction. Où trouver la perle rare ? À l’épicerie ? Au centre sportif ? De nature plutôt réservée et méfiante, je n’aimais pas engager des conversations avec des étrangers. Je ne prisais pas les clubs ou les discothèques où la musique et les clameurs empêchaient toute conversation. Et au travail, je côtoyais exclusivement des collègues féminins.
Il y a bien eu un de mes clients qui m’a fait des avances. Il m’a apporté des fleurs au bureau, m’a invitée à dîner, sous l’œil amusé de mes collègues. Il était fort gentil et avenant. Quel était le problème me demanderez-vous ? Et bien… Il était plus âgé que mon père, marié et père de deux garçons… Que dis-je, de deux adultes ! Et puis, si je l’appréciais comme client, je ne le voulais certainement pas comme amant ! Avec beaucoup de délicatesse, j’ai repoussé ses attentions et lui ai expliqué, sans équivoque, qu’il ferait mieux de regarder ailleurs.
Finalement, il me semblait que la façon la plus plausible de rencontrer un bon gars serait à travers mon cercle de connaissances. Un ami de l’ami d’une amie, vous voyez ce que je veux dire ? Le hasard ferait bien les choses. Si c’était pour arriver, un jour, mon prince viendrait.
Mais à l’été ’89, certaines de mes amies ont choisi de prendre mon avenir en main et de provoquer le destin. Elles m’ont organisé des rendez-vous à l’aveugle.
J’étais tellement contre l’idée ! Quel bonheur ressent-on à se trouver pendant quelques heures en compagnie d’un pur inconnu avec qui on a probablement peu d’atomes crochus ? Et de quoi parler ? Où aller ? Mais les protestations fusèrent de toutes parts : «Si tu n’essaies pas, ma chère, tu ne le sauras jamais. Fais-nous un peu confiance ! Nous te connaissons ! Nous allons te présenter quelqu’un de bien…»
De bonne grâce, j’acceptai donc de tenter le coup. Je devais admettre que mon «Roméo» ne tomberait pas du ciel. Il fallait bien que je fasse un petit effort. Qu’avais-je à perdre, au fond ?
Il fut donc convenu qu’un jeune homme, collègue du frère d’une de mes amies, allait m’appeler pour convenir d’un rendez-vous. C’était un ingénieur qui travaillait dans le secteur de l’aéronautique.
Première conversation téléphonique ? Rien pour me convaincre. Il demeurait sur la rive-sud de Montréal. Moi, j’habitais Laval.
«On pourrait se rencontrer quelque part à Montréal,» ai-je suggéré.
Non, Monsieur insiste, il veut venir me cueillir chez moi et m’amener souper au restaurant.
Il me demande de me décrire. Me décrire ? Que dire ? J’y vais pour la simplicité :
«Je suis grande, j’ai les yeux et les cheveux bruns».
Et lui de répondre :
«Moi, on me dit que je ressemble beaucoup à Tom Cruise.»
Tom Cruise, vraiment ? Je ne suis pas une fan, mais au moins, je ne sortirais pas avec un pichou.
Nous convenons que ce sera une sortie sans prétention et que nous porterons une tenue décontractée.
Le fameux samedi soir arrive. Évidemment, comme il s’agit d’un premier rendez-vous, je soigne quand même mon apparence. Bermuda et chemisier, sandales et léger maquillage. Je ne voudrais pas faire peur au sosie de Tom, quand même ! De ma fenêtre, je guette l’arrivée du candidat mystère. Chaque fois qu’un jeune homme s’approche de l’édifice, je sursaute, j’épie ses gestes et je juge.
Après quelques fausses alertes, j’aperçois un énergumène en short de course et t-shirt délavé. Il porte des bas d’éducation physique avec des barres rouges qui lui arrivent à mi mollet, et des souliers de style «loafer», blancs… On dirait un personnage tout droit sorti du film Elvis Gratton! Horreur ! J’espère que ce n’est pas… Ding dong ! Ça sonne ! Ciel, c’est lui ?
Honnêtement, pendant une bonne minute, j’ai débattu l’idée de ne pas répondre. Si on trouvait que ce gars ressemblait à Tom Cruise, moi j’étais Marilyn Monroe ! Il n’avait de semblable à la vedette de Top Gun que la couleur de ses cheveux ! Et cet accoutrement, c’était une blague ?
Puis, quand il a sonné une deuxième fois, je me suis fais une raison. Bon, au premier coup d’œil, il ne me plaisait pas, mais l’apparence, ce n’était pas si important, au fond… Et s’il avait une personnalité du tonnerre ? Peut-être était-il très gentil et drôle ? Ses goûts vestimentaires pouvaient changer. Je devais lui laisser une petite chance. J’ai pris une grande inspiration, et j’ai ouvert la porte.
Et je l’ai regretté, toute la soirée !
Il m’a fait des remarques sur mon apparence, m’a dit que j’étais trop chic, trop bien mise. J’imagine qu’il aurait fallu que je sois échevelée, toute débraillée, pour plaire à Monsieur ! En ville, une fois son auto stationnée, il a ouvert le capot pour débrancher des fils, «afin de ne pas se faire voler sa Jetta.» Essayait-il de m’impressionner avec ses doigts maintenant couverts de graisse ? Tout au long du repas, il a tenté de me psycho-analyser, afin de s’expliquer pourquoi j’étais toujours célibataire. J’ai été tentée de lui répondre : «parce que je ne rencontre que des imbéciles comme toi !»
Mais, je suis restée polie et je l’ai écouté débiter ses inepties. À intervalles réguliers, j’ai tenté de lui faire comprendre que je voulais mettre fin à cette mascarade de rendez-vous. Malheureusement, il ne saisissait pas mes allusions, pourtant très claires. Pauvre mec ! Il n’avait rien pour lui ! Il a fallu que je sois directe : «peux-tu me reconduire maintenant, ou si je dois prendre un taxi ?»
Une fois de retour chez moi, je me suis dis qu’on ne m’y reprendrait plus.
Et pourtant…
Trois semaines plus tard, j’avais un deuxième rendez-vous à l’aveugle. J'appelle d'abord le candidat, mais je refuse que nous nous décrivions au téléphone. Aussi bien ne pas se faire d’illusion, les attentes élevées engendrent parfois d’amères déceptions !
Pas question qu’on vienne me chercher cette fois ! Nous allions nous retrouver au restaurant. J’avais appris ma leçon, c’était non négociable, je prenais mon auto, pour pouvoir me sauver si nécessaire !
Le jeune homme avait assez belle apparence et il était attentionné. Mais nous n’avions absolument rien en commun. J’essayais de trouver des sujets de conversation qui nous auraient permis de discuter, en vain. Les silences s’étiraient et devenaient gênants. Malgré tout, au dessert, il m’a exposé qu’il souhaitait que je l’accompagne à trois mariages auxquels il était invité et qui auraient lieu au cours des prochaines semaines. Je l’ai regardé, bouche-bée. Était-il désespéré à ce point ? Le supplice n’avait-il pas assez duré ? C’était un gentil garçon, mais je n’avais pas envie de rencontrer sa parenté ni ses amis. En plus, il faudrait que je m’achète des robes pour aller à ces mariages, et il ne valait pas l’investissement!
J’ai décliné sa proposition et lui ai souhaité bonne chance dans sa quête d’une compagne.
Deux échec en deux : ma moyenne au bâton pour les rendez-vous à l’aveugle n’était pas fameuse… Je commençais à douter des compétences de mes amies en jumelage de couple. Peut-être étais-je trop exigeante, trop difficile, et que finalement, je serais mieux de rester célibataire ?
Aussi, quand un mois plus tard, l’une d’entre elles m’appela pour me parler d’un candidat potentiel, j’ai fortement réagi : pas question de faire une autre tentative.
«Je suis certaine que tu vas le trouver à ton goût. Il n’aime pas les rendez-vous arrangés, mais il est prêt à te téléphoner. Parle-lui au moins ! Vous déciderez après si vous voulez vous voir !»
Soupirs. J’accepte avec hésitation. Et si cette fois était la bonne ?
La conversation téléphonique initiale est plus qu’encourageante. J’ai l’impression que la connexion se fait bien. Sa voix est plaisante, il fait preuve d’humour, et d’esprit. La conversation est amusante. Il propose que nous nous retrouvions après le travail, pour un café. J’approuve : de cette façon, si nous n’avons pas d’affinités, l’épreuve ne sera pas trop longue. Mais si nous avons envie de nous connaître davantage, nous pourrons nous revoir. Le lieu de rendez-vous convenu est au coin des rues Peel et Sainte-Catherine, en pleine heure de pointe. Il faut trouver un moyen de nous identifier. «J’aurai un tailleur beige !» dis-je sans réfléchir.
-«Moi je mesure près de 6’3’’, je serai en veston-cravate, et j’ai deux têtes. » Très drôle !
Quand j’appelle mon amie pour lui faire un compte-rendu, elle me déconseille de porter mon costume beige. «Trop sévère».
Aussi le lendemain, je me présente au lieu de rencontre dans une robe rouge. J’attends sur le trottoir, scrutant la foule qui se rue dans toutes les directions. Il y a bien un grand homme qui attend non loin et qui me regarde attentivement. Est-ce lui ? Il s’approche de moi et me demande : «Ne serais-tu pas celle qui est supposée porter un costume beige ?»
Je me mets à rire.
«Oui, si tu es celui qui est supposé avoir deux têtes !»
Je devais me pincer ! Il est très élégant, frappant. Enfin, un rendez-vous qui s’annonçait agréable. Nous sommes entrés dans le petit restaurant et avons commandé un café.
Nous avons parlé à bâtons rompus. Nous avons plaisanté et ri. Nous avions tous les deux grandi à Laval. Nous avions sensiblement eu le même parcours scolaire. Comme moi, il aimait voyager, s’était impliqué en politique, était abonné au théâtre Jean-Duceppe et aux concerts de l’OSM. J’étais subjuguée. C’était inespéré.
«J’ai faim !» me dit-il au bout d’une heure. «Je n’ai pas envie d’attendre pour te revoir. Si on allait souper ensemble ?»
J’étais sur un nuage ! La soirée s’est déroulée comme un rêve.
Nous nous sommes revus. Nos conversations sont devenues plus sérieuses et c'est là que l’histoire s’est gâtée. Je l’aimais bien, mais il avait près de dix ans de plus que moi, sa carrière était bien établie, il était prêt à se marier et à fonder une famille. Oups… Je n’étais pas au même endroit dans ma vie et je n’avais certes pas les mêmes attentes que lui. Dommage ! Il n’avait pas de temps à perdre. Moi, non plus…
Ce fut mon dernier rendez-vous à l’aveugle. Je renonçai définitivement à cette méthode de recrutement et j’en prévins les bonnes samaritaines de mon entourage! Les chances de rencontrer l’homme idéal de cette façon étaient plutôt minces. Et comme disait l’adage : «on n’est jamais mieux servie que par soi-même» !
Les belles retrouvailles
Comme tous les parents, je suppose, mon conjoint et moi avons élevé nos enfants de façon à ce que nos oisillons volent de propres ailes, quittent le nid et deviennent des adultes autonomes et responsables. Toutefois, en vieillissant, nous réalisons que les opportunités de passer du temps de qualité avec notre progéniture se font plus rares. Les enfants sont devenus de jeunes adultes, ils sont plus matures, ils font leur propre vie et élaborent des projets dans lesquels les parents n’ont pratiquement plus de place. Bien que ce soit tout-à-fait normal et même souhaitable qu’il en soit ainsi, c’est parfois avec une pointe de nostalgie que je vois mes enfants faire des choix sans demander notre avis ou faire des plans sans que nous y soyons inclus. C’est pourquoi, quand ma fille m’a fait part de son souhait de faire un voyage en France en ma compagnie, j’ai été à la fois surprise et heureuse. Et j’ai sauté sur l’occasion.
Nous étions allés à Paris en famille en juillet 2007. Déjà plus de dix ans s’étaient écoulés depuis que nous avions exploré la ville Lumière. Il y a des endroits que ma fille et moi voulions revoir, mais nous voulions surtout mettre l’accent sur les coins de Paris que nous n’avions pas eu la chance de visiter lors de notre séjour précédent.
Il n’y a pas d’autres villes comme Paris. Je dois préciser que ma relation avec elle n’a pas été toujours harmonieuse. En fait, quand j’y suis allée pour la première fois, en 1984, je l’ai détestée et j’ai même juré de ne jamais y remettre les pieds. C’était surtout ses habitants qui m’avaient horripilée. Leur façon hautaine et méprisante de traiter les étrangers, les immigrants comme les touristes, m’avait donné un haut-le-cœur continuel. Leur indifférence, leur arrogance, leur air de bœuf perpétuel avaient eu raison de ma patience et de ma bonne humeur naturelles. Pourquoi verser mon argent durement gagné à ces gens aussi pédants que désagréables? On me disait qu’ils étaient ainsi parce que Paris recevait trop de touristes. Et bien, c’était décidé, j’allais leur épargner mon accablante présence. C’est pourquoi Chéri a eu un dur travail de persuasion à faire en 2007 pour me convaincre d’y retourner.
Je dois admettre que le charme de la ville Lumière a opéré cette fois-là. Selon une française que j’ai rencontrée là-bas, il semble que le Ministère des affaires étrangères ait mis en place, au début des années 2000, une campagne bien organisée destinée aux membres de l’industrie du tourisme, restaurateurs, hôteliers, employés de musées, des services de transport et autres, pour redorer la réputation de la France et particulièrement de Paris. On a présenté un état de la situation aux professionnels et entrepreneurs en tourisme, on a fait des prises de conscience, on a offert aux personnels des formations en service à la clientèle, en langues étrangères. L’opération a porté fruit. Cette fois-là, nous avons été bien reçus ; je dirais même plus, nous avons été dorlotés. Les parisiens semblaient ravis de nous rencontrer, de nous parler. J’ai pu me laisser apprivoiser, découvrir les beautés de cette ville, ses quartiers, ses gens. En 2007, je suis véritablement tombée en amour avec Paris. Il était donc temps que je retourne voir celle qui m’avait finalement séduite. Rencontrer la version 2018 de cette ville.
J’ai trouvé Paris changée. Pas nécessairement au premier coup d’œil, car bien sûr, on y retrouve toujours la tour Eiffel, l’arc de Triomphe, le Louvre, Montmartre, les mignonnes rues étroites et les grands boulevards avec les cafés et leurs terrasses, les petits balcons fleuris, les jolis parcs, les quais et les ponts de la Seine. Non, je dirais que les changements sont à une autre dimension.
La ville a subi des meurtrissures au cours des dernières années, notamment à cause d’attentats meurtriers. La sécurité y est omni présente. On fouille nos sacs à l’entrée des sites touristiques, des musées, et même, des centres d’achats. On voit des gardes armés partout. J’avais un certain malaise à voir ces jeunes hommes se promener sur les boulevards et les places avec leur mitraillette en main. Pour les parisiens, ils font partie du décor, d’une nouvelle réalité. On sent chez les gens non pas une indifférence, mais une certaine résilience. Comme s’ils nous disait : «nous sommes heureux, mais nous avons perdu une partie de notre innocence». Les touristes sont traités avec respect et courtoisie, mais on sent parfois, que c’est par mécanisme. «Je suis gentil et poli avec toi parce que c’est mon devoir de l’être. »
Il y a tout de même eu des rencontres sympathiques, qui ont ponctué favorablement notre séjour. Je pense à ce guide hilarant au cimetière du Père Lachaise, vêtu d’un complet noir, ses longs cheveux poivre et sel retenus en queue de cheval, qui nous amenait d’une tombe à l’autre en gambadant et nous racontait d’un ton dramatique, des anecdotes à propos des morts célèbres. Ou encore à cette vendeuse toute souriante et patiente qui a bien dû aller chercher cinq boîtes de chaussures avant que nous trouvions la pointure qui convenait à ma fille. Il y avait aussi l’accordéoniste qui jouait des airs romantiques dans une rue de Montmartre, près de la place du Tertre. Et l’employé de l’hôtel qui nous servait le café tous les matins et qui ne se rappelait que de mon nom de famille, la brunette.
Paris m’a paru encore plus multiculturelle qu’avant, que ce soit de bon ou mauvais gré. Plus bilingue aussi. Et je ne parle pas seulement ici des quelques mots anglais que nos cousins insèrent dans leur conversation ou leur affichage. Non, peu importe le quartier, dans les cafés et les boutiques, presque partout en fait, on nous dit bonjour, puis, dès qu’on perçoit un petit accent, on poursuit la conversation dans un anglais parfait, et cela même si nous leur parlons français. Tellement, que ma fille, exaspérée qu’on lui parle exclusivement dans la langue de Shakespeare, a demandé : «est-ce que vous parlez français ?» Je n’ai pu m’empêcher de rigoler en pensant à la polémique du «Bonjour-Hi» que nous avons vécue à Montréal. Aux Galeries Lafayette où nous sommes allées faire un tour, les rabais sont annoncés au micro en français et… en mandarin ! Il faut croire qu’en France, on sait déjà vers quelle puissance économique il faut se tourner pour faire de bonnes affaires. D’ailleurs, nous avons vu des files d’autobus bondés de touristes chinois stationnés partout. Fait cocasse, alors que nous marchions vers Montmartre, ma fille et moi nous sommes retrouvées en plein cœur du quartier africain. C’était fort charmant jusqu’à ce que nous arrivions à un coin de rue près d’une station de métro, où le trottoir grouillait de jeunes hommes entreprenants qui abordaient les femmes pour les draguer. J’avoue que j’ai eu un moment de crainte, notamment pour ma fille et j’ai eu envie de la prendre par le bras, comme pour la protéger. Mais, de toute évidence, la couleur de notre peau n’était pas un attrait pour ces garçons, car ils nous ont laissé passer sans même nous regarder.
La ville est en effervescence à cause de ses gens : il y beaucoup de monde, partout. Pourtant, le rythme n’y est pas nécessairement plus rapide. Paris se réveille plus tard que nos grandes villes nord-américaines. En semaine, à 7 heures, en plein cœur de la ville, les boulevards sont encore tranquilles. Trouver un endroit ouvert pour s’acheter un café avant 8 heures relève du miracle. Même les Starbuck et les McDo ouvrent à 7h30 les jours de semaine ! Les activités quotidiennes y sont, par conséquent, décalées. On commence à travailler plus tard et on finit plus tard. Il est vrai que le soleil aussi se couche à 22 heures au solstice d’été. Les cafés et restaurants commencent à prendre vie à 20 heures. Les parisiens, en sortant du bureau, s’installent sur une terrasse et jasent entre eux en dégustant un verre de champagne ou un cocktail. On les entend parler de leur journée, de leur boulot, sans se presser. La soirée est jeune, ils ont tout leur temps.
La mairesse Hidalgo et notre mairesse Plante ont dû se concerter au sujet de la construction en ville : comme à Montréal, on ne compte plus le nombre de chantiers à Paris. Là bas, pas de cônes oranges, mais des barrières grises et vertes, autour des monuments, sur les trottoirs, les rues et les boulevards, les places et les parcs. Le jour, on entend le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs, des camions d’asphalte, des bétonnières qu’on doit contourner. Avec les véhicules, les vélos et les scooters qui vont dans tous les sens et même sur les trottoirs, il est heureux qu’on ait aménagé des rues piétonnières, notamment sur la rive droite. On peut y déambuler sans craindre pour sa vie !
Le matin, les piétons doivent aussi composer avec les gens qui dorment sur les trottoirs. Les itinérants, sont présents, comme dans toute grande ville ; toutefois, à Paris, ils ne sont pas tous des mendiants ou des gens avec des problèmes psychosociaux. Nous en avons croisés plusieurs, hommes ou femmes, étendus sur un matelas gonflable ou dans une tente, avec leurs enfants. Souvent on les voyait qui se rasaient ou qui se peignaient le matin, portant des costumes et de belles chaussures en cuir. Ce que nous avons appris, c’est que plusieurs de ces gens travaillent et s’ils dorment sur les trottoirs, c’est parce qu’ils n’ont pas les moyens de se payer un logement… Quand j’ai vu le prix de l’immobilier dans les vitrines de certaines agences, j’ai compris. Une moyenne de 10,000 Euros le mètre carré pour un logement. Les minuscules condos à un peu moins de 500,000 Euros sont une rare aubaine. En plus, la population parisienne est en croissance, mais pas l’espace. Ce n’est peut-être pas un phénomène exclusif à Paris, mais ce fut pour moi une prise de conscience.
Malgré ses problèmes, ses imperfections, Paris est une ville magnifique que j’ai appris à aimer au fil de nos rencontres. Il fait bon y marcher, flâner, la découvrir, le jour comme le soir. Je ne pourrais pas y demeurer, mais comme une vieille amie, j’ai eu plaisir à la retrouver pendant quelques jours. Je suis contente d’avoir eu la chance de le faire en compagnie de ma fille. Ces moments privilégiés de retrouvailles sont trop rares. Il ne faut que les apprécier davantage.
Explorer le monde
On dit que les voyages forment la jeunesse...
En ce qui me concerne, les voyages me permettent de sortir de ma zone de confort, de développer mon sens de la débrouillardise, de mieux m'organiser, d’être curieuse, de repousser mes limites et de devenir plus tolérante. J’aime être dépaysée, voir comment les gens d’ailleurs vivent. Le jour où je voudrai que le reste du monde soit comme dans ma cour, je resterai dans ma cour.
Je me rappelle qu'un jour à Paris, alors que j'admirais la Ville lumière du haut de la Tour Eiffel, j'ai entendu des américains s'exclamer que la France serait le plus beau pays du monde si les français parlaient anglais! Pourtant les langues, les dialectes définissent les cultures, l'identité des peuples. Bien sûr la communication est parfois ardue quand on voyage loin de chez soi, mais cela fait partie des défis à relever. Je m'en suis aperçue en Russie et en Grèce, alors que je n'étais même pas en mesure de déchiffrer les lettres sur les enseignes. C'est également particulier lorsqu'on s'aperçoit que Munich en Allemagne est en fait Munchen, que Florence en Italie est Firenze et qu'il faut chercher Cobh sur la carte de l’Irlande pour trouver la petite ville portuaire de Cove, aussi appelée Queenstown. De quoi en perdre son latin!
Les voyages commencent bien souvent par des histoires de transport. Quand j’y réfléchis, avec toutes les aventures que j’ai vécues, il est incroyable que je n’aie pas davantage peur de monter à bord des avions! De retour de France, j’ai vécu une alerte à la bombe. Un passager avait enregistré ses bagages, mais ne s’était pas présenté dans l’avion. Il fallait donc retrouver ses valises dans la soute. Quand nous sommes finalement partis, quelques heures plus tard, je ne pouvais m’empêcher de me demander si la compagnie aérienne avait bien récupéré toutes les valises suspectes.
Pendant un décollage de Los Angeles, un des moteurs s’est subitement arrêté et il a fallu retourner au sol, en position d’atterrissage d’urgence, après avoir délesté l’avion de ses réserves de kérosène au-dessus du Pacifique. Je me rappelle aussi d’un vol particulièrement turbulent et stressant où nous étions au cœur d’un orage violent alors que nous approchions Montréal. On se sentait comme dans des montagnes russes, les passagers criaient et il a fallu rebrousser chemin jusqu’à Toronto.
Il y a aussi eu ce trajet mémorable de plus de 14 heures avec 3 escales pour revenir d’Aruba. Tout était allé de travers : retard, bris mécanique, perte de nos bagages, et disparition du pilote lors de la dernière escale. Oui, oui, je vous le jure, les autorités ont cherché le pilote dans l’aéroport pendant plus d’une heure. C’est finalement un passager, un pilote certifié de la compagnie aérienne revenant de vacances, qui avait pris les commandes, en chemise hawaïenne et sandales.
À l’aéroport de Chicago, où je faisais escale, un homme m’a littéralement lancé son bébé de 9 mois dans les bras me demandant de m’en occuper pendant cinq minutes, avant de disparaître à la course. J’ai tenté de le suivre dans la foule. L’idée m’est venue qu’il avait peut-être kidnappé cet enfant et que dans un moment de panique, il me l’avait donné pour mieux s’enfuir. Je ne voulais surtout pas me faire arrêter pour complicité! Je l’ai finalement retrouvé au comptoir d’American Airlines. Quand je lui ai tendu le bébé, il m’a chaleureusement remerciée d’avoir pris soin de son fils le temps qu’il règle son vol. Je lui ai dit à quel point sa conduite était irresponsable, qu’on ne confiait pas son bébé à une pure étrangère : il m’a sourit et m’a dit qu’il savait qu’il n’avait pas à s’inquiéter, que j’avais l’air honnête et sympathique!
Finalement, je n’oublierai jamais le douanier américain qui m’a traitée de menteuse et a failli ne pas me laisser traverser la frontière parce que j’avais dit que Chéri, qui voyageait avec moi, était mon conjoint. Il m’a demandé de lever la main gauche, et quand il a vu que je n’avais pas d’alliance, il m’a fait la morale. Selon lui, je ne pouvais pas avoir de conjoint si je n’étais pas mariée en bonne en due forme. J’ai senti la moutarde me monter au nez et le rouge aux joues. J’ai eu fort envie de lui dire, avec sarcasme, que j’étais une concubine tout en lui montrant un doigt d’honneur, mais j’ai plutôt compté jusqu’à dix, ait feint un air contrit et ai présenté mes excuses sincères. J’ai pu ainsi avoir le privilège d’entrer au pays de l’Oncle Sam.
Conduire à l'étranger peut s'avérer une expérience stressante. Je me rappelle avoir tourné en rond plusieurs fois sur les autoroutes du New Jersey parce que je ne comprenais pas les affiches qui ne correspondaient en rien aux indications sur les cartes routières ni aux informations que j'avais eues de l'hôtel. C'était avant l'arrivée des GPS, bien sûr. Cela nous avait coûté cher en frais de payage, car chaque fois que nous rebroussions chemin, il fallait passer à nouveau à une guérite pour payer notre dû! Il y a probablement un tronçon d’autoroute au New Jersey que nous avons ainsi financé et qui, par conséquent, devrait porter notre nom!
Conduire dans certaines villes,
comme à Rome ou à Paris me semble comme une tentative de suicide. Je ne l'ai pas essayé, j'ai déjà eu assez peur en tant que piétonne. En Angleterre, c'est la conduite en sens inverse qui pose défi. La première
fois que nous y sommes allés, Chéri et moi, j'avais commis l'erreur de louer une auto manuelle. Changer les vitesses avec la main gauche? Hors de question! Nous avons payé un supplément pour une automatique et ce fut un excellent
investissement... pour notre santé mentale!
Prendre le train à Naples pour aller vers Pompéi nous a fait vivre un autre type d'expérience : nous avions de la difficulté à trouver le quai où nous attendait
notre train et nous étions assez serrés dans le temps. Un gentil vieillard s'est approché et comme un bon samaritain, nous a offert de nous aider. Il nous a rapidement guidé vers la bonne plateforme et au moment où nous allions
le remercier pour sa gentillesse, il a tendu la main en exigeant 10 Euros. Ils ont le sens des affaires ces napolitains!
Mais je n’oublierai jamais le trajet en train de nuit de Paris vers Copenhague dans un compartiment partagé avec cinq grands gaillards du Danemark. J’avais 19 ans, je voyageais seule, et j’avais hésité à m’assoir avec eux. Mais le train était bondé, je ne trouvais pas de place ailleurs, j’étais épuisée et ils m’avaient fortement invitée à partager leur compartiment. Au bout du compte, ils étaient fort sympathiques. Nous avons jasé, écouté de la musique et il ont partagé une partie de leur repas avec moi. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, vers minuit, ils ont décidé de se déshabiller, de baisser les banquettes pour en faire un grand lit et de s’étendre, en caleçon, cordés les uns contre les autres. J’ai choisi de rester habillée et de me placer le plus près de la porte possible, au cas où j’aurais à me sauver. Mais ils ont été de parfaits «gentlemen» et, contrairement à moi, ils ont dormi paisiblement tout le long du trajet.
Sur l'île de Santorin, mes enfants voulaient vivre l'expérience de grimper la falaise menant à Fira à dos d'âne. Chéri voulait prendre le funiculaire. Comme
nous ne pouvions laisser les enfants seuls, bonne joueuse, je les ai accompagnés à dos d’âne… du moins, j'ai tenté de le faire. J'ai eu le "bonheur" de monter sur un âne plus têtu que les autres, qui refusait
d'avancer. Alors que les montures de mes enfants gambadaient allègrement vers le sommet, la mienne s’arrêtait à tout moment. Quand Bourriquet se décidait à faire quelques pas, il longeait le mur de pierre de sorte que
mes jambes ont été éraflées et il s'assurait de passer sous les branches de arbres les plus basses, comme s'il espérait me faire tomber. Je devais littéralement me coucher sur l’âne pour éviter une
commotion cérébrale!
J’ai finalement atteint le haut de la falaise où mes enfants et Chéri m'attendaient, morts de rire. Et ils n'ont pas manqué de me faire remarquer que l'odeur de l'âne avait imprégné
mes vêtements! Hi Han!
Comme la plupart des touristes, j'aime bien immortaliser certains paysages en prenant des photos. Hélas, ce faisant, j'ai tendance à oublier de regarder où je mets les pieds. À Santiago
de Cuba, au haut de la forteresse surplombant la mer, alors que je m'apprêtais à prendre une photo de Chéri près d'une tourelle, j'ai mis le pied dans le seul orifice du plancher et ma jambe gauche au complet s'est enfoncée
dans le sol, au point où j'ai fait le grand écart. Outre l’inconfort, j’étais effrayée à l’idée de toutes les bestioles qui devaient ramper sous le plancher et qui pouvaient à tout moment effleurer
ma jambe. À Brighton, dans le sud de l'Angleterre, j'admirais le magnifique Pavillon royal et cherchais l'angle dans lequel j'allais prendre ma photo lorsque j'ai trébuché sur le trottoir et me suis retrouvée dans les bras d'un
bel anglais qui m'a attrapée au vol. Chéri, qui n'avait rien vu, pensait que je faisais exprès pour me jeter au cou d'un autre homme.
À Fontainebleau, je tentais de photographier le célèbre château, sans
avoir remarqué que le trottoir finissait subitement. Ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu pied, ma caméra a fait un vol spectaculaire pour se retrouver par hasard dans les mains d'un touriste japonais, et je me suis écroulée
à quatre pattes sur le pavé, en pleine intersection, stoppant la circulation. J'avais l'air du pape embrassant le sol. Heureusement, à part quelques écorchures aux genoux, je n'ai subi aucune blessure, si ce n'est qu'à mon
orgueil.
Les voyages sont d'excellentes occasions d'interagir avec l'humain et ce qui me fascine par-dessus tout, c'est de voir comment les gens vivent dans leur environnement. Voir les italiens faire leurs livraisons vers les commerces de Venise
par bateau et ensuite avec de petits chariots dans les rues étroites et les escaliers. Goûter à une bonne soupe au mouton après une randonnée avec des islandais. Interagir avec les vendeurs de légumes et de fruits au
marché public de Helsinki. S'asseoir à l'ombre d'une terrasse à Athènes pour casser la croûte et regarder les gens défiler dans la rue. Flâner par un beau dimanche après-midi dans un parc de Berlin ou sur
une avenue de Londres. Se reposer sur un banc près de la Seine à Paris et prendre le temps de déguster une ficelle avec un bon fromage, après avoir erré dans quelques boutiques. Prendre l'autobus public à Copenhague
et obtenir l’aide des usagers pour nous rendre à bonne destination. Rouler à vélo en plein cœur d'Amsterdam. Assister à un match de cricket aux Bermudes et se faire expliquer les règles par des partisans en liesse.
S’arrêter à l’hôtel Plaza de New York pour déguster une pâtisserie et un thé avant de traverser Central Park. Écouter un chœur répéter dans une cathédrale orthodoxe de Russie...
Il y a aussi ces paysages qu’on ne peut oublier : la mer turquoise des Caraïbes, les Alpes ou les Rocheuses canadiennes, les glaciers d’Alaska, le désert californien, les collines de Toscane, les parcs de Barcelone, les bougainvilliers
en fleurs des îles grecques, les lacs et les châteaux d’Écosse. Des images qui sont autant gravées dans notre mémoire qu’immortalisées dans nos albums photos.
Il y a évidemment les expériences cocasses. Par exemple, il y a eu cette soirée à Helsinki alors que j’étais dans un sauna avec des amies et que les joueurs d’une équipe de hockey locale sont entrés… dans leur costume d’Adam.
Je pense aussi à la fois où, dans un escalier du métro de Paris, j’ai senti une main remonter le long de ma cuisse arrière pour aller me saisir le popotin : sans réfléchir, hautement insultée, je me suis retournée en me donnant un élan pour frapper le coupable. C’était un vieillard qui a été sonné, non seulement par la force de mon coup de poing, mais aussi par la virulence de mes insultes, criées en bon québécois. Et il y a cette corpulente vendeuse d’épices au marché de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui refusait de me vendre quoi que ce soit, parce qu’elle croyait que je venais de la «métropole». J’ai dû lui donner un bref cours d’histoire sur les colonies françaises avant qu’elle ne consente à me céder quelques bâtons de cannelle.
Autant d’expériences, d'images, de sons et d'odeurs qui nous rappellent que nous sommes loin de chez nous, mais en même temps, que, dans tous les pays du monde, les gens travaillent, mangent, rient, se disputent, s’entraident… bref, ils vivent!
Il me reste encore bien des coins de notre planète à découvrir. Il y a aussi des endroits où j’aimerais bien retourner, pour les explorer davantage. Je me considère très privilégiée d’avoir déjà visité autant d’endroits, mais j’espère avoir la santé et l’énergie pour voyager encore souvent et longtemps. Ainsi, je continuerai de former ma jeunesse, la jeunesse du coeur!
Le piano du Père Noël
Novembre 1998. Mon fils a deux ans et demi. Nous passons la soirée en famille chez mon beau-père, à jaser de tout et de rien, confortablement assis autour de la table de cuisine.
Soudainement, Beau-papa annonce à mon conjoint qu’il a l’intention de se débarrasser du piano, car un cousin a manifesté son intérêt à en faire l’acquisition. Je sursaute. De quel piano parle-t-il ? Cela fait huit ans que je viens chez mon beau-père, et je n’ai jamais vu aucun instrument de musique dans sa maison, encore moins un piano !
Il se lève et m’entraîne au sous-sol, comme Aladin dans la grotte d’Ali Baba. C’est alors que je découvre, bien dissimulé au fond d’une pièce, un magnifique piano droit, avec des pattes de lion sculptées. Il avait été acheté par la grand-mère de mon chéri au début du 20e siècle, et ma belle-mère en avait hérité et l’avait fait remettre en condition dans les années 1960. Certes, c’est une antiquité qui a besoin d’un peu d’amour, mais à mes yeux, c’est un trésor.
Je supplie mon beau-père : «si vous êtes pour le donner, auriez-vous objection à ce que je le prenne ?»
Chéri me regarde un peu surpris. Que ferai-je d’un piano ? Je lui apprends que depuis que je suis toute petite, je meurs d’envie d’avoir un piano. Dans ma jeunesse, j’ai appris à jouer de la guitare, de la flûte, de la clarinette, j’ai chanté dans nombre de chorales, mais mon rêve d’avoir un piano n’a jamais été comblé. «Sais-tu seulement jouer ?» me demande-t-il. Non, mais c’est un détail insignifiant. Je suivrai des cours s’il le faut, je m’achèterai des livres de musique, je vais pianoter. Je suis prête à payer le déménagement. Je suis aussi disposée à le faire réparer et accorder, mais je veux ce piano.
Mon beau-père ne se fait pas prier longtemps. La semaine suivante, j’hérite du fameux piano. Il a sa place de choix, dans mon salon. Je gratte doucement les taches de peinture blanche qui recouvrent ça et là son bois couleur acajou. À ma grande satisfaction, elles partent sans laisser d’éraflures. J’appuie doucement sur les touches d’ivoire pour entendre les notes et puis je joue quelques airs, par oreille. Cela sonne faux, bien sûr, car le piano n’a pas été accordé depuis des lunes, mais c’est une situation temporaire. Je suis fière et excitée, comme une petite fille un matin de Noël.
Après quelques recherches, j’appelle un accordeur. Nous convenons qu’il pourra passer vers dix-neuf heures le lendemain.
Nous soupons tôt ce soir-là. J’ai hâte d’entendre ce que l’accordeur aura à dire sur ma nouvelle acquisition. Nous sommes dans le salon à regarder la fin du bulletin de nouvelles pendant que mon fils joue avec ses autos miniatures, quand on sonne à la porte.
«Oh, Oh !» s’exclame mon fils. «C’est qui ?»
À la blague, Chéri lance : «c’est peut-être le Père Noël !». On est à la fin de novembre après tout! C’est plausible !
Mon petit bonhomme part en courant vers la porte, excité à la perspective de voir le mythique personnage. Chéri le rattrape et déverrouille la porte pour l’ouvrir.
Ce fut un moment magique, le genre d’instant où on regrette, plus tard, de ne pas avoir eu la caméra en main pour l’immortaliser. Je les revois, le père et le fils, sur le seuil de porte, bouche-bée et leurs yeux devenant grands comme des balles. Stupéfaits, ils fixent la personne qui attend dehors et qui, finalement, dit de sa grosse voix : «je viens pour la piano».
Je comprends enfin leur étonnement quand l’accordeur entre dans le vestibule : il a les cheveux blancs ondulés qui lui tombent sur le col, une grosse barbe blanche, de petites lunettes et un ventre bien rond. Il ne lui manque que l’habit rouge ! Je retiens un rire. Notre fiston saute de joie. C’est bel et bien le Père Noël qui vient d’entrer chez nous !
L’accordeur enlève ses bottes et son manteau et s’approche du piano. Mon fils le suit comme un aimant et le regarde attentivement ouvrir le piano pour exposer les cordes et les marteaux. Je l’entends encore demander de sa petite voix : «Qu’est-ce que tu fais, Père Noël ?». L’accordeur sourit, comprend, et joue le jeu. «Je répare le piano».
Fiston ne perd pas un seul mouvement de l’accordeur. Il regarde le coffre à outils avec curiosité, observe le vieil homme qui appuie sur les touches et fait des ajustements. Puis les questions fusent : pourquoi répare-t-il le piano ? Est-il brisé? Et bien sûr, où sont ses cadeaux ?
Patiemment, l’accordeur explique que le piano est un cadeau pour maman, mais qu’il est trop gros pour être transporté en traineau le soir de Noël, alors il lui a été livré avant. De plus, comme tous les instruments de musique, il a besoin d’être accordé pour produire de beaux sons. Comme les lutins étaient occupés au Pôle Nord à fabriquer les jouets des enfants sages, c’est lui-même qui a décidé de faire le voyage pour venir s’occuper du piano. «Toi, tu auras tes jouets la nuit de Noël.»
Mon fils est béat d’admiration. Ravi, il reste près du «Père Noël» pendant que celui-ci s’affaire autour de l’instrument. Une fois son travail terminé, il s’assoit sur le banc et se met à jouer des airs de Noël afin de s’assurer que le piano est bien accordé. Mon fils, qui est simplement aux anges, me regarde avec un beau grand sourire. Le Père Noël en personne a réparé mon cadeau de Noël et nous a donné un concert en prime!
Au moment du départ, l’accordeur a fait un clin d’œil à fiston : «N’oublie pas d’être sage ! À bientôt, mon garçon. »
À bientôt, Père Noël !