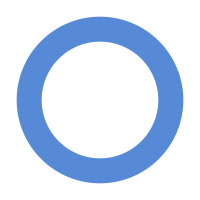Un accident si vite arrivé
Récemment, j’ai été happée par une auto alors que je faisais ma marche matinale.
Je vous rassure tout de suite : je suis saine et sauve. J’ai été extrêmement chanceuse! Rien de cassé, pas de blessure, sinon quelques égratignures et une ecchymose sur le pied gauche. Je n’ai même pas eu besoin de visiter un médecin.
Cette mésaventure m’a toutefois rappelé à quel point nous sommes vulnérables. Et cela m’a aussi fait réfléchir… Mais j’y reviendrai.
C’était une superbe matinée, il était près de neuf heures et le soleil était donc bien levé. Comme d’habitude, je portais un maillot sport de couleur vive, pour être bien visible. J’étais dans mon parc préféré où je marche quotidiennement, car la route qui le traverse est très peu fréquentée par les voitures : elle donne simplement accès à quelques aires de stationnement et la vitesse y est limitée à 15 km/heure. De plus, il y a une large piste cyclable sur le côté.
Je marchais donc d’un pas allègre sur le côté de la route quand j’ai entendu une auto approcher derrière moi. Je me suis retournée et j’ai vu un petit VUS à environ une vingtaine de mètres qui avançait tranquillement. Il y avait suffisamment de place sur la route pour que le véhicule passe sans problème, mais j’ai vérifié s’il y avait des cyclistes en vue, et comme je n’en voyais aucun à l’horizon, par précaution, je me suis rangée dans la piste cyclable et j’ai continué ma promenade.
J’ai senti la proximité du véhicule, avant qu’il ne me touche le dos. Une fraction de seconde. Assez de temps pour que mon cerveau m’envoie le signal : tu vas te faire frapper.
Je me rappelle la brutalité du choc, le bruit, la force avec laquelle j’ai été projetée au sol. Au début, je pensais que c’était un vélo qui m’avait heurtée à pleine vitesse. J’étais dans la piste cyclable après tout et je me disais qu’un cycliste avait peut-être échappé à mon attention. Mais j’ai levé les yeux et j’ai vu le VUS qui poursuivait sa route.
J’ai crié. Pas de douleur. De colère.
Des témoins ont intercepté le véhicule. La jeune conductrice a immobilisé son auto, a ouvert la porte et est sortie, surprise. Puis elle m’a aperçue à quatre pattes, me relevant tout doucement. Elle a blêmi et dans un élan de panique, elle s’est approchée de moi.
« Vous m’avez frappée! » lui ai-je dit d’un ton de reproche.
—Quoi ?
—Votre auto m’a heurtée. Je n’étais pourtant pas sur la route, j’étais dans la piste cyclable! Qu’est-ce qui vous a pris?
— Oh mon Dieu! Je suis désolée, je ne vous ai pas vue! m’a-t-elle dit, de toute évidence ébranlée.
— Vous ne m’avez pas vue? Avez-vous besoin de lunettes ?
Je ne voulais pas être méchante ni sarcastique, mais l’adrénaline me faisait réagir ainsi. À la grandeur et la stature que j’ai, comment ne pas me remarquer avec mon chandail bleu vif, en plein jour? Ce n’est pas comme si elle avait frappé un écureuil!
« N’avez-vous pas entendu le bruit? »
Elle fait un signe de négation.
« Étiez-vous en train d’utiliser votre téléphone cellulaire ? »
Elle me jure que non.
Je suis maintenant debout. Je bouge mes membres, je teste mes articulations, puis je fais quelques pas. Aucune douleur. Tous mes morceaux semblent en place. Je m’examine rapidement pour constater deux éraflures sur le devant de ma jambe gauche. Je me doute que mon corps risque de grincer le lendemain, mais somme toute, je suis en bon état. La conductrice offre d’appeler une ambulance, mais je refuse. Elle insiste pour me donner ses coordonnées.
Au même moment, j’entends un chien japper furieusement. J’aperçois un énorme berger allemand qui s’énerve à la fenêtre du passager de son VUS. Je viens de comprendre.
Madame m’avoue qu’elle a probablement été distraite par son toutou alors qu’elle conduisait. Je suspecte qu’il lui a bloqué la vue et qu’elle a tenté, pendant quelques secondes, de le calmer tout en tenant le volant d’une main…
Heureusement, elle n’allait pas vite et comme j’étais dans la piste cyclable, elle ne m’a pas heurtée en plein corps. Elle m’a davantage accroché le côté gauche. Je peux seulement m’imaginer l’état dans lequel j’aurais été si elle avait roulé à 50 ou 70 km/heure.
Elle a de nouveau présenté ses excuses. Je lui ai répondu que nous avons toutes deux été chanceuses ce matin-là. Je lui ai suggéré de faire attention au volant et d’éviter les distractions. « Un accident est si vite arrivé! » Puis, j’ai marché sans peine jusque chez moi.
Je vous le jure, aucune séquelle. Comme je le disais, j’ai été très chanceuse.
Je mentionnais donc plus tôt que cet incident m’a aussi portée à réfléchir. Cette jeune femme n’avait pas intentionnellement tenté de me blesser. C’était un bête accident causé par un bref moment d’inattention. J’ai pensé à tous ces moments où j’ai moi-même agi de façon écervelée : la plupart du temps, il n’y a eu aucune conséquence fâcheuse, mais j’admets qu’il y a des occasions où j’ai franchement regretté ma distraction. Cela nous arrive tous : notre esprit divague un peu ou notre attention est détournée, et nos sens ne sont plus autant en alerte.
Je me rappelle certains de mes moments d’égarement les plus notoires : j’ai déjà oublié mon portefeuille dans un magasin après un achat. J’ai laissé ma carte débit dans la fente du guichet automatique après une transaction. J’ai aussi abandonné mon sac à main sur le dossier d’une chaise à la cafétéria de l’université. Il m’est arrivé à quelques reprises de me tromper de route en me rendant au travail parce que je réfléchissais à tout, sauf à mon itinéraire. Déconcentrée par un appel téléphonique alors que je cuisinais, j’ai négligé d’ajouter un ingrédient essentiel à une recette. Un jour, j’ai oublié d’attacher mon fiston dans son siège de bébé. J’ai déjà omis de donner une dose de médicament à ma fille. Perdue dans mes pensées, j’ai manqué quelques rendez-vous importants. Et je ne compte plus les fois où j’ai fait des chutes spectaculaires parce que, distraite, je n’avais pas regardé où je mettais les pieds en marchant.
Il y a trente ans, une jeune étudiante a complètement embouti mon auto avec la sienne alors que j’étais prise dans un bouchon sur l’autoroute : elle s’était endormie au volant. Le réveil fut brutal : je m’en suis sortie avec un mal de cou, mais mon auto était une perte totale. Nous avons tous entendu parler de parents qui ont oublié leur jeune enfant dans le siège arrière de la voiture, parce qu’ils étaient perdus dans leurs pensées cette journée-là. De jeunes piétons se font renverser dans les zones scolaires par un conducteur distrait. Les gestes ne sont pas intentionnels, mais les conséquences sont parfois graves. J’ai moi-même fait des choses assez stupides en conduisant, détournant mon attention et mes yeux de la route pendant quelques secondes. On oublie trop souvent que nous sommes aux commandes d’un engin de près de 2 000 kilos et qu’avec la vitesse et une source de distraction, cet engin devient létal.
J'aurais préféré ne pas avoir vivre l'expérience d'être happée par un VUS pour me rappeler à quel point il est important, lorsqu’on conduit, de porter toute son attention sur la route et les autres usagers. De plus, rien ne sert de faire de la vitesse : vaut mieux arriver quelques minutes plus tard et en un morceau.
J’ai bien appris ma leçon. Un accident est si vite arrivé…
Votre appel est important pour nous!
J’ai été interpellée par l’article d’Isabelle Haché dans la Presse du dimanche 10 septembre 2023, Le prix de nos incivilités. On y parle des gens qui perdent patience et qui ne sont pas très polis et gentils avec les préposés au service à la clientèle.
Je pourrais vous raconter tellement d’histoires à ce sujet! Je dois préciser – et les gens qui me connaissent pourraient vous le confirmer - que je suis une personne généralement patiente et fort aimable. J’ai travaillé avec le public pendant de nombreuses années, et que j’ai même eu à traiter et régler des plaintes dans un centre de services scolaire. J’en ai entendu de toutes les couleurs! Par conséquent, je suis particulièrement sensible, empathique et gentille avec les gens qui travaillent en service à la clientèle.
Or, justement récemment, on a testé les limites de ma patience.
Au cours d’une nuit, je reçois un courriel de ma banque, m’avisant d’une fraude possible sur ma carte de crédit. On me parle d'un achat de 121$. Je reconnais le nom de l’entreprise où l'achat a été fait. Il s'agit de la compagnie qui héberge mon site Internet, avec laquelle je fais affaire depuis plus de 6 ans. Les frais annuels étaient dus et j’ai donc fait mon paiement par carte de crédit, comme d’habitude.
Dans le courriel, ma banque me demande de communiquer avec elle le plus rapidement possible pour régler l'affaire. Puisque le paiement n’a pas été autorisé, je n'ai pas le choix, sinon je risque de perdre mon site Internet et les données qui s'y trouvent. Par ailleurs, je suspecte – avec raison – que toutes mes transactions sur ma carte de crédit seront bloquées, tant que je n’aurai pas parlé avec la banque. Tôt le matin, je compose donc le numéro à l’endos de ma carte de crédit. Un message vocal me prévient qu'il y a un nombre élevé d'appels et que l'attente pourrait être d'environ 30 minutes. Je suis un peu agacée, mais je me dis que, comme je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Je mets mon téléphone en mode haut-parleur et je vaque à quelques tâches, en attendant. Je suis malheureusement obligée d’écouter la petite musique énervante, leur jingle, exécuté au glockenspiel, et la répétition aux 2 minutes d'un message vocal qui me dit que tous les agents sont occupés, de rester en ligne, qu’on me répondra dans quelques instants! Au bout de 48 minutes, la communication est coupée! Je n’en reviens pas, je dois recommencer!
J'ai donc rappelé, attendu et subi la fameuse ritournelle publicitaire pendant – tenez-vous bien – plus de deux autres heures, avant de pouvoir enfin parler à un agent! Je rappelle ici que j’appelais le numéro suggéré pour rapporter une fraude ou une carte de crédit perdue ou volée, des situations assez énervantes, vous en conviendrez. Je m’estimais quand même heureuse d’être dans le confort de ma maison, et non dans un magasin à finaliser un achat important ou pire, à l’étranger, ce qui aurait été royalement embarrassant.
À un certain moment, pendant l’attente, j’ai eu le réflexe d’ouvrir mon ordinateur et de voir s’il y avait un autre moyen de joindre le service des fraudes et cartes volées. Outre le numéro de téléphone que je connaissais déjà trop bien, on me suggérait d’envoyer un courriel au service à la clientèle de la banque, où on me garantissait une réponse… dans les 24 heures! Je l’ai fait, en me disant que ce serait peut-être plus rapide!
Quand j’ai enfin pu parler à un agent, j’ai eu à m’identifier bien sûr, et il a constaté qu’effectivement, ma carte de crédit était bloquée, en raison d’une transaction suspecte. Je l’ai rassuré et lui ai dit que je connaissais bien cette entreprise, qu’il pouvait autoriser la transaction et débloquer ma carte.
Après quelques instants, il m’a expliqué que tout était rétabli, que je devais refaire la transaction pour le paiement de l’hébergement de mon site Internet, mais qu’il n’y aurait plus de problème.
Je le remercie et avant de raccrocher, je mentionne calmement, au jeune homme : « Je sais que ce n’est pas votre faute, mais honnêtement, attendre près de trois heures pour parler à un être humain quand il s’agit d’une fraude ou d’une carte de crédit volée, à mon avis, c’est inacceptable. » Il s’est dit profondément désolé. Que pouvait-il dire d’autre? J’espérais seulement que l’appel était sous écoute.
Vous croyez que l’histoire se termine là? Ce serait trop beau!
Un peu plus tard, je tente à nouveau d’effectuer le paiement pour l’hébergement de mon site Internet. Paiement refusé, et courriel dans ma boîte de réception : ma banque m’avise à nouveau d’une transaction suspecte! Ma carte de crédit est encore bloquée. Je n’en crois pas mes yeux!
Je rappelle la banque. Même petite musique énervante. Même message enregistré m’assurant qu’on allait me répondre bientôt. Attente de plus de deux heures, encore une fois! J’ai beau être gentille, mais là, j’avoue que je commençais à sentir mon niveau de stress et de colère monter de quelques crans.
Quand un agent a pris la communication, j’ai dû fournir un effort titanesque pour rester calme et polie. Selon lui, l’agent avec qui j’avais parlé précédemment n’avait pas bien fait son travail et par conséquent, toutes les transactions étaient toujours bloquées.
Cette fois, l’agent est allé vérifier auprès de son superviseur quelle était la procédure à suivre. Quand il est revenu en ligne, je lui ai demandé par trois fois si tout était rétabli, et si je pouvais payer mon compte sans craindre que ma carte soit à nouveau bloquée. Il m’a assuré que oui.
À la fin, il m’a demandé s’il pouvait faire autre chose pour moi. J’ai hésité, puis je lui ai dit : « oui, pouvez-vous demander à votre superviseur de ne pas nous forcer à écouter la petite musique répétitive et vos messages vides de sens, pendant que nous sommes est attente? C’est énervant, pour ne pas dire agressant, au plus haut point. »
Il m’a assuré qu’il ferait le message, mais juste au cas, je supplie ici toutes les compagnies qui ont des messages enregistrés automatiques pendant la mise en attente des appels : arrêtez de mettre de la musique! Et si notre appel est si important pour vous, répondez dans un délai raisonnable, de grâce!
Cette journée-là, j’ai passé près de cinq heures en attente au téléphone, pour régler un problème qui, au fond, n’aurait pas dû en être un. J’ai beau être à la retraite, j’ai mieux à faire! D’ailleurs, je n’ai pas pris de chance, j’ai utilisé une autre carte de crédit pour payer mon compte et tout a fonctionné du premier coup. Tiens donc!
En passant, le lendemain, j’ai reçu une réponse au courriel que j’avais fait parvenir au service à la clientèle de la banque : on me suggérait d’appeler le numéro pour les fraudes et cartes de crédit volées, celui-là même où on atttend des heures pour avoir une réponse…
J’ai mis les ciseaux dans la fameuse carte de crédit pour la mettre à la poubelle.
« Votre appel est important pour nous », qu’ils disaient!
Et après, on nous reprochera de ne pas être gentils et polis…
Monologue d'un voisin
Note : L'animateur vedette de la chaine de télévision Fox News, Tucker Carlson, allait présenter un documentaire truffé d'inexactitudes sur le Canada, le comparant même à l'Irak et à la Syrie. Il était fidèlement suivi par plusieurs millions de téléspectateurs aux États-Unis... Il a été remercié par Fox News en avril 2023. On ne sait trop ce qu'il adviendra du documentaire, mais j'avais déjà écrit le texte qui suit, plusieurs semaines auparavant.
Il est intéressant – et parfois désolant - de découvrir ce que les Américains connaissent de notre pays, de nous, leur plus proche voisin. La conversation que je vais vous relater a été intéressante, dans le sens de décourageante. Je vous préviens : si vous avez déjà une image négative de nos voisins du sud, ce récit ne vous fera certainement pas changer d’opinion. Je tiens toutefois à vous rappeler, avant que vous ne réagissiez, que les centaines de millions d’américains ne pensent pas tous ainsi. Heureusement.
Même s’il n’y a pratiquement pas de chance qu’il lise ce texte, j’appellerai mon interlocuteur par un prénom fictif : John. Âgé de 73 ans, anciennement homme d’affaires, il a vécu pratiquement toute sa vie à Brooklyn, mais il est maintenant retraité, en Floride depuis quelques années. Il raconte à qui veut l’entendre qu’il y a environ cinq ans, les médecins ne lui donnaient plus grand espoir de vivre : il était obèse, alcoolique, il avait de graves problèmes cardiaques, des défaillances musculaires, et il avait peine à marcher. Il s’est pris en main, a perdu près de cent livres, a changé ses habitudes de vie, s’est mis au Tai-Chi, et a éliminé ses sources de stress. C’est tout à son honneur.
Je dois préciser que John est à la base un homme sympathique : il est gentil, avenant et il parle avec tout le monde. D’ailleurs, il étale sa vie à qui veut l’entendre et révèle, au passage, ses philosophies quelque peu ésotériques. Il passe ses journées à la plage et fait quelques sauts dans la piscine ou dans la mer pour se rafraîchir. Sa peau est tannée comme du vieux cuir, même celle de son crâne totalement dégarni, qu’il ne protège aucunement des rayons du soleil.
Un beau jour, m’ayant aperçue à quelques reprises dans les parages, il s’est approché de moi pour se présenter. C’est d’ailleurs ainsi que j’ai appris son histoire. Quand il a su que j’étais de Montréal, il a eu envie d’engager une discussion décousue (lire ici « monologue ») sur la politique mondiale, se permettant d’écorcher au passage la politique canadienne. Car voyez-vous, tout va tellement mieux aux États-Unis… N’est-ce pas?
Vous savez, le type qui pense être un sage, qui prétend tout savoir, mais qui, au fond, dit n’importe quoi? Celui dont la connaissance du monde se limite à la profondeur de son nombril ? Celui dont l’analyse de situations complexes est en fait un ramassis de commentaires qu’il glane un peu partout? C’est lui!
Ce jour-là, John a commencé par parler des déraillements de train qui ont eu lieu récemment aux États-Unis.
« C’est horrible. Comment de telles choses peuvent-elles arriver dans un pays aussi développé que le nôtre ? C’est la faute des syndicats! »
Avant même que je puisse demander quel était le lien entre les déraillements et les syndicats, il a enchainé avec des propos sur les aéroports du pays :
« Tu as vu le nombre d’avions qui ont frôlé la catastrophe en atterrissant sur une piste alors qu’un autre engin s’apprêtait à décoller?»
J’en avais effectivement entendu parler.
« C’est à cause des politiques d’équité en embauche », affirme John.
« En voulant donner des chances égales aux gens de races et d’orientations sexuelles différentes, on tire vers le bas et on embauche des gens moins compétents. »
Ouf! Je commence déjà à sentir le rouge gagner mon visage, et ce n’est pas à cause de la chaleur.
J’essaie de présenter un argument :
« Mais n’y a-t-il pas perte d’expertise avec les nombreux départs à la retraite aux États-Unis? N’est-ce pas un facteur important ? Et puis, il y a peut-être aussi un problème au niveau de la formation des contrôleurs aériens? »
Et voilà John qui me reproche de trop croire les journalistes «wokes».
Petite parenthèse : je dois préciser ici que je suis exaspérée qu’on associe l’expression « woke » à toutes les sauces, sans égard pour son véritable sens... John joue dangereusement avec mes nerfs, mais, bon, je respire par le nez.
« Il faut se méfier des médias, » ajoute John. « Tu sais, les médias au début voulaient Trump à la présidence, ils le voulaient vraiment. Maintenant, va savoir pourquoi, les médias ne le veulent plus. »
Tiens donc! Va savoir pourquoi!
« Savais-tu que Trump a failli se faire assassiner parce qu’il priorisait les États-Unis? Tout comme Kennedy, qui s’est fait tuer par Cuba et l’URSS. »
Est-ce qu’il vient vraiment de comparer Trump à Kennedy?
Et quand y a-t-il eu tentative d’assassinat contre Trump? Il faut croire que je l’ai manquée celle-là! Peut-être est-ce quand il a attrapé la Covid?
« Vous savez, vous risquez de devenir des fascistes au Canada. Vous devriez être très prudents »
Il dit cela avec le plus grand sérieux.
« Des fascistes? » Je le regarde, incrédule.
« Oui, si vous ne faites pas attention, vous allez devenir un pays comme l’Ouganda ou l’Iran. Vos droits et libertés seront supprimés. La preuve? Regardez la façon dont les camionneurs ont été traités à Ottawa lorsqu’ils ont manifesté. Le gouvernement a gelé leurs comptes de banque, c’est épouvantable.»
J’ose répliquer.
« Oui, je comprends, c’était une mesure un peu extrême, mais John, ils ont quand même pris la ville d’Ottawa en otage, de même que les résidents et les commerçants. Pendant un mois! Il fallait y mettre fin, non? »
- « Non, il fallait négocier gentiment avec eux. »
- « Gentiment négocier quoi ? »
- « Vous n’aviez pas le droit de les obliger à se faire vacciner.»
- «L’obligation ne venait pas des États-Unis? Il fallait être vacciné pour traverser la frontière. »
- «Au début oui, mais nous avons laissé tomber cette exigence, car finalement la vaccination, c’était pour protéger les Chinois. Mais votre gouvernement est fasciste. »
-« Attends John, un gouvernement fasciste, selon moi, est un gouvernement d’extrême-droite. Le gouvernement Trudeau est centre-gauche. Rien à voir avec le fascisme! »
- «Tu parles comme une intellectuelle! (Merci du compliment, John!). Il ne faut pas jouer sur les mots. Socialisme, communisme, fascisme, nazisme, c’est du pareil au même… Vous avez un régime où les syndicats, les médias et les gros bonnets sont contrôlés et contrôlent tout. Trudeau est un autocrate car il supprime les droits du peuple. »
« Ok. Je vois. Et quelles sont tes sources, John ? »
- « J’ai un ami canadien. Il m’a tout expliqué, surtout à quel point le Canada a été épouvantable dans sa gestion de la pandémie. »
Ah bon! S’il y a un ami canadien quelque part qui le dit, ça doit être vrai!
Il continue :
« Tu sais, les présidents américains ne se sont jamais suffisamment opposés aux Chinois. Ils ont tous laissé la Chine faire ce qu’elle veut. Ces ballons espions qui ont volé au-dessus des États-Unis ? C’est inacceptable! »
- « Mais… Les États-Unis n’espionnent donc pas? »
- « Oui, mais c’est fait en cachette, pas ouvertement. Les opérations américaines sont secrètes. C’est mieux comme ça. »
Évidemment!
« Le Canada ne fait rien contre la Chine. Le Canada n’a même pas voulu dire que les Chinois étaient à l’origine de la pandémie. Après, vous vous demandez pourquoi vos gens se font kidnapper. »
Mon téléphone cellulaire a choisi ce moment pour sonner. Alléluia! Sauvée par une sonnerie! J’ai dû présenter mes excuses et répondre. John, loin de s’offenser, s’est levé et est allé retrouver d’autres amis avec qui échanger ses sages pensées.
Pour une fois, j’étais contente qu’une firme de télémarketing m’appelle pour me vendre son baratin. Ma santé émotionnelle a été sauvée!
Le moment présent
Vous vous rappelez de la tragédie des anges ? Au printemps 2000, une éducatrice était montée dans une fourgonnette avec dix jeunes enfants qu’on lui avait confiés, pour les amener à la cabane à sucre. Puis, à peine quelques instants plus tard, huit des enfants perdaient la vie dans un bête accident de la route. Quand j’ai appris la nouvelle quelques heures après, je me suis sentie happée par une grosse vague d’émotion. J’ai eu une pensée pour ces parents qui étaient allés reconduire leurs petits trésors au service de garde ce matin-là, sans se douter que ce serait la dernière fois qu’ils les verraient vivants. J’ai tenté de me rappeler les dernières paroles que j’avais dites à mes propres enfants le matin-même quand je les avais laissés à la garderie. Avais-je pris le temps de les embrasser? Leur avais-je dit à quel point je les aimais ?
Comme tout le monde, j’ai perdu, au fil du temps, des êtres qui m’étaient chers. Quand cela nous arrive, on dirait que nous prenons davantage conscience que le temps est une denrée inestimable, à ne pas gaspiller. On comprend que chaque moment compte, que passer du temps de qualité avec ceux que l’on aime est ce qui est le plus important. La vie est fragile. On ne sait jamais quand «une bonne fois», ce sera la dernière fois.
Lorsque j’étais une enfant, vieillir d’un an était un événement heureux. J’attendais mes anniversaires avec impatience : il me semblait que le mois de décembre n’arrivait jamais assez vite. C’était tellement long, un an ! J’ai langui d’avoir l’âge d’aller à l’école, d’avoir l’âge de travailler, d’obtenir mon permis de conduire, de voter, de sortir dans les bars… ou du moins d’avoir l’air d’être en âge d’aller dans les bars !
J’ai pris conscience que vieillir était un inconvénient le jour où l’idée d’avoir des enfants m’est passée dans l’esprit. Pour moi, la décision de donner naissance à un héritier n’était pas à prendre à la légère. C’était un contrat à vie, sans possibilité d’annulation. Mais contrairement aux hommes, les femmes ont une date d’expiration sur leur système de reproduction. Elles ne peuvent sans cesse repousser l’échéancier. Le tic tac de l’horloge biologique a donc commencé à royalement m’énerver au début de la trentaine. L’heure n’était plus à réfléchir.
J’ai sauté à pieds joints dans la maternité parce que j’avais un sentiment viscéral et non rationnel de le faire. Et je ne l’ai jamais regretté… Avoir des enfants a sûrement fait de moi une meilleure personne, mais cela m’a également donné un certain sentiment d’immortalité, peut-être parce que je n’avais pas le temps de voir passer le temps. Je gérais la vie familiale sur des pages de calendrier qui se tournaient à un rythme hallucinant entre mon travail, la garderie, mes réorientations de carrière et les retours aux études universitaires qui s’ensuivaient, les entreprises de Chéri, ses voyages d’affaires à l’étranger, les gastro-entérites, les otites - et toutes les autres «ites» - des enfants, les rentrées à l’école, le matériel scolaire à acheter et à identifier, les devoirs et les leçons à superviser, les rencontres de parents, les spectacles de fin d’année, les cours de ballets, de musique, de natation, les rencontres de scouts, les matchs de soccer et de football, les rendez-vous chez le dentiste, chez l’optométriste, à l’hôpital Ste-Justine, les courses et la lessive à faire, les repas à préparer, les fêtes d’anniversaire à organiser, les déguisements d’Halloween à confectionner, les cadeaux de Noël à trouver, les comptes à payer, les vacances familiales à planifier… Ouf ! On respire Élaine ! Un, deux, trois, et c’est reparti ! C’est ainsi que les années ont filé, une à une.
Je me suis réveillée un beau matin et boom !... j’avais atteint l’âge vénérable de cinquante ans. Avions-nous sauté deux ou trois décennies sans que je m’en aperçoive ? Je regardais les photos prises pendant ma trentaine et ma quarantaine : les souvenirs émergeaient mais tout me semblait déjà si lointain. Après avoir filé à folle allure sur l’autoroute de la vie pendant des années, j’ai eu soudainement envie de prendre les petites routes secondaires et ralentir pour mieux profiter des paysages.
Ainsi, j’ai repris contact avec la notion du temps. Les enfants sont devenus des adultes et ils ont maintenant leurs propres calendriers à gérer. Chéri a vendu son entreprise principale et a considérablement réduit ses activités professionnelles. Et moi, j’ai pris ma retraite, pour me consacrer à des projets et des rêves trop longtemps mis de côté.
Oh, j’aimerais bien arrêter l’horloge, trouver la fontaine de jouvence ou une recette magique pour garder la santé le plus longtemps possible. Mais des histoires à la «Benjamin Button», cela n’arrive qu’au cinéma. J’ai donc décidé de mieux prendre soin de moi et de savourer le moment présent. Je profite de chaque jour, de chaque seconde. J’accueille mes anniversaires avec résilience et gratitude. Au fond, si j’ai la chance de vieillir, c’est parce que j’ai la chance de vivre.
J’aimerais aussi trouver le moyen de garder les gens que j’aime avec moi pour toujours. Je trouve que la mort est particulièrement cruelle pour ceux qui restent. C’est pourquoi je suis reconnaissante pour chaque moment que je passe avec mes amis et mes proches. Leur bonheur et leur bien-être m’importent et je fais tout pour qu’ils ressentent à quel point ils sont précieux pour moi.
Peu importe son statut social, la grosseur de son portefeuille, son parcours, l’histoire de chaque être humain doit se terminer un jour. Personne n’y échappe, c’est la seule justice en ce monde. Mais en attendant, comme le chantait si bien Corneille, je vis comme si chaque jour était le dernier.
L'instinct animal
Il y a quelques temps, ma fille est venue passer quelques jours chez nous, histoire de profiter du cocon familial, de notre jardin et de notre piscine. Elle est arrivée avec Cabotine, sa magnifique chatonne de race Bengal, âgée de quatre ans.
Cabotine est un chat d’appartement. Elle n’a jamais connu rien d’autre que la vie d’intérieur. Je l’adore! Elle est attachante, mignonne comme tout, affectueuse, gaffeuse à ses heures et par conséquent, elle est hilarante. Elle reçoit deux repas par jour - de la nourriture de qualité, je le précise - sans compter les petites gâteries qu’on lui donne lorsqu’elle fait des prouesses. Ma fille lui donne câlins et attention à profusion, elle lui permet de jouer, courir et grimper à sa guise. Cabotine ne sort qu’occasionnellement dans la cour, et encore, lorsqu’elle le fait, elle porte un harnais relié à une longue laisse. Notre plus grande crainte est de la perdre.
Jusqu’à récemment, nous croyions que Cabotine n’était pas pourvue de grands talents de chasseuse. Certes, elle a toujours aimé courir après les moustiques et les bouts de ficelle, mais sans plus. Lorsqu’elle est dehors, elle observe les oiseaux et les écureuils avec curiosité, sans jamais tenter de les poursuivre. Elle semble même craindre son cousin Zorro, un chihuahua deux fois plus petit qu’elle, et s’en tient loin. Mais samedi dernier, à notre grande surprise, elle s’est sournoisement approchée, puis s’est jetée sur un pauvre étourneau qu’elle a attrapé à la vitesse d’un éclair. Elle le tenait fermement avec ses pattes et ses crocs. Ma fille et moi, horrifiées, avons réussi, in extremis, à extirper l’oiseau de sa gueule. Faisant fie de nos remontrances, la chatte, devenue féroce, a tenté de se jeter à nouveau sur sa proie, mais nous l’avons tirée juste à temps par sa laisse, et nous l’avons enfermée dans la maison.
Ma fille était attérée. Sa Cabotine, toujours si gentille, si douce, avait tenté de tuer un petit oiseau, sans raison. «C’est inexcusable ! Ce n’est pas comme si elle n’avait pas mangé depuis des semaines !».
Ah, mais Cabotine n’avait pas faim. C’est son instinct animal qui a pris le dessus. C’est ainsi qu’un chat se comporte avec un oiseau ou une souris… En prédateur. C’est dans sa nature. Un chat n’a pas la capacité de réfléchir. Il réagit comme son ADN l’a programmé. Il ne ressent aucune émotion et n’a aucune empathie. Si nous n’étions pas intervenues, elle aurait surement tué l’étourneau, sans raison particulière.
Une fois la chatte isolée, nous nous sommes occupées de l’oiseau qui avait tous ses membres et qui respirait encore. Une recherche sur Google nous a renseignées sur les «premiers soins» à lui prodiguer. Il était en état de choc et avait besoin de récupérer. Nous l’avons pris délicatement avec un vieux linge et l’avons déposé dans une boîte que nous avons placée à l’abri, sous les branches de notre haie de cèdres. Avec une seringue, nous lui avons donné des gouttes d’eau, puis nous nous sommes éloignées et l’avons laissé reprendre des forces. Un oiseau ne se serait normalement pas laissé approcher par des humains de la sorte. C’est contre sa nature. Par instinct, il aurait dû nous fuir. Mais il n’était pas en état de le faire. De toute évidence, s’il n’était pas encore mort, il n’était pas fort.
Je vous raconte cette histoire et vous parle d’instinct animal pour une raison.
Depuis l’avènement de #metoo, un nombre de plus en plus important de cas de harcèlement sexuel ont été dévoilés, les plaintes se sont multipliées et des personnes autrefois idolâtrées ont vu leur réputation entachée. Et c’est loin d’être terminé. Il y a eu beaucoup d’articles qui ont été écrits sur le sujet. Beaucoup de commentaires ont également été partagés, certains pertinents, d’autres plutôt enrageants. Je ne m’improviserai donc pas juge, commentatrice experte ou psychologue. Mais ces événements récents m’ont évidemment fait réfléchir sur le sujet. À mes expériences personnelles.
Combien de fois ai-je pensé que j'allais me faire agresser ? Je me rappelle d’une instance… ou deux. Et chaque fois, je m’étais blâmée. Je m’étais traitée de stupide. Parce que je n’avais pas anticipé le danger. Je n’avais pas réfléchi aux pièges possibles. Quelle fille oserait marcher le soir pour regagner son auto garée non loin, après une fête au Métropolis à Montréal, sans s’attendre à être abordée par un soulon ? Quelle fille irait à un dîner professionnel au restaurant avec une vieille connaissance, un homme respecté qui avait l’âge de son père, sans se douter qu’il essaierait de la coincer dans le stationnement après le repas? J’avais été naïve et insouciante, un peu comme l’étourneau qui ne s’est pas envolé assez rapidement à l’approche du gros minet. Heureusement, dans les deux cas, j’avais réussi à m’en sortir, sans conséquence. Je n’ai eu droit qu’à des bonnes frousses.
Oui, mon réflexe initial à la suite de ces incidents a été de me faire des reproches. Quand j’y repense, j’en frémis de colère. Pourtant, je n’avais rien fait de répréhensible et je n’avais surtout pas été aguichante, ni provocante. Alors, pourquoi m'en vouloir à moi-même? Et si l’innommable s’était produit, aurais-je eu le courage de dénoncer et de porter plainte? Est-ce que j’aurais simplement passé l’éponge et tenté de faire comme si de rien n’était ? Est-ce que j’aurais supporté le poids d’une expérience traumatisante pendant des années ?
Évidemment, outre ces incidents, j’en ai entendu des remarques chauvines, des blagues de «mononcle» et des commentaires crus, au fil des ans ! Oui, on m’a lancé des sifflements et des remarques odieuses lorsque je passais près de groupes d’hommes dans des lieux publics et oui, j’ai dû repousser des mains baladeuses. Si j’ai souvent réagi en protestant haut et fort, en paroles comme en gestes, j’ai aussi, hélas trop de fois, gardé le silence et feint l’indifférence. Par exaspération. Par peur. Par impuissance. Par découragement.
C’est normal, direz-vous ! Mais, normal pour qui ?
Quand je vois un bel homme déambuler dans la rue, je ne me mets pas à le suivre, à lui siffler après et à lui faire des commentaires déplacés ! Quand je vois un gars au torse nu ou au pantalon ajusté, faisant ainsi l’exhibition de ses muscles ou autres atouts, je ne lui saute pas dessus «parce qu’il est sexy et par conséquent, je suppose que c’est ce qu’il veut». Je n’essaie pas de mettre de la drogue dans son verre pour pouvoir abuser de lui.
Des femmes le font, me direz-vous.
Oui. Mais beaucoup moins, selon les statistiques. Je ne les excuse pas davantage. Mais si vous faites des recherches, vous constaterez que c’est plutôt rare. La majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes… Et les victimes sont souvent des femmes, des enfants, et aussi des hommes.
Ah, mais c’est parce que c’est dans la nature des hommes, me diront certains.
Alors là, je ne suis pas du tout d’accord.
Tous les hommes n’agissent pas ainsi. Je refuse de les mettre tous dans le même panier, en disant que c’est dans leurs gênes. Nombre d’entre eux sont respectueux, civilisés, réfléchis. En fait, je connais beaucoup d’hommes qui dénoncent les comportements sexuels déplacés. Les déplorent. Les condamnent. Et ce n’est pas un décolleté plongeant, une jupe courte ou la vue d’un peu de peau qui les fera dérailler et les fera agir en hommes des cavernes.
L’instinct, dans certaines instances, c’est crucial. L’instinct de survie, face à un grand danger, par exemple. Cependant, le savoir-être et le savoir-agir, le respect d’autrui, c’est tout aussi important, et Dieu merci, cela s’apprend. Les saines relations entre un homme et une femme aussi. Cela s’apprend à la maison, à l’école, et en société. Aucun statut social, aucune fortune, aucune gloire, aucune profession ne donne le droit à un homme d’agresser, abuser ou de harceler une autre personne. C’est pourquoi il faut en parler, éduquer, donner l’exemple aux jeunes garçons, dénoncer, remettre à leur place les gens de notre entourage qui ont des comportements inacceptables.
Car contrairement aux autres espèces sur terre, l’être humain a été pourvu de la capacité de raisonner et d’exercer un jugement. Il est apte à réfléchir avant d’agir. Il peut distinguer le bien du mal. Il éprouve des émotions certes, mais à défaut de les contrôler, il peut les analyser et il n’est pas obligé de laisser ce qu’il ressent dicter sa conduite. Un être humain peut lire et apprendre, tirer des leçons du passé, philosopher, changer. Lorsqu’il ne le fait pas, lorsqu’il laisse son instinct le plus primitif guider son comportement, lorsqu'il laisse ses pulsions prendre le dessus, ne se condamne-t-il pas à n’être rien de mieux qu’un animal?
J’oubliais… Pour ceux qui se le demandent : à notre grand soulagement, l’oiseau que Cabotine a attaqué a finalement repris ses esprits et après s’être reposé, il s’est envolé rejoindre les siens, quelques heures plus tard. Comme quoi, il y a toujours de l’espoir, même pour les victimes d'un prédateur!
L'oiseau s'est envolé après s'être remis de son choc traumatique.
La leçon de Verena
Note : J'ai modifié le véritable prénom de l'élève dont il est question dans ce récit.
Le premier jour, telle une brise parfumée chassant un long hiver, elle s’est introduite dans ma classe d’un pas sautillant, le regard à la fois curieux et espiègle. Quand je l’ai saluée, elle m’a gratifiée d’un sourire timide et d’un signe de tête à peine perceptible, en guise de bonjour. Elle s’est dirigée vers le dernier pupitre, au fond, et y a pris place.
Une fois toutes les chaises occupées, j’ai scruté les visages qui me guettaient. J’avais devant moi ma troisième cohorte de femmes immigrantes. Les traits de chacune variaient selon leur origine, leur âge et leur vécu. Au cours des prochains mois, j’allais les côtoyer et leur enseigner la bureautique afin qu’elles puissent, ultérieurement, intégrer le marché du travail québécois. En bref, je leur donnerais un peu de moi-même.
Grâce à mon expérience avec les groupes précédents, et parce que je m’étais déjà moi-même expatriée pour les études, je me doutais que ces femmes possédaient une certaine force, une détermination, sinon une grande résilience. Une réelle vulnérabilité aussi. J’éprouvais donc d’emblée une sincère admiration pour mes nouvelles élèves.
Afin de briser la glace, je leur ai demandé de se présenter, de me parler d’elles, de leur expérience de travail. Une à une, avec un mélange de fierté et de pudeur, elles se sont prêtées à l’exercice.
Et finalement, bonne dernière, celle qui m’avait intriguée dès son entrée, s’est redressée sur sa chaise en passant rapidement une main dans ses cheveux noirs tressés finement et noués sur sa nuque. C’était son tour. J’ai vu son visage d’ébène s’éclairer et une profonde inspiration gonfler sa poitrine avant qu’elle ne révèle, d’une voix étonnamment sonore : «Je m’appelle Verena et je suis venue du Rwanda. J’ai travaillé dans un bureau, il y a longtemps, mais je ne connais rien aux ordinateurs.»
Son français avait une note exotique. Ses grands yeux marron brillaient d’un air ravi. En deux courtes phrases, elle croyait m’avoir résumé sa vie. Et pourtant… Quels secrets cachait ce sourire si contagieux ? J’étais consciente, du moins vaguement, de ce qui s’était passé au Rwanda dans les années 1990. Dans quelles circonstances avait-elle atterri au Québec ? Je n’osai le lui demander. Par délicatesse. Par respect. Je savais bien qu’il lui fallait d’abord nous apprivoiser. Établir un lien de confiance. Mon rôle auprès de toutes ces femmes consistait à leur transmettre mes connaissances, à les amener à développer des compétences nouvelles. Toutefois, je savais qu’un jour je connaîtrais une partie de leur histoire.
En peu de temps, Verena est devenue celle que tout le groupe admirait. En élève assidue, elle écoutait attentivement, participait activement aux cours et faisait de rapides progrès. L’ordinateur n’était plus une bête à dompter, c’était maintenant son allié. Comme une fleur qui étend ses pétales, elle s’est épanouie et ses interventions timides du début ont cédé la place à des réparties empreintes d’un délicieux sens de l’humour, à la fois candide et perspicace. Ses collègues aimaient la taquiner, sûrement dans l’espoir de faire retentir son rire magnifique.
Peu à peu, elle s’est dévoilée, livrant des pans de son passé. À l’aube de la quarantaine, Verena était la mère de quatre garçons, qu’elle élevait seule. Son benjamin n’avait pas encore dix ans. Quelques années plus tôt, elle était montée avec sa progéniture dans un avion, quittant le continent africain pour traverser l’Atlantique, et était descendue des heures plus tard à Montréal, en plein hiver. Elle n’oublierait jamais le froid mordant de janvier qui l’avait accueillie, le tapis de neige qu’elle avait foulé de ses souliers de toile à son arrivée. Elle nous raconta d’un ton amusé ses impressions initiales de Montréal : les arbres aux branches sans feuilles, l’accent incompréhensible des Québécois, les immenses centres commerciaux, ses premières balades en métro, et l’étrangeté d’avoir à revêtir un manteau et des bottes qui lui donnaient la sensation d’avoir pris cinq kilos !
Le récit de Verena correspondait à ceux de ses collègues de classe. Elles avaient toutes tourné le dos à leur patrie dans l’espoir de trouver mieux, avaient survécu au choc du premier hiver, avaient dû s’accoutumer à un autre style de vie. Probablement pour ces raisons, une touchante camaraderie s’était développée entre les femmes du groupe. Les voir s’entraider et s’encourager, interagir, indépendamment de leur origine ou de leurs croyances, ravivait ma confiance en l’humanité. Elles étaient venues de divers coins de la planète, certaines laissant derrière elles des conditions atroces, mais elles avaient toutes cette volonté de s’intégrer et de faire du Québec leur chez-soi. Je les admirais et, en contrepartie, je sentais qu’elles me considéraient chaque jour davantage comme une guide ou une grande sœur.
C’est peut-être parce que le climat était devenu propice aux confidences qu’un jour, Verena a enfin consenti à nous raconter le drame qu’elle avait vécu au Pays des mille collines. Je me souviens encore de ce moment ; nous étions toutes assises dans la cafétéria autour de la belle Rwandaise qui, la voix posée et les traits sereins, nous relata les tristes événements qui l’avaient amenée jusqu’au Québec.
Au Rwanda, Verena habitait avec son mari dans un village au nord-ouest de Kigali, la capitale. « Nous avions une belle vie : trois fils, un quatrième enfant en route, une jolie maison, un grand jardin et un élevage de chèvres ». Au printemps 1994, tout a basculé. Le bruit courait que des rebelles hutus assassinaient des gens, principalement des Tutsis, comme eux. Verena et son mari s’inquiétèrent au plus haut point. Ils se savaient en danger. Ils élaborèrent des plans pour fuir en toute sécurité. Mais un matin, avant l’aube, alors que son mari était parti s’occuper de ses chèvres, Verena apprit que des Hutus du village allaient de maison en maison, tuant sans ménagement tous les Tutsis qui s’y trouvaient. Terrifiée, elle tira ses trois jeunes fils du lit et leur ordonna d’aller se réfugier chez leur marraine, qui habitait le village voisin.
Verena ne voulait pas s’enfuir sans son époux. Elle l’attendait seule dans la maison lorsque des miliciens s’introduisirent de force en brandissant leurs machettes sanglantes. Transie de peur, elle s’appuya contre un mur, attendant avec résignation qu’on la tue. Elle avait entendu des histoires horribles, qu’on éventrait les femmes enceintes, sans pitié. Haletante, elle lorgna les hommes de son propre village qui la menaçaient, pendant que d’autres allaient d’une pièce à l’autre à la recherche des membres de sa famille, tout en cassant ou en pillant des objets au passage. C’est à ce moment que son mari entra dans la demeure en coup de vent. En moins de quelques secondes, un milicien lui assena de violents coups de machette, puis lui trancha la gorge, sous les yeux de Verena. «Je n’ai jamais su pourquoi, mais j’ai été épargnée. J’ai entendu l’un des hommes dire qu’il ne voulait pas me tuer parce que, puisque je portais un enfant, cela le condamnerait au malheur. Je suppose que sa superstition a été ma planche de salut. Ils sont donc partis après avoir tout saccagé dans ma maison, laissant mon mari, mort, baigner dans son sang.»
Un grand silence est tombé. Je voyais l’horreur sur les visages des autres élèves, qui avaient écouté Verena sans l’interrompre. Certaines essuyaient furtivement les larmes qui sillonnaient leurs joues. Je ressentis moi-même un frisson me secouer et une boule se loger au fond de ma gorge. «J’ai ramassé le peu d’effets de valeur que j’ai pu réchapper, puis j’ai couru me cacher dans les bois. Après plusieurs heures, j’ai réussi à rejoindre mes fils. Je savais que nous étions toujours en danger. Nous devions quitter le Rwanda. Nous avons donc marché, et marché encore. Des jours plus tard, nous sommes arrivés à la frontière du Zaïre et nous nous sommes retrouvés dans un camp de réfugiés.»
C’est au camp de Goma, au Zaïre, que Verena a donné naissance à son quatrième fils.
«Le camp, c’était horrible», dit-elle dans un soupir éloquent. La peur l’avait tenaillée sans relâche : les conditions insalubres, la propagation de maladies contagieuses, les vols, les femmes abusées, la faim régnaient dans ce milieu hostile. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Elle ne s’accrochait qu’à une seule pensée : survivre jusqu’au lendemain. Demain, tout irait mieux. «Et puis, un jour, j’ai appris que mes fils et moi allions partir pour le Canada. Nous étions sauvés.»
Verena avait vécu l’horreur ; néanmoins, même en nous racontant son effroyable histoire, elle souriait avec bienveillance et exhalait une paix intérieure enviable. En véritable battante, sans jamais perdre espoir, elle avait bravé tous les périls et franchi chaque obstacle pour mener ses enfants à l’abri du danger, vers une vie meilleure. S’il subsistait quelques meurtrissures, vestiges de son passé, si elle ressentait d’innombrables inquiétudes pour l’avenir dans son pays d’accueil, elle le dissimulait fort bien. Elle se tournait vers le futur avec philosophie. La vie n’était-elle pas un éternel combat ? Pour elle, le bonheur se trouvait dans chaque effort et dans les petites victoires qui en résultaient.
J’ai su, quelques années plus tard, que Verena s’était remariée et qu’elle était partie s’établir en région avec sa famille. Je me suis réjouie, car j’avais la certitude qu’elle serait heureuse dans cette nouvelle vie.
Le rire et l’immuable optimisme de Verena m’habitent encore aujourd’hui. Je lui ai enseigné la bureautique, mais j’ai beaucoup appris d’elle sur le plan humain. Quand je traverse une épreuve ou que je suis tourmentée par des idées sombres, je songe à cette femme courageuse, je revois son magnifique visage, et je l’entends me chuchoter : «Demain, tout ira mieux.»
Et parce qu’elle est la preuve vivante que l’hiver finit par céder sa place au printemps, je l’écoute.
Capitaine en situation de crise
J’ai occupé un poste en direction d’établissement scolaire pendant trois ans, dans un centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Je dis souvent – parce que j’en suis profondément convaincue – que cela a été l’expérience la plus intense que j’ai vécue. La plus exigeante aussi. Et la plus humaine.
Comme un capitaine de navire, une personne en direction d'école doit garder le cap, encourager les membres de son équipage, miser sur les compétences de chacun et les amener à se dépasser lorsque nécessaire. Elle doit s’assurer que tout fonctionne rondement : que les machines tournent à fond, que les instruments de navigation soient précis, que la coque demeure intacte, que les aires du bateau restent propres, que les gens à bord soient bien nourris, en sécurité et en santé, et que les communications internes et externes restent fluides. Un bon capitaine garde également l’œil sur les prévisions du temps. Il tentera par tous les moyens d’éviter une tempête ; sinon, il aidera son équipe à l’affronter et à passer au travers sans trop de dommages collatéraux.
Mais hélas, la mer est souvent imprévisible. Et la vie dans un établissement scolaire peut l’être tout autant. C’est ainsi que j’ai eu à gérer quelques situations de crise pendant mon mandat, certaines plus dramatiques que d’autres.
Mon père, qui a lui-même été directeur d’école, me disait souvent : quand une poignée de porte est brisée, ou qu’une toilette est bloquée, tu peux apposer une affiche «défectueuse» dessus et attendre que quelqu’un vienne effectuer la réparation. Mais quand un être humain arrive dans ton bureau parce qu’il vit quelque chose de difficile, tu ne peux pas lui mettre une étiquette «défectueux» dans le front et lui dire de revenir le lendemain.
Il avait évidemment raison. Que ce soit un élève, un membre du personnel, ou un parent, quand une personne en état de crise se manifeste, le reste devient futile. On laisse tout tomber et la gestion de la crise devient notre priorité.
Un élève en situation d’échec sur le point d’abandonner ses études, un enseignant qui vient d’apprendre qu’il a un cancer à un stade avancé, une autre qui vient de perdre son conjoint, une secrétaire qui pleure le décès de sa petite-fille… Peu importe l’heure, s’ils ont besoin de te parler, ton bureau devient leur refuge et ton écoute empathique est leur planche de salut.
Quand une de nos élèves, une jeune fille d’origine afghane au début de la vingtaine, brillante et déterminée, est décédée, il aurait fallu mettre en place des mesures pour que ses collègues de classe et les membres du personnel puissent ventiler. Mais à l’époque, les ressources de soutien psychologique étaient inexistantes, particulièrement à l’éducation des adultes. Je me rappelle le lourd sentiment de tristesse que l’on ressentait partout dans le centre, les visages sombres, le sentiment d’impuissance du personnel… C’était le genre de situation qu’on ne nous apprenait pas à gérer sur les bancs de l’université. C’est avec notre compassion, notre ouverture, notre patience et notre bienveillance qu’on arrivait à panser les plaies et à faire passer l’orage.
Mais il y a eu d’autres situations qui ont fait monter mon niveau d’adrénaline. Un établissement scolaire est une microsociété où de petits miracles se produisent chaque jour, mais où des drames peuvent aussi survenir à tout moment et nous rappeler que l’équilibre est fragile. Oui, il y a ces moments où on se dit : «Ouf, on l'a échappé belle! » Laissez-moi vous partager quelques souvenirs les plus marquants.
Les lutteuses
L’heure du dîner approche et je grignote en finalisant un rapport. Mon téléphone se met à sonner. Je réponds entre deux bouchées pour apprendre que des élèves sont en train de se battre dans la salle de toilettes des femmes. J’enlève mes souliers à talons, je relève ma jupe et je me mets à courir dans le corridor. J’arrive juste au bon moment : les deux femmes s’échangent de solides coups, elles se tirent les cheveux et l’une des protagonistes est sur le point de cogner la tête de l’autre sur un lavabo. Je l’ai retenue juste à temps et j’ai évité le pire. J’ai réussi à séparer les deux tigresses, à les calmer, et une longue suspension leur a permis de prendre du recul et décolérer.
Le joueur de baseball et le constructeur de bombe
Un élève, un jour, dit
ouvertement à son enseignant qu’il venait suivre des cours d’informatique à l’éducation des adultes pour une raison très spécifique : il voulait apprendre à construire une bombe et faire sauter
le centre. Sa carrière parmi nous fut évidemment de courte durée. Il avait le mérite d’avoir un objectif de formation précis, mais nous ne dispensions que des cours de Word, Excel, Access, pas de «construction
de bombe 101» !
Puis, un certain mois de novembre, un enseignant inquiet vient me confier qu’un de ses élèves se promène avec un bâton de baseball dissimulé sous un pan de son imperméable. J’exige qu’il me l’amène à mon bureau. L’élève ne se fait pas trop attendre. Il se pointe dans l’aire administrative avec un petit air arrogant, une mèche de cheveux blonds lui masquant les yeux, et de toute évidence, il tient quelque chose contre lui sous son manteau gris. Ma secrétaire est nerveuse : et s’il devenait violent dans mon bureau ? S’il m’assénait un solide coup de bâton sur la tête ? Elle se tient prête à composer le 911. Étonnamment, je n’ai pas peur.
Il entre dans mon bureau et se tient debout devant moi en fixant le sol. Calmement, je lui demande son nom. Il me répond d’une voix assurée. Du moment que j'ai repéré son dossier dans ma base de données, je lui dis :
«Je sais que tu caches un bâton sur toi. Je vais te demander de le sortir doucement et de le déposer tranquillement sur mon bureau. »
Il hésite, puis d’un ton frondeur me rétorque qu’il ne cache rien.
Je répète ma demande. Et il s’exécute : le bâton de baseball fait son apparition.
Les alertes d’incendie
Comme c’est souvent le cas, notre centre d’éducation des adultes partageait les bâtiments d’une école secondaire. Il est arrivé à quelques occasions que des petits plaisantins du secteur des jeunes aient déclenché de fausses alarmes d’incendie. Évidemment, je ne pouvais prendre aucune chance, et chaque fois, en dépit de la pluie, de la neige ou du temps froid, je faisais donc évacuer mon centre. Or un jour de juin, le technicien informatique m’informe qu’il y le feu sur le toit du portique. Je me précipite à une fenêtre, et je constate que c’est un dictionnaire qui est en train de brûler tranquillement. Un jeune l’y a probablement lancé après y avoir mis le feu. Comme c’est la semaine des examens de fin d’année du Ministère, déclencher l’alarme aurait des répercussions énormes. Je cours donc vers le placard du concierge, je prends son escabeau et un seau que je remplis d’eau et je m’improvise pompier : sous le regard incrédule du technicien informatique, je grimpe et j’éteins le feu. Le toit est sauvé et la session d’examens ne sera pas perturbée par une alarme injustifiée.
Le confinement
Un jour, en fin d’avant-midi, les policiers débarquent à mon centre. Ils ont reçu l’appel d’un homme qui menaçait de tirer sur les élèves d’une école de Chomedey, sans évidemment préciser laquelle. Impossible de savoir si notre centre d’éducation des adultes est ciblé ou non. On ne peut prendre aucune chance : après les fusillades de la Polytechnique et de l’université Concordia, ces menaces sont considérées comme sérieuses et je dois mettre en place l’ordre de confinement. Aucun élève, aucun membre du personnel ne peut entrer ou sortir du centre, tout le monde doit s’enfermer dans les locaux, loin des fenêtres. Les policiers ont envahi le terrain. C’est l’incompréhension totale, pour ne pas dire le chaos. Mon téléphone cellulaire ne dérougit pas. C’est la première fois qu’on doit se confiner, et je constate que nous ne sommes pas bien préparés. L’attente est horrible. Il y a quelques élèves qui s’insurgent : ils doivent aller travailler après le diner et s’ils ne se présentent pas, leur employeur risque de les congédier. Je réussis à calmer les esprits. La sécurité avant tout ! Heureusement, la menace a vite été écartée, le confinement n’a duré qu’un peu plus d’une heure.
Le conjoint violent
Le jeune homme est tombé dans le piège. Dès qu’il a mis les pieds à la réception, les policiers se sont précipités sur lui et lui ont passé les menottes. C’était la première fois que j’assistais à une arrestation musclée. C’est un peu stressant, je vous assure !
Traiter avec une clientèle adulte signifie qu’il faut gérer des problèmes d’adultes. Aider des femmes victimes de violence conjugale en faisait partie. La plupart du temps, le conjoint demeurait un être anonyme pour moi, un inconnu. Sauf, s’il se présentait au centre... Un jour, j’apprends que l’ex-conjoint d’une de nos élèves erre dans les corridors alors qu’une ordonnance restrictive de protection l’oblige de rester à plus de 750 mètres de distance de la jeune femme. Il la cherche partout, demande à tout le monde si on sait où elle se trouve. Je compose le 911 et j’explique la situation. Quelques minutes plus tard, des agents en auto banalisée se présentent au centre et ils me demandent d’attirer l’homme dans mon bureau. Un enseignant se porte volontaire d’aller à sa rencontre et lui faire croire que son ex-conjointe est dans l’aire administrative.
Le réseau clandestin
Depuis quelques temps, nous avions remarqué que la section de notre stationnement la plus éloignée du centre était souvent remplie d’autos, particulièrement en fin d’après-midi ou le soir. C’était intrigant, d’autant plus que le stationnement était plutôt vide à ce moment de la journée et que les élèves de soir avaient tendance à garer leurs autos le plus près possible de la porte d’entrée. Nous avons donc commencé à surveiller de plus près les activités qui se déroulaient dans notre stationnement. En fin de journée, effectivement, des hommes stationnaient leur auto et après être demeurés derrière leur volant pendant quelques minutes, ils sortaient discrètement de leur véhicule pour se diriger vers un boisé non loin. J’ai immédiatement pensé à un réseau de trafic de drogue. J’en parle à mon patron qui se met, lui aussi, à épier le petit manège qui se trame dans notre stationnement. Nous décidons d’appeler la police qui assigne une équipe de surveillance et quelques jours plus tard, une arrestation a lieu : il s’agissait en fait d’un réseau de prostitution. Dans le boisée, les policiers trouvèrent des matelas, des divans et nombre d’hommes les culottes baissées. L’histoire ne dit pas si le chasse-moustique était fourni !
Onde de choc
L’événement qui a certainement suscité beaucoup d’émotion a été la fusillade au cégep de Dawson. Puisque notre centre était rattaché à une commission scolaire anglophone, beaucoup de nos anciens élèves poursuivaient leurs études à ce collège.
Avec les cellulaires et l’Internet, la nouvelle de la fusillade a été apprise et suivie en instantané. Beaucoup avaient une connaissance, un ami, un frère ou une sœur qui étudiaient à Dawson. Certains membres de mon personnel y avaient un fils ou une fille. Ma propre nièce fréquentait ce cégep. J’ai appris plus tard qu’elle se trouvait dans la cafétéria au moment même où les coups de feu ont été tirés et qu’elle avait réussi à se sauver en courant. Dans mon centre, il y eut une grande vague d’effroi, d’inquiétude et de panique. De la consternation aussi. J’allais de classe en classe, et je voyais les enseignants consoler, rassurer, écouter les élèves en état de choc. Des membres de mon personnel se sont réfugiés en larmes dans mon bureau, inquiets pour leurs proches. Nous nous sentions tous vulnérables parce que cet événement nous touchait de près.
* * *
Une fois le bâton sur mon bureau, je le prends et le pose derrière moi, au sol. Le jeune proteste. Quand je sollicite une explication, il hausse les épaules et me répond, agacé, que c’était son déguisement d’Halloween. Je lui fais remarquer que l’Halloween est passée et que son déguisement est de mauvais goût. De toute évidence, il n'avait aucunement l'intention de jouer au baseball. Je consulte son dossier à l’ordinateur : il n’a que 17 ans. Comme il est mineur, j’appelle sa mère qui arrive une trentaine de minutes plus tard, dans tous ses états. Nous avons une sérieuse conversation et elle repart avec fiston qui est évidemment suspendu. Je n’ai jamais revu ce garçon. Il faut croire qu’il avait des défis plus sérieux à surmonter que la poursuite de ses études.
Quand je vous disais que ces trois années avaient été intenses !
La communiste, Ferdinand et Patof
J'ai toujours dit que le respect n'est pas quelque chose que l'on doit, mais plutôt quelque chose qui se gagne. À l’école, j’étais généralement une élève sage et appliquée, pour ne pas dire une élève modèle. Je savais que mes parents n’auraient jamais toléré que je sois tannante ou paresseuse : l’éducation était une priorité chez nous, et j’avais intérêt à bien me comporter en classe et à étudier. Heureusement, comme j’aimais apprendre, je m’investissais volontiers dans mes travaux scolaires. Par ailleurs, parce que j’étais grande et sage, on me plaçait invariablement à l’arrière de la salle. Je le précise, car il était difficile de faire le pitre quand tous mes camarades me tournaient le dos.
J’étais donc, somme toute, tranquille, studieuse et attentive. Je participais aux discussions, je faisais mes devoirs, j’avais de bonnes notes et je peux compter sur les doigts d’une main les fois où j’ai été indisciplinée. Bref, j’ai eu un parcours sans histoire.
J’ai bien fait quelques coups pendables hors des salles de cours, surtout quand j’étais avec mes amies, mais la plupart du temps, il s'agissait de gestes un peu puérils et sans conséquence. Il faut bien que jeunesse se fasse ! Par exemple, un après-midi, en revenant de la salle d’études, nous avions mangé tous les biscuits que la responsable du service de l’audiovisuel avait disposés sur un plateau à l’entrée de son bureau, à l’intention de ses visiteurs. Une autre fois, nous avions convaincu une surveillante de nous laisser regarder un épisode du téléroman Another World à la télévision lui faisant croire que c’était requis dans le cadre de notre cours d’anglais. Lors d’une fête de classe qui avait eu lieu pendant l’heure du dîner, deux de mes amies et moi avions apporté des petits gâteaux faits maison pour nos camarades. Une fois qu’elles eurent tout mangé, nous leur avons fait croire que les gâteaux contenaient un laxatif, ce qui était faux, bien entendu. Nous avons bien ri quand, pendant les cours de l’après-midi, des élèves se sont mises à courir aux toilettes en se tenant le ventre. L’effet placebo, sans doute !
À l’université, la majorité de mes professeurs imposaient le respect. Ils étaient brillants, expérimentés, et d’excellents pédagogues. Je buvais leurs paroles, je prenais frénétiquement des notes, je faisais mes lectures avec intérêt et j’avais le sentiment qu’en suivant leurs cours, je devenais une meilleure personne. Mais il y en a tout de même quelques uns que j’aurais volontiers envoyés à la retraite ! Je pense à mon professeur de Relations internationales, un docteur en sciences politiques, originaire de la Corée du sud. Nous ne comprenions pas un traitre mot de ses exposés. Comme il avait une voix éteinte, nous lui avions procuré un micro, ce qui améliora un peu la situation. Mais hélas, son accent fort prononcé, nous forçait à lui demander de répéter ou d’écrire le trois quart de son cours au tableau. C’était sans compter les fautes d’orthographe et de syntaxe qui rendaient ses résumés et questions d’examen illisibles.
Un jour, il a affirmé pendant un de ses cours que les pays au climat tempéré avaient un avantage en temps de guerre. J’ai osé levé ma main : «mais Docteur, l’histoire ne prouve-t-elle pas le contraire ? Napoléon a sous-estimé l’hiver russe, les allemands aussi lors des guerres mondiales, et les américains ont peiné dans la chaleur tropicale du Vietnam… Et puis, avec les armes nucléaires, est-ce que le climat est un facteur si déterminant ?» J’aurais dû rester tranquille dans mon coin et garder le silence. Le professeur s’est mis dans une terrible colère, il m’a lancé sa craie en criant que j’avais tord, et il m’a traitée de communiste parce que je portais un chandail rouge cette journée-là ! Je n’ai plus osé lever ma main du reste de la session !
Je dois tout de même admettre que je n’ai jamais été aussi dissipée que dans mon cours de linguistique. Il faut dire que le professeur, que nous avions surnommé Patof en raison de sa coiffure qui ressemblait en tout point à celle du fameux clown de Télé-Métropole, avait de grandes lacunes en pédagogie.
Il parlait comme s’il allait faire de l’hyperventilation à tout moment, il était désorganisé, il radotait, et son cours était aussi soporifique que le plus efficace des somnifères. Un jour, il est arrivé plus de vingt minutes en retard au cours. Nous nous apprêtions d’ailleurs à partir quand il a surgi dans le local, en sueur, sa couronne de cheveux en bataille, le souffle court, brandissant sa mallette en faux cuir. «Vous ne croirez jamais ce qui m’est arrivé» dit-il d’un air dramatique. Et le voilà qu’il nous raconte, le plus sérieusement du monde, une histoire abracadabrante. En conduisant de la Rive-sud vers l’université, il s’était aperçu, alors qu’il traversait le pont Champlain, qu’il n’avait pas sa mallette à côté de lui. Il fut aussitôt pris de panique, car il croyait l’avoir oubliée sur le toit de son auto et elle contenait nos travaux de mi-session corrigés! Ainsi, il s’était mis à la recherche de la mallette perdue, refaisant son trajet en sens contraire, regardant le long des routes s’il n’y avait pas des feuilles de papier égarées en train de voler… Finalement il l’avait retrouvée intacte, chez lui, dans son garage ! Évidemment, il ne s’était pas attiré beaucoup de sympathie avec son histoire. En fait, il nous avait confortés dans notre choix de surnom : Patof lui convenait en tout point.
La gestion de classe de Patof était assurément défaillante. Il n’avait aucun contrôle, aucune organisation et par conséquent, nous, ses étudiants, ne l’écoutions pratiquement pas.
Mes trois amies et moi étions toujours assises à l’arrière de la classe. Nous avions pris l’habitude de nous relayer pour la prise de notes. Ainsi pendant qu’une avait la tâche d’écouter et écrire ce qui pouvait s’avérer important, les trois autres se permettaient de lire, faire des travaux pour d’autres cours, de jaser ou rigoler tout simplement. Patof nous avertissait à l’occasion. «Les mousquetaires en arrière, parlez moins fort !»
Il y eut un cours où nous fûmes particulièrement tannantes. Il nous avait déjà averties à quelques reprises, mais nous étions tellement habituées à sa mollesse que nous avions à peine calmé nos rires. Cependant, à notre grande surprise, cette fois-là, il s’impatienta :
«Ok en arrière, vous n’avez rien écouté depuis le début du cours, c’est assez !»
Pendant quelques secondes, nous croyions qu’il allait nous expulser de la classe.
«Vous vous pensez bien fines, vous croyez tout savoir, alors donnez donc le cours à ma place pour voir ! Tenez, parlez-moi donc de Ferdinand de Saussure !»
Il espérait nous avoir cloué le bec avec sa stratégie, et en vérité, cela a failli fonctionner, car mes trois camarades furent effectivement saisies. Mais pauvre Patof ! Il ignorait que, quelques mois auparavant, j’étais allée en Suisse et j’avais visité le campus de l’université de Genève où il y avait une exposition fort intéressante sur le fameux linguiste, Ferdinand de Saussure. J’avais d’ailleurs rapporté des feuillets contenant une foule d’informations sur ses théories, ses ouvrages. S’il avait demandé de parler de n’importe qui d’autre, j’aurais été embêtée. Mais de Saussure ? Je connaissais sa vie et son œuvre de A à Z. Je me suis donc levée et j’ai fait un exposé de trente minutes sur Ferdinand. Lorsque j’ai eu fini de parler, mes collègues de classe se sont levés et ont applaudi. Patof, sonné, balbutia que je lui avais appris des faits qu’il ne connaissait pas.
Je l’avais échappé belle. Mais, tel était pris celui qui croyait prendre… Il ne m’a plus jamais demandé de donner le cours à sa place.
Plus tard, lorsque je suis moi-même devenue enseignante, j’ai eu une pensée pour tous ces enseignants et professeurs que j’avais un peu malmenés, surtout quand j’ai moi-même été confrontée à des élèves rebelles. Par contre, je ne me suis jamais présentée devant une classe sans être préparée et organisée. Mes élèves disaient de moi que j’étais une main de fer dans un gant de velours.
J’avoue que je préférais avoir cette réputation plutôt que de me faire affubler le nom d’un clown!
Le travail d'équipe
Lorsque j’étais étudiante, je détestais les travaux d’équipe. Pourtant, les gens qui me connaissent bien vous confirmeront que je suis loin d’avoir une personnalité asociale, que je suis une personne ouverte avec un grand esprit de collaboration.
Néanmoins, je pestais toujours du moment que je voyais dans un plan de cours qu’un travail d’équipe était requis, particulièrement à l’université. La plupart du temps, nous nous retrouvions jumelés à des collègues que nous connaissions à peine, qui demeuraient dans des régions différentes et qui avaient tous des horaires impossibles à concilier. Bien souvent, nous finissions par nous rencontrer les dimanches sur le campus, et encore, il manquait toujours au moins un membre de l’équipe… et jamais le même, d’une fois à l’autre! Mais pire, le travail finissait rarement par être divisé et exécuté de façon équitable. Inévitablement, certains membres de l’équipe devaient mettre davantage l’épaule à la roue afin que le train avance, alors que les autres maîtrisaient l’art de rester léthargiques – ou invisibles – jusqu’à la fin. Combien de fois ai-je vu des échéanciers non respectés, une date de remise approcher sans que nous ayons vu la partie d’un des collègues? Ou constater qu’une section du document avait été bâclée ou que le texte était truffé de mille fautes d’orthographe ?
Je me rappelle qu'au programme d’études supérieures, j’avais choqué un des mes professeurs quand je lui avais demandé s’il était possible d’être en équipe de «un»! Étonné, il avait demandé à me voir à la fin du cours. Je lui ai expliqué que je préférais rédiger seule un rapport de 60 pages que de me casser la tête avec les rencontres d’équipe. Il a refusé d’accéder à ma demande, sous prétexte que le but des travaux d’équipe était de m’apprendre à travailler avec les autres… Je trouvais l’argument faible! Après deux baccalauréats, et plus de vingt ans sur le marché du travail, j'avais quand même développé une certaine expérience en travail d'équipe. Je suspecte qu’il voulait plutôt s’épargner des heures de correction à la fin de la session…
Je ne suis pas perfectionniste, mais j’ai été élevée avec le principe que «tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait». Le bonheur est dans l’effort et au fil des ans, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j’ai eu le privilège – n’en déplaise à tous mes anciens professeurs d’université – de collaborer avec des coéquipiers de grand talent qui, comme moi, ne comptaient ni leurs heures ni leurs énergies pour mener à terme de superbes projets.
Je me rappelle de séances de remue-méninges particulièrement créatives! Quand je travaillais pour une firme de recrutement, mon équipe et moi avions conçu des campagnes de publicité originales visant certains types de clientèle afin de faire connaître nos services. Par exemple, nous avions acheminé aux services de ressources humaines de compagnies pharmaceutiques des pots de fausses pilules (des bonbons, en réalité) avec la prescription «lorsque vos problèmes de personnel vous donnent des maux de tête». La rétroaction des clients avait été éloquente.
Alors que je travaillais en éducation, j’ai planifié et organisé nombre d’événements avec des collaborateurs absolument extraordinaires : les soirées de graduation des élèves, les activités du club social, la mise sur pied de programmes divers, les sessions de formation, les événements promotionnels, des journées pédagogiques, des colloques de grande envergure. Ma plus grande joie était de voir chaque membre de l’équipe mettre sa créativité, ses talents et ses compétences à profit, contribuer à relever les défis et livrer les mandats qu’on nous confiait, développer des partenariats, mais surtout d’être constamment en mode solution. Quelle satisfaction de voir les projets prendre forme, de pouvoir se réjouir du résultat final et des retombées et surtout, de ressentir la fierté de toute l’équipe.
Ces expériences ont été la source de belles amitiés. Si mes coéquipiers et moi étions différents, nous avions la même vision, nous partagions nos idées avec respect, nous favorisions la complémentarité de nos talents, et nous nous soutenions sans relâche. Mais le plus important, c’est que nous avions surtout du plaisir à travailler ensemble. J’entends encore les incontrôlables fous rires en fin de journée, les commentaires hilarants lors des rencontres, les éclats de joie quand on réussissait un bon coup, les encouragements quand tout n’allait pas rondement. Je ressens encore toute l’émotion et l’espoir qui nous habitaient, comme par exemple, à la fin du Relais pour la vie que nous avions fait à Terrebonne pour soutenir notre collègue atteinte d’un cancer. Et quand je vois mes enfants qui sont aujourd’hui de beaux jeunes adultes prometteurs, j’ai envie de faire un «tope-là» à mon conjoint, mon plus indéfectible partenaire, car notre vie familiale a toujours été, et reste, un travail d’équipe.
Les athlètes d’équipes sportives savent à quel point l’effort et le talent de chacun est déterminant dans leur réussite. Il en est de même quand on chante dans un choeur ou que l’on joue dans un orchestre. Si certains choristes ou musiciens ne connaissent pas leur partition, ou s’ils ne suivent pas les instructions du chef, le résultat ne sera pas harmonieux. Ne dit-on pas qu’une chaine est aussi forte que son maillon le plus faible ?
Peut-être devrais-je être reconnaissante envers mes professeurs, car force est de constater que dans notre société, les accomplissements les plus admirables se font en équipe. Quand des êtres humains solidaires partagent leurs connaissances, leurs efforts, leur cœur et qu’ils réussissent à travailler main dans la main pour une cause, ils sont aptes à faire de grandes et belles choses. Après tout, le ciel n’est-il pas davantage féérique quand on y voit une multitude d’étoiles briller en même temps ?
Le mystère de la gommette bleue
J’écoutais une émission à la télévision, bien installée sur le divan, pendant que mon fils de cinq ans jouait tout près. À un certain moment, un des personnages du film s’est retrouvé derrière les barreaux. Mon fils a regardé l’écran, a froncé les sourcils, puis m’a demandé :
«Où est-il le monsieur?»
Je lui explique qu’il est en prison, parce qu’il a commis un crime et que les policiers l’ont arrêté.
«Qu’est-ce qu’il a fait ?»
-«Il a volé des gens. Ce n’est vraiment pas gentil. Quand on fait de vilaines choses, comme voler, on risque de se retrouver en prison.»
Et mon fils de continuer à jouer. Le sujet semblait clos.
Loin de moi l’idée que cette petite conversation anodine allait avoir des répercussions quelques semaines plus tard.
Une certaine journée donc, comme chaque fin d’après-midi, je me pointe à la maternelle pour aller chercher fiston après la classe. Ce jour-là, dès que son enseignante m’aperçoit, elle s’approche vivement et demande à me parler en privé, l’air grave. Je la suis donc, intriguée, et lorsque nous sommes à l’écart, elle me dit : «Votre fils n’a vraiment pas eu une bonne journée aujourd’hui. Il a reçu un avertissement sévère.»
Je retiens un soupir. Mon petit homme n’est pas toujours sage, je le sais. Il n’a pas une once de malice en lui, mais c’est un garçon en santé, curieux, énergique, sociable et bavard. Les avertissements, il les collectionne. Qu’avait-il donc fait de si épouvantable aujourd’hui ?
«Nous l’avons surpris à voler.»
-«Pardon ?» Ma mâchoire tombe. Mon cœur s’arrête.
Mais qu’a-t-il donc volé ? Un ballon ? Un livre ? De la monnaie ? Le sandwich d’un ami ?
«De la gommette !» me dit l’enseignante le plus sérieusement du monde.
-«De la… quoi ?»
J’ai surement mal entendu. Mais non. Elle m’assure que mon fils a dérobé un bâtonnet de gommette bleue à l’un des surveillants.
Pour être certaine que je décode bien ce que l’enseignante me dit, je précise : «On parle bien du produit que vous utilisez pour coller les affiches au mur, n’est-ce pas?»
Elle acquiesce.
J’ai beau être sous le choc, je réprime un rire en me mordant les joues. Pour quelle raison fiston aurait-il «volé» un bâtonnet de gommette ? Ce n’était surement pas pour en manger ! L’enseignante a probablement remarqué mon air incrédule, car elle s’empresse d’ajouter :
«Vous savez madame, même s’il ne s’agit pas d'un objet de grande valeur, il en demeure pas moins que c’est du vol. Et c’est une infraction grave au code de vie de l’école.»
Je garde mon calme et reprend mon air sérieux de mère compétente.
«Soyez assurée que j’aurai une conversation à ce sujet avec lui ce soir, et que cela ne se reproduira plus» lui ai-je rétorqué.
Une fois à la maison, après l’avoir écouté faire le récit de sa journée, regardé ses petits travaux et son agenda, je demande, nonchalamment à mon fils s’il s’est passé quelque chose de spécial avec le surveillant.
Un large sourire éclaire son visage.
«Ah oui, j’ai fait une bonne action. Je lui ai remis sa gommette. »
Je suis surprise de sa réaction.
«Comment se fait-il que tu avais cette gommette en ta possession ?»
«-Et bien, je l’ai trouvée par terre, près du mur. Je l’ai ramassée et je suis allée la lui remettre.»
«-Tu ne l’avais pas prise ? Sur son bureau par exemple ?»
« -Oh non, maman. Je l’ai trouvée par terre. Il ne m’a pas cru, mais je te jure que je l’ai trouvée.»
Je suis troublée. Mon fils serait-il, en plus, un bon menteur ? Je le questionne à nouveau un peu plus tard, mais son histoire ne change pas d’un iota. Il ne semble même pas inquiet ou hésitant. Je lui dis que je le crois et j'arrête de lui en parler.
Le lendemain, je vois l’enseignante et lui rapporte ma conversation de la veille avec fiston.
«Madame, il n’a pas volé la gommette. Il l’a trouvée par terre et l’a rendue, comme il était supposé le faire. »
-«Et bien, pourtant, le surveillant dit qu’il est bien certain que la gommette se trouvait sur son bureau et que votre garçon l’a volée. »
-«L’-a-t-on vu le faire ? A-t-il été pris sur le fait ?»
Elle hausse les épaules. Elle semble hésitante et confuse.
«Si on ne l’a pas vu, dans ce cas, j’ai tendance à croire mon fils quand il dit qu’il n’a pas volé de gommette.»
Pour moi, le sujet est clos. Je quitte avec fiston, persuadée qu’on passera au chapitre suivant.
Hélas, non!
Le lendemain, l’enseignante me dit avoir questionné mon fils à nouveau au sujet de la gommette et qu’il avait finalement avoué l’avoir prise sur le bureau du surveillant.
Je suis hors de moi. Je croyais qu’on en avait fini de cette histoire ! C’est de l’acharnement ou quoi ? Ainsi, il m'aurait menti?
À la maison, j’interroge mon garçon, essayant de garder mon calme… Il a un air piteux.
«Pourquoi as-tu pris la gommette ?»
-«Je ne l’ai pas prise, je l’ai trouvée par terre et je l’ai donnée au surveillant. »
«-Mais tu as dit à ton enseignante aujourd’hui que tu l’avais prise sur le bureau. Alors qui dois-je croire ?»
Il roule ses beaux yeux verts et lâche un grand soupir.
«-Cela fait deux jours qu’elle n’arrête pas de m’en parler et de m’accuser. J'étais tanné. Aujourd’hui, elle m’a dit que je n’aurais pas le droit d’aller jouer à la récréation, tant et aussi longtemps que je n’avouerais pas avoir pris la gommette. Alors, j’ai dit ce qu’elle voulait pour qu’elle arrête de m’embêter avec cela, et j’ai pu aller jouer avec mes amis.»
Mon cœur s’est serré.
«Mais, tu as menti à ton enseignante. »
-«Oui, parce qu’elle ne voulait pas croire la vérité.»
-«Mon beau cœur, en faisant cela, en admettant avoir pris la gommette alors que ce n’est pas vrai, tout le monde à l’école pense que tu as fait quelque chose de pas gentil. C’est grave. Peu importe les circonstances, tu dois toujours dire la vérité. »
Pauvre petit bonhomme ! Il est devenu tout blême. Dans sa tête de garçon de cinq ans, il s’est soudainement rappelé ce je lui avais expliqué en visionnant mon film, quelques semaines auparavant : lorsqu’on faisait quelque chose de vilain, on se faisait arrêter et on allait en prison. À l’école, son enseignante le prenait maintenant pour un voleur ? Il se voyait déjà les menottes aux mains, en route pour le pénitencier.
«Est-ce que l’école va appeler la police ?»
Je l’ai rassuré, bien sûr. Le lendemain, nous avons raconté l’histoire à l’enseignante et le surveillant a finalement admis qu’il était possible que mon garçon ait trouvé la gommette au sol. Fiston fut pardonné et exonéré. En même temps, cet évènement lui avait appris une leçon importante : dire la vérité est primordial. Le mystère de la gommette bleue était ainsi résolu. Tout le monde était soulagé et la réputation de fiston, rétablie. L’avertissement sévère fut supprimé du dossier.
J’ai toutefois gardé un certain goût amer à la suite de cette aventure. Mon fils avait menti, mais seulement parce qu’on ne voulait pas le croire quand il disait la vérité. On l’avait injustement accusé, sans témoin ni enquête, tout simplement parce qu'il était le petit tannant qui parlait et bougeait trop.
Cela m’a rappelé un évènement alors que j’étais au secondaire.
Pendant un cours d’histoire, j’avais dit une stupidité alors que l’enseignante, le dos tourné, écrivait au tableau. Cette dernière avait injustement apostrophé et accusé ma voisine de classe pour ma bêtise. Il est vrai que ce n'était pas dans mes habitudes d'agir de la sorte, contrairement à ma collègue qui était plutôt indisciplinée. Mal à l’aise, j’avais avoué que c’était moi la fautive, mais à ma grande stupeur, l’enseignante avait refusé de me croire ! Elle m’avait même félicité pour avoir pris la défense de ma camarade ! J’avais tellement été outrée de cette injustice.
À l’université, mon professeur de droit criminel nous avait dit qu’il y avait beaucoup plus de bandits qui échappaient à la prison que d’innocents qui se retrouvaient, par erreur, derrière les barreaux. C’est peut-être vrai. Mais les répercussions ne sont pas les mêmes. Quand je vois ce qui se passe parfois dans l’actualité, quand j’apprends que des honnêtes citoyens sont accusés injustement pour un crime qu’ils n’ont pas commis, je me pose des questions… C’est sans parler de ce qui circule à leur sujet sur les réseaux sociaux. Leur réputation entachée, leur santé fragilisée, leur vie détruite, c’est un grand prix à payer pour satisfaire la soif de justice de gens qui ont la dénonciation et l’accusation facile.
David contre Goliath
J’ai toujours eu une aversion profonde pour le domaine médical. Vous voulez que ma pression monte ? Envoyez-moi chez un médecin ! Je me porte beaucoup mieux lorsque je me tiens le plus loin possible des cliniques et des sarraus blancs.
Mais quand ton enfant reçoit un diagnostic de diabète, tu n’as pas le choix, tu dois te résigner à t’informer sur la science, à fréquenter les hôpitaux et les spécialistes. Sa vie en dépend.
Au fil des ans, ma fille a passé je ne sais combien de temps dans les cliniques et hôpitaux. Elle a consulté toute une gamme de spécialistes, des pédiatres, en passant par des nutritionnistes, psychologues, et surtout, bien sûr, des médecins en diabète…
Des combats, il y en a eu. Et pas seulement contre la maladie.
Il y a eu les changements de médecins, au moins six fois en 17 ans, pour diverses raisons. Chaque fois, il a fallu recommencer, relater l’historique pourtant documenté dans un épais dossier, s’adapter, réexpliquer, se rajuster, ravaler ses frustrations.
Ces médecins sont des experts en diabète, mais certains ont beaucoup de travail à faire du côté relationnel. S’ils ont suivi un cours de «communication avec le patient», ils l’ont surement échoué ! Nous sentions parfois qu’on nous prenait pour des imbéciles. On parlait à notre fille d’un ton accusateur. Nous avions l’impression qu’on traitait notre Véronique comme un rat de laboratoire. En bref, nous sortions de chaque rendez-vous complètement décontenancés.
Quand elle a eu 16 ans, ma fille a voulu obtenir son permis temporaire pour suivre des cours de conduite, mais pour ce faire, elle devait obtenir l’autorisation écrite de son médecin traitant. Cette dernière, sans explication valable, a non seulement refusé de lui remettre le formulaire signé, mais s’est mise à lui faire du chantage émotionnel. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Quand ton enfant, inconsolable, te dit qu’elle ne veut plus être diabétique, qu’elle ne veut plus vivre ainsi, une alarme se déclenche dans ton cœur de maman. J’ai appelé l’hôpital et j’ai non seulement exigé de changer de médecin, mais de faire suivre son dossier vers un autre établissement. Nous en avions assez.
À cette nouvelle clinique, Véronique a tout-de-suite vu une différence dans l’approche du nouveau médecin et son équipe : elle sentait qu’on voulait travailler avec elle, qu’on était à son écoute et on lui proposait de nouveaux outils et des solutions diverses. Enfin !
Au printemps 2017, on lui a suggéré de se procurer une pompe à insuline. Nous étions surpris, car les autres médecins n’avaient jamais cru que ce serait une solution appropriée pour notre fille.
Pour les non-initiés, la pompe à insuline est un appareil de la taille d’un téléavertisseur qui distribue en continue, selon une programmation, l’insuline dans le corps, via un cathéter. Le coût de la pompe est de plusieurs milliers de dollars, et il faut la remplacer aux quatre ans environ. C’est sans compter l’achat des fournitures nécessaires, comme les cathéters et réservoirs, ce qui représente des coûts mensuels de plusieurs centaines de dollars. Et tout cela n’est pas couvert pas les assurances.
Sauf que…
Il existe au Québec un programme du Ministère de la santé, piloté par le Centre hospitalier universitaire de Québec, qui permet d’obtenir un remboursement pour l’achat d’une pompe à insuline et des fournitures nécessaires à son utilisation. Il y a deux conditions pour y être admis : la personne diabétique doit répondre à certains critères cliniques et être âgée de moins de 18 ans. Comme Véronique n’était qu’à quelques mois de l’âge limite, il fallait se décider rapidement.
Mais le choix de passer à la pompe n’était pas facile pour notre adolescente. Elle devait se résigner au fait que cet appareil serait relié à elle 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au détriment de son apparence, si importante à cet âge. Vous comprendrez, une pompe, aussi petite soit-elle, peut difficilement être camouflée lorsqu’on porte un maillot de bain ou une robe de soirée. De plus, pour Véronique qui avait utilisé des aiguilles toute sa vie pour s’injecter, c’était l’inconnu, une façon complètement différente de procéder et de gérer son diabète, et cela lui faisait un peu peur.
L’infirmière a donc proposé à ma fille de s’informer auprès d’autres enfants qui utilisaient la pompe, et de comparer les différents modèles. «Il faut seulement que tu me fasses part de ton intention d’utiliser une pompe avant ton dix-huitième anniversaire. Dans ce cas, je vais inscrire ton nom sur une liste de candidats pour le programme et même si tu te procures la pompe après ton anniversaire, tu seras remboursée.»
Au début du mois de juillet, après avoir fait ses recherches et discuté avec d’autres jeunes diabétiques de son âge, Véronique a pris sa décision. Enthousiaste, elle a appelé l’infirmière à la clinique pour lui dire qu’elle voulait s’inscrire au programme. Certaine que l’infirmière l’avait inscrite sur la liste des candidats éligibles, elle a pris un rendez-vous au début de septembre pour choisir un modèle de pompe et recevoir une première formation.
Deux semaines donc après avoir célébré ses 18 ans, Véronique se rendait à la clinique, comme prévu, pour déterminer quelle pompe lui convenait le mieux. Quelques jours plus tard, la représentante de la compagnie pharmaceutique est venue nous rencontrer à la maison pour finaliser la vente.
Et c’est là que le combat a commencé.
Heureusement, entre ces situations dramatiques, il y eut des moments d’hilarité, de fierté et de bonheur. Comme lorsque les élèves s'arrêtaient dans mon bureau, tout souriants, pour m’annoncer qu’ils avaient réussi leur examen. Les cérémonies de remise de diplômes où on voyait les élèves défiler sous les applaudissements de leur famille. Le visage radieux d’un enseignant à qui j'apprenais qu’il allait enfin obtenir un contrat après avoir enseigné pendant des années à taux horaire. Les membres de mon personnel qui travaillaient d’arrache-pied pour organiser un congrès provincial en plus de s’acquitter de leurs tâches quotidiennes. Des enseignantes de mon équipe qui ont été choisies par le Ministère pour aider à l’implantation de nouveaux programmes… Comme un capitaine de bateau, je savourais ces moments où la mer était calme et le ciel sans nuage. Car je me doutais que cela ne durerait pas.
Premier round
En discutant avec la représentante pharmaceutique, j’ai appris, à mon grand désarroi, que ma fille n’avait pas été admise au programme de remboursement. Je ne comprenais pas. La représentante nous a suggéré de vérifier s’il n’y avait pas eu erreur. Ainsi, j’ai fait quelques appels, pour découvrir que Véronique n’avait jamais été inscrite sur la fameuse liste. Donc, son dossier n’avait jamais été soumis pour le programme ! À la clinique du diabète, on m’a laissé entendre, à mots couverts, que l’infirmière, qui avait changé d’affectation depuis, nous avait mal informées. Il aurait fallu que Véronique appelle son ancien médecin traitant à l’hôpital pour enfants pour lui demander une lettre de recommandation, et ensuite s’inscrire elle-même au programme. La belle affaire ! Ce n’était pas du tout ce qu’on nous avait dit !
Finalement, on me suggérait d’appeler la personne responsable du programme au CHU de Québec afin d’expliquer la situation et de demander qu’on admette ma fille. Ainsi, la pompe lui serait fort probablement remboursée.
Deuxième round
Évidemment, on ne pouvait me donner le nom de la personne à contacter au CHU, ni ses coordonnées. J’ai dû faire des recherches dignes des plus grands détectives.
Après de multiples appels, j’ai enfin réussi à obtenir l’adresse courriel d’une personne qui travaillait au service des finances du programme. Je lui ai écrit et lui ai expliqué en détails la situation dans laquelle nous nous trouvions : elle me répondit, évidemment, qu’elle n’était pas la bonne personne pour nous aider, mais qu’elle allait faire suivre notre requête à son patron. Elle n’a pas voulu préciser le nom du patron, bien sûr ! Je l’ai relancée deux semaines plus tard : pas de réponse. J’ai passé des mois à jouer au chat et à la souris, à faire des suivis. Finalement, en janvier, soit quatre mois plus tard, cette même personne a enfin daigné me répondre : elle m’a écrit que si nous lui faisions parvenir une lettre du médecin traitant de Véronique, attestant qu’elle la recommande pour l’utilisation d’une pompe, elle serait admise. Nous avons tenté de rejoindre le médecin, lui avons laissé de nombreux messages : mais elle est très occupée, vous comprendrez. Finalement, au rendez-vous suivant de Véronique, en février, puisque nous avions le médecin devant nous, nous lui avons demandé une lettre de vive voix. «Quoi ? Ce n’est pas encore réglé ? Bien sûr, je vous envoie une lettre dans les prochains jours !» nous répondit-elle.
On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Les prochains jours, avait-elle dit ? À la fin juin, nous n’avions toujours rien reçu! J’ai arrêté de compter le nombre d’appels que j’ai faits pour obtenir cette fameuse lettre ! Je me suis même déplacée à la clinique pour que les choses bougent. Cela frôlait le harcèlement. Mais j’ai tenu bon, le docteur a présenté ses excuses pour les délais et nous avons finalement eu le précieux document au début de juillet.
Pendant ce temps, j’avais entretenu une correspondance avec le CHU de Québec pour les tenir au courant de mes démarches. Je leur ai fait suivre la fameuse recommandation du médecin. Moins d’une semaine plus tard, on nous envoyait une lettre nous informant que Véronique n’était pas admise au programme… parce qu’elle avait fait sa demande après avoir eu 18 ans ! Je voulais hurler. Je me sentais K.O.
Troisième round
Mais, au bas de la lettre, on disait que si nous n’étions pas d’accord avec leur décision, nous pouvions écrire au commissaire aux plaintes du CHU de Québec. Qu’avais-je à perdre ? J’ai décidé d’écrire une longue lettre détaillée à laquelle j’ai joint tous les documents que j’avais amassés depuis le début de notre aventure. La commissaire, une dame fort sympathique, m’a rappelée pour me demander quelques précisions. «Je dois faire enquête. Je vous enverrai mon rapport dès que j’aurai terminé, » m’a-t-elle dit. Deux mois plus tard, je recevais effectivement la réponse de la commissaire : elle considérait que la faute relevait de la clinique où Véronique était suivie et par conséquent, elle ne pouvait donner suite à notre plainte. Elle nous recommandait d’écrire au commissaire aux plaintes du Centre intégré de santé et de services sociaux.
Quatrième round
J’ai fait un copier-coller de l’autre lettre, et j’ai tout expédié le dossier au commissaire aux plaintes du CISSS. Ce dernier m’a appelée pour me poser quelques questions. «Je dois faire enquête. Je vous enverrai mon rapport dès que j’aurai terminé, » m’a-t-il dit.
Tiens, je la connaissais cette chanson !
Toutefois, il a ajouté une petite phrase à la toute fin de notre conversation, qui devait être déterminante dans la poursuite de mon combat : «vous savez madame, j’ai des enfants moi-aussi. Peu importe le résultat de l’enquête, moi, si j’étais vous, je ne lâcherais pas le morceau, je continuerais de me battre. »
C’était comme s’il me disait : «je n’aurai pas le choix de défendre la clinique, mais vous avez raison, continuez votre combat.»
Aussi, lorsque je reçus son rapport, deux mois plus tard, disant que ni la clinique, ni le CISSS n’était à blâmer, que l’infirmière avait bien fait son travail et que la marche à suivre avait été parfaitement suivie, j’ai décidé de ne pas baisser les bras.
Cinquième round
J’ai d’abord écrit à notre député provincial. Il devait bien croiser le Ministre de la santé à l’Assemblée nationale, non ? Et puis, n’est-ce pas le rôle d’un député d’aider les électeurs qu’il représente ?
Son adjointe a été fort aidante, mais elle-même s’est heurtée à mille obstacles. Ironique, n’est-ce pas ? Finalement, le député, que j’ai rencontré par hasard, m’a suggéré de porter plainte au Protecteur du citoyen. «Vous allez voir, c’est la façon la plus efficace de régler un dossier avec le système de santé.»
Sixième round
Quand j’ai tort, je sais le reconnaître, mais, dans ce cas, je savais que nous n’avions rien fait de mal, que ma fille était lésée par le système et que cela aurait un impact important sur son bien-être et le reste de sa vie. Déterminée d’aller jusqu’au bout, j’ai écrit au Protecteur du citoyen. Quelques jours plus tard, une agente aux enquêtes à qui on avait assigné notre plainte, m’a appelée pour me demander des précisions. Je lui ai donné tous les détails et lui ai fait suivre l’ensemble des courriels, lettres, et autres documents dont je disposais. Elle m’a prévenue qu’il y avait plusieurs enquêtes en cours sur son bureau, qu’elle ne prévoyait pas pouvoir me donner un rapport avant plusieurs mois…
Je ne me faisais pas d’illusions : je me disais que le résultat serait probablement le même. Depuis le début, j’avais l’impression qu’on protégeait le système et les institutions avant les citoyens. Pourtant, cette agente m’inspirait confiance. Elle parlait d’un ton déterminé, direct. Ses questions étaient pointues et impartiales. Elle m’a rappelée à quelques reprises, a aussi parlé avec ma fille, afin de vérifier des faits et en clarifier d’autres.
Puis en mars 2020, alors que la pandémie commençait à faire rage, son rapport nous est parvenu.
Sans équivoque, elle imputait la faute au Ministère de la Santé, à l’administration du programme au CHUQ, ainsi qu’à la clinique du diabète. Elle nous donnait entièrement raison ! De plus, elle proposait aux trois organismes d’apporter des correctifs dans leur façon de fonctionner. Enfin, elle recommandait que Véronique soit rétroactivement admise au programme et qu’elle soit remboursée pour sa pompe et les dépenses encourues.
L’agente responsable de l’enquête m’a appelée pour me faire une mise en garde : si son rapport était catégorique, il n’était pas contraignant. Cela voulait dire que la décision de suivre ou non les recommandations du Protecteur du citoyen revenait aux responsables du programme, du Ministère et de la clinique. Ainsi, il se pouvait qu’on refuse quand même d’admettre Véronique au programme, ou que nous ne soyons aucunement remboursés pour la pompe et les fournitures que nous avions achetées. Soupirs ! Le combat n’était donc pas terminé. En plus, dans le contexte, avec la Covid-19 qui causait bien des ravages, je me disais que le système de santé n’allait certainement pas traiter notre dossier en priorité. On ne verrait donc jamais la lumière au bout du tunnel !
Round final
Oh surprise, la lettre du CHU de Québec nous est arrivée par la poste, un beau matin de juin 2020. Fébrile, j’ai ouvert l’enveloppe et j’ai pleuré en la lisant. Pratiquement trois ans après avoir commencé les démarches, on me confirmait que Véronique était finalement admise rétroactivement au programme de pompe à insuline. De plus, nous avons été remboursés pour presque la totalité des dépenses encourues depuis septembre 2017. Le combat prenait fin. Après maints appels téléphoniques, courriels, lettres, des heures de suivis divers, je gagnais face à une énorme machine. David venait d’écraser Goliath.
La pompe a considérablement amélioré la qualité de vie de Véronique, car elle lui permet de mieux gérer son diabète. Au bout du compte, la pompe l'aide en rester en meilleure santé et, nous l'espérons, lui évitera de vivre des complications inhérantes à cette maladie chronique. Nous sommes heureux du dénouement, évidemment, car maintenant, peu importe ce qui lui arrive dans la vie, même lorsque nous, ses parents, ne serons plus de ce monde, Véronique n’aura pas à s’inquiéter d’avoir les moyens financiers pour se procurer une nouvelle pompe quand celle-ci aura besoin d’être remplacée ou pour s’acheter les cathéters et réservoirs nécessaires.
L'erreur est humaine, et les gens qui travaillent dans le secteur de la santé sont souvent à bout de souffle. On le sait. Mais peu importe, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des affaires, quand une faute est commise et qu'en conséquence, une personne en souffre, on devrait pouvoir rectifier le tir rapidement ... Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour tous les gens qui sont lésés, d’une façon ou d’une autre, par le système, par les grosses machines que sont des organismes publics ou privés ; ces gens n’ont pas nécessairement le temps ni les ressources pour se battre, et ils font face à mille obstacles, en commençant par l’incompétence, la mauvaise foi ou l’indifférence de quelques personnes. L’honnête citoyen doit, hélas, travailler très fort pour que justice lui soit rendue.
De plus en plus fragile
L’être humain nait en pleurant. D’ailleurs, ne s’inquiète-t-on pas si on n’entend pas un nouveau-né pleurer ? C’est le seul moyen qu’il a pour manifester son inconfort, mais surtout pour nous faire savoir qu’il est bien vivant.
Lorsque j’étais toute jeune, comme tous les enfants, je pleurais quand j’avais de la peine, quand je me blessais ou si j’étais contrariée. Un genou écorché, une réprimande de mes parents ou une dispute avec une amie et les larmes ne tardaient pas à faire leur apparition.
Mais les pleurs mettent mal à l’aise, ils agacent. Devant une personne en larmes, on détourne le regard. Les adultes disent souvent aux enfants : «arrête de pleurnicher !» Combien de jeunes garçons se sont fait réprimander lorsqu’ils versaient une larme en se faisant dire qu’un homme, un vrai, ne pleure jamais ? Combien de fois ai-je entendu qu’une femme qui pleure constamment est une hystérique ? C’est peut-être pourquoi, à mes yeux, pleurer est devenu un signe de faiblesse. J’ai vite appris à refouler les larmes. À les cacher. À m’endurcir. Adolescente, je ne pleurais pratiquement jamais. Les épanchements émotifs, les grandes effusions de tristesse, ce n’était pas pour moi.
Mais il y a de ces événements qui nous bouleversent et qui changent tout. Notre programmation se trouve soudainement compromise. Pour moi, l’élément déclencheur, ce fut mon départ de la Californie en juillet 1982 où j’avais vécu pendant un an dans le cadre d'un échange étudiant. C’était la fin d’une aventure extraordinaire, une étape charnière de ma vie, et je m’apprêtais à quitter des gens que j’aimais sans savoir si et quand je les reverrais. C’est à cette occasion que j’ai réappris à pleurer. En fait, j’ai réappris que c’était permis de pleurer. Je me rappelle que dans l’autobus qui nous conduisait vers l’aéroport, nous étions une vingtaine de jeunes femmes et hommes ayant vécu la même expérience et nous avons tous pleuré notre peine pendant près de deux heures, en silence, sans honte, sans reproche.
Depuis, il y a eu d’autres événements qui m’ont fait pleurer. Des moments de grande tristesse, comme le divorce de mes parents, la mort de plusieurs de mes parents et amis, le diagnostic de diabète de ma fille, les départs pénibles, notamment quand j’ai changé d’emploi.
Mais j’ai aussi pleuré dans les grands moments de joie et de fierté : des mariages, des naissances, les accomplissements de mes enfants, les grands projets réussis avec brio au travail.
Ces moments, forts en émotions, nous rappellent que si les êtres humains ont été pourvus de glandes lacrymales, c’était pour s’en servir.
Il me semble toutefois que j’ai la larme plus facile depuis quelques années. Je me rappelle la chanson qu’interprétait Ginette Reno dans les années 1980 : «de plus en plus fragile, de plus en plus blessée, pour un mot malhabile, un regard oublié.» J’ai la conviction qu’en vieillissant, je deviens de plus en plus fragile. Je ne parle pas de fragilité physique. Je suis en forme, je suis grande, forte et en santé. Mais je suis plus facilement touchée par ce que qui se passe dans le monde, par ce qui se dit et se vit. Je suis plus empathique, je ressens plus, j’ai ramolli émotivement. Ce qui ne m’atteignait pas, il y a vingt ou trente ans, vient sérieusement me jouer dans les trippes aujourd’hui. Je peux facilement m’émouvoir en écoutant de la belle musique, en regardant un film ou un reportage, en voyant la peine ou le bonheur dans les yeux d’autrui. Je pleure parce que je m’ennuie de quelqu'un ou parce qu’on me fait une belle surprise. Je pleure quand des gens qui me sont chers vivent un moment intense. Parfois, je pleure parce que je ris très fort : c’est de la joie liquide !
Quand des gens de mon entourage pleurent, je les prends dans mes bras ou je pose ma main sur leur épaule et je les laisse pleurer un bon coup. Je ne leur dis surtout pas d’arrêter. Si cela leur fait du bien, qu’ils pleurent ! Parfois, je pleure avec eux. Si on me traite de pleurnicharde, je n’en ai cure : la seule émotion que je ne ressens pas, c’est la honte. Il n’y a rien de honteux à sentir ma gorge se contracter, les larmes rouler sur mes joues, mes yeux devenir rouges et le nez reniflant. Quand cela m’arrive, je sors mon mouchoir et je me laisse aller. Le sourire finit toujours par revenir.
Alors pourquoi pleurer ? Parce que je suis de plus en plus sensible... Mais surtout, parce que c’est humain.
Passionnée de lecture
J’ai toujours aimé lire. En fait, quand je pense à ma relation avec la lecture, je m’accuserais de gloutonnerie. Je dévore les pages, je les tourne à un rythme fou pour me rendre le plus rapidement possible au dénouement. Et là, je vis un deuil. Inévitablement, une fois la dernière page tournée, je me demande, «pourquoi n’ai-je pas pris davantage le temps de savourer chaque phrase, chaque dialogue ? » En lecture, je ne connais que la démesure. Je lis dès que j’ai une seconde de libre. Et même quand j’ai un horaire chargé, je prends le temps de lire. Je lis en avion, dans le métro, dans le bain, dans mon lit, chez la coiffeuse, en prenant mon petit déjeuner, sur la plage, ou dans ma piscine. J’avoue même, sans grande fierté, avoir déjà lu quelques pages derrière le volant, alors que j’étais prise dans des bouchons de circulation monstre…
J’aime bien mettre quotidiennement les yeux sur les articles de journaux, ou dans les revues quand je suis pressée, mais je préfère de loin les beaux gros livres épais, les vraies «briques». Je lis tous les genres, ou presque. J’avoue tout de même que je ne suis pas trop friande de science fiction. Mais donnez-moi des romans policiers, d’amour, d’action, de mystère, les sagas, les grands classiques, les biographies, je ne me lasse pas. Ce que je préfère, ce sont les ouvrages ayant comme toile de fond un événement historique.
Je lis autant en français qu’en anglais. Avant, je lisais plus lentement en anglais. J’avais donc l’impression de déguster mes lectures un peu plus dans la langue de Shakespeare. Mais ça ne fait plus de différence maintenant. Je lis aussi rapidement in English. J’ai aussi lu en espagnol, mais c’était laborieux, surtout dans le cadre de mon cours de littérature hispano-américaine, à l’université. Une des lectures requises était, entre autres, Cent ans de solitude de Gabriel Marquez. Je n’ai rien compris. Je me suis rattrapée en lisant la traduction française des années plus tard.
J’achète rarement des livres. Au nombre que je lis, je me ruinerais. De plus, je n’aurais plus d’espace à la maison pour les ranger tous. Je suis donc une fidèle de la bibliothèque municipale et cela, depuis que je suis toute jeune. J’ai aussi pris goût à la liseuse qu’on m’a offerte il y a quelques années, à la fête des mères et qui me permet de télécharger les livres à un rythme fou. Avec sa luminosité, je peux lire partout, à toute heure du jour et de la nuit. Je peux aussi grossir les caractères. Quand on vieillit, c’est un élément qu’on apprécie. Dans une valise, la liseuse est moins lourde. Je pars en vacances l’esprit tranquille, ne craignant pas de manquer de lecture.
Mon histoire d’amour avec la lecture a commencé dès ma première année du primaire. Je me rappelle des premières phrases que j’ai appris à lire. «Luc va à l’école. Fido va avec lui». Rapidement, je me suis mise à déchiffrer chaque affiche, chaque titre de journal, chaque bande dessinée que je voyais. Je me rappelle avoir reçu, à l’occasion de ma première communion, cinq livres de la Comtesse de Ségur que j’avais lus avec bonheur. J’ai tellement souhaité être comme Camille, une des petites filles modèles!
Comme, il n’y avait pas de bibliothèque municipale à Fabreville dans les années ’70, il fallait prendre l’auto et se rendre à celle de Laval-Ouest qui était située au deuxième étage de la caserne de pompiers. D’ailleurs, les locaux empestaient le caoutchouc et le gaz des camions. Dès que j’entrais, je me dirigeais vers la salle où se trouvaient mes collections préférées : les compagnons de la Croix-Rousse, les jeunes filles en blanc, la série Brigitte. Puis, vers l’âge de onze ans, c’est Agatha Christie qui a capté mon intérêt. Je sortais fièrement ma carte de bibliothèque et la préposée étampait la date de retour autant de fois que j’empruntais de livres. Ma carte se remplissait vite.
À l’adolescence, j’ai passé des étés complets avec le nez dans les livres. Je marchais d’une pièce de la maison à une autre en lisant ! Je ne me sentais jamais seule avec un bon roman entre les mains. Je m’évadais vers d’autres lieux, en tournant des pages. Lucy Maud Montgomery m’a enchantée avec ses belles descriptions de l’univers d’une orpheline aux cheveux roux, Anne Shirley, de la maison aux pignons verts. Dans les Quatre filles du Docteur March, de Louisa May Alcott, je me reconnaissais dans le personnage de Jo. J’ai découvert l’Angleterre à travers les récits délicieux de Jane Austen. J’ai pu imaginer le quotidien de mes grands-parents alors qu’ils étaient jeunes adultes en lisant Bonheur d’Occasion. J’ai commencé à m’intéresser aux classiques français avec les Misérables de Victor Hugo, quoique j’admette volontiers avoir sauté quelques pages du chapitre sur les égouts de Paris. J’ai admiré la détermination de la belle Scalett O’Hara dans Autant en emporte le vent. J’ai frissonné en lisant le Parrain. J’ai aussi lu quelques Danielle Steel : j’ai particulièrement aimé Zoya qui se trame pendant la révolution russe et Traversées qui a pour décor la dernière grande guerre.
Plus tard, j’ai découvert un Québec différent en lisant la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge, qui racontait l’histoire de Gabrielle, Adélaide et Florent. Je me rappelle avoir passé une nuit blanche avec La firme de John Grisham. Le Zèbre d’Alexandre Jardin reste une des belles histoires d’amour que j’ai lues. Charlotte Link m’a fait voir un point de vue allemand de la deuxième guerre mondiale avec Le temps des orages. L’auteure Joy Fielding sait me garder en haleine, particulièrement avec Qu’est-ce qui fait courir Jane ? J’ai aimé les Lettres de Julie Papineau, mais aussi les aventures fantastiques de Harry Potter. Dan Brown, Ken Follett, Jeffrey Archer, Kathy Reich, Stieg Larsson ont côtoyé Arlette Cousture, Gabrielle Roy, Anne Robillard, Umberto Eco, Hemingway, Scott Fitzgerald, Régine Deforges et Camu sur ma table de chevet. Et les Lévesque, Bourassa, Bouchard, Mulroney, Trudeau, Kennedy, Obama, Nixon, Staline, Roosevelt, Édith Piaf, Coco Channel n’ont plus de secret tellement j’ai lu leurs biographies.
À force d’emprunter des dizaines de livres par deux semaines à la bibliothèque, il n’est pas rare que je constate après quelques pages, que je suis en train de lire un ouvrage que j’ai déjà lu. Quelle frustration! Il faudrait que je tienne un inventaire de mes lectures pour éviter ce faux pas!
Il y a bien sûr les lectures «obligées». Celles que l’on doit faire pour un cours ou pour le travail. Certaines s’avèrent passionnantes, d’autres pourraient être qualifiées de bons somnifères. Mais peu importe. Il est quand même fascinant de constater tout ce qui a été pensé, conçu, écrit et publié, sur tant de sujets variés au fil des siècles. Les livres rendent leurs auteurs immortels. Ils sont des témoins de l’histoire et des grands courants de pensée, de notre évolution dans tous les domaines.
De penser que, dans un passé pas très lointain, l’accès à certains livres était interdit, m’indigne au plus au point. La lecture stimule l’imagination et ouvre l’esprit. Elle tient compagnie, elle transporte, elle divertit, et surtout, elle instruit. C’est une de mes grandes passions et je ne saurais m’en passer. J’assume pleinement ma gloutonnerie !
Comme Obélix et sa potion magique
Ma relation avec le monde de l’éducation est comme celle d’Obélix avec la potion magique : je suis tombée dedans quand j’étais petite et j’y ai trouvé ma force ! Je viens d’une famille d’enseignants. J’ai grandi en entendant des histoires d’élèves, d’écoles, de classes… Inévitablement, lors des réunions familiales, on parlait d’éducation. Bien que j’aie pris de nombreux détours au début de ma carrière professionnelle, j’étais destinée à devenir moi-même enseignante. Pendant plus de treize ans, j’ai enseigné auprès d’une clientèle adulte, donc âgée de seize ans ou plus.
Ah, cette fébrilité, cette poussée d’adrénaline, cette fierté que je ressentais chaque fois que je me retrouvais en classe devant un nouveau groupe d’élèves ! Je savais que déjà, au premier coup d’œil, on m’avait jugée, qu’on avait analysé ma posture, mon timbre de voix, mon apparence et ma tenue vestimentaire. Certains élèves avaient peut-être même déjà décidé qu’ils allaient m’aimer ou me détester. J’étais leur nouvelle enseignante, une de plus avec laquelle ils devraient composer. Allais-je être sévère, exigeante, stressante, aimable, efficace, aidante ? La première impression, celle que l’on donne dans les quatre premières minutes du cours, est déterminante.
Alors que je viens de mettre fin à ma carrière en éducation en joignant le rang des retraités, je me rappelle avec attendrissement certains moments forts de mon expérience en tant qu’enseignante. Enseigner est une grande responsabilité. Au-delà de transmettre des savoirs, l’enseignant, par les liens qu’il entretient avec ses élèves, exerce une influence d’une grande importance. J’ai toujours considéré cette relation « maître-élève » comme un privilège. Quel bonheur ai-je maintes fois ressenti en voyant mes élèves apprendre, comprendre, murir ! Et au bout du compte, à leur contact, c’est moi qui apprenait, qui grandissait, qui devenait une meilleure personne. C’était ce que j’appelais, des moments d’illumination.
Je me rappelle de Carole* qui s’est mise à pleurer alors que je lui annonçais qu’elle avait eu une note parfaite dans un examen et que je la félicitais pour son superbe travail. Elle m’a dit, entre deux sanglots que c’était la première fois qu’on lui disait qu’elle était bonne à l’école. J’ai compris l’importance de la rétroaction positive en enseignement.
Cette chère Suzanne, qui venait à mes cours bourrée de pilules, malade, distraite, angoissée et incapable de croire en elle. Je l’ai secouée, je l’ai semoncée, et elle est venue à chaque session de récupération le soir pour finalement réussir. Parfois, il faut montrer aux élèves que nous croyons davantage en eux qu’eux-mêmes.
Je me rappelle ce fameux matin où Josée allait signer ses papiers d’abandon quand je l’ai croisée par hasard dans le corridor. «Je n’y arriverai pas, j’ai des échecs dans quatre matières. »
Ensemble, nous avons analysé les raisons de ses difficultés et avons conclu qu’il n’y avait rien d’insurmontable. J’ai lui ai offert des explications et des exercices synthèse supplémentaires. Je l’ai convaincue qu’elle devait rester et travailler fort, ce qu’elle a fait. Quelques mois plus tard, à la cérémonie de remise des diplômes, son regard valait mille mots. C’est à ce moment que j’ai compris qu’il faut accompagner nos élèves et les persuader de ne pas baisser les bras, qu’avec du travail et de la détermination, ils peuvent atteindre leur but avec fierté.
Diane a perdu son amoureux dans un horrible accident de la route et, sous le poids du chagrin, a décidé de mettre son projet d’études en veilleuse. Le jour de son départ, je l’ai serrée dans mes bras, je lui ai dit de prendre soin d’elle et de ne pas perdre espoir, qu’elle trouverait un sens à la vie. Enseigner, c’est faire preuve de compassion et d’humanité. Diane est revenue me voir quelques années plus tard : elle avait terminé ses études en technique ambulancière, elle avait retrouvé son sourire coquin, avait un nouveau conjoint et un emploi qui lui permettait de faire une différence en sauvant des vies.
Pietro, un bel italien, m’a dit un jour, sans ambages, que mon cours était ennuyeux. Un peu insultée, je l’avoue, je lui ai demandé de rester après la classe. Après en avoir discuté avec lui, je me suis aperçue qu’il n’avait pas tout-à-fait tort. Apprendre devait faire du sens. Ce soir-là, j’ai revu mes plans de leçons et j’ai développé de nouveaux exercices qui allaient placer mes élèves en situations réelles d’apprentissage. Pietro m’a fait comprendre que chaque élève apprenait différemment et que c’était à moi d’adapter mes approches.
Invariablement, chaque matin, Marie arrivait en retard à mon cours. J’ai eu beau la rencontrer, lui parler, me fâcher, lui faire comprendre qu’elle ne pouvait manquer une vingtaine de minutes de mon cours chaque jour, rien à faire. Puis un matin, alors qu’elle se penchait pour ramasser un crayon tombé par terre, son chandail s’est retroussé pour laisser entrevoir une énorme ecchymose sur son côté gauche. Ainsi, j’ai appris que Marie, victime de violence à la maison, recevait une raclée chaque matin avant de venir en classe. Apprendre, c’était sa façon de s’évader, sa planche de salut. Je l’ai bien sûr référée à des ressources d’aide et l’histoire de Marie s’est heureusement bien terminée. Mais par la suite, je me suis toujours rappelée que derrière chaque élève, il y a une histoire et il faut en tenir compte pour mieux le comprendre avant de le juger.
Quelques années plus tard, j’ai fait la connaissance de Sylvie qui arrivait aussi en retard tous les jours. Quand je lui ai demandé la raison de son manque de ponctualité, elle m’a expliqué qu’elle faisait partie de l’équipe nationale d’aviron, qu’elle était un espoir olympique et que dès 6 heures chaque matin, de mai à septembre, beau temps, mauvais temps, elle était à l’entraînement au bassin de l’île Notre-Dame. Il était très difficile pour elle d’être en classe pour 8 h 30, mais elle ne voulait pas abandonner ses études, car elle savait très bien qu’une fois les jeux olympiques passés, il y avait peu de chance qu’elle fasse carrière en aviron. J’en ai discuté avec ses collègues de classe et nous avons convenu ensemble de moyens pour aider Sylvie malgré ses retards. Nous avons également suivi ses exploits sportifs, ce qui a créé une belle solidarité au sein du groupe. Quand on place l’élève au cœur de nos préoccupations, qu’on fait preuve de souplesse, on trouve des solutions.
Maryse perdait complètement la carte avant et pendant les examens. Elle pestait, pleurait, devenait en sueurs, me demandait d’aller à la salle de bain aux quinze minutes, et par conséquent, dérangeait ses collègues. Je croyais, à tort, que la situation allait s’améliorer. Hélas, un problème disparaît rarement par lui-même. La patience étant une vertu qui a des limites, exaspérée d’avoir à subir ses crises d’angoisse, je l’ai convoquée après le troisième examen. Après plusieurs minutes de discussion, Maryse m’a enfin avoué, comme s’il s’agissait d’un secret honteux, qu’elle faisait du diabète et que le stress d’un examen avait un effet néfaste sur sa glycémie et par conséquent, sur son humeur et sa vessie. Je suis tombée des nues. Pourquoi n’étais-je pas intervenue avant ? J’étais bien prête à mettre en place les accommodements et les dispositions nécessaires pour aider mes élèves, mais encore fallait-il que je sois au courant et en mesure de bien comprendre leurs besoins. Maryse et moi sommes parvenues, ensemble, à trouver des solutions afin qu’elle puisse mieux gérer son stress. L’importance d’une bonne communication ! Cela évite bien des désagréments. Je m’en suis rappelée plus tard, quand ma propre fille a reçu un diagnostic de diabète de type 1 et a fait son entrée à l’école.
Un certain début de septembre, alors que j’étais entre deux emplois, une directrice d’école primaire m’a appelée pour me demander si je voulais faire de la suppléance. Elle m’offrait de remplacer l’enseignante d’anglais langue seconde pendant deux jours auprès d’élèves de première année. Je lui ai mentionné que, puisque j’enseignais habituellement à des adultes, je ne connaissais pas du tout les programmes du primaire, et je craignais de ne pas être à la hauteur. Elle m’a dit d’un ton angoissé : « écoutez, je suis vraiment coincée, je n’ai personne pour donner les cours demain. Vous parlez anglais, vous avez un brevet, pouvez-vous me dépanner pendant deux jours si je vous trouve un plan de leçon? ». J’ai accepté, me disant qu’enseigner l’anglais à des jeunes de première année ne devrait pas être trop compliqué…
Le lendemain, en arrivant dans la salle de classe, j’ai lu le plan de leçon. J’avais comme instructions de montrer aux élèves comment se présenter et de leur enseigner les couleurs.
En fouillant un peu, j’ai découvert avec bonheur, une boîte de craies de toutes les couleurs.
J’ai donc inscrit au tableau le nom de chaque couleur en anglais utilisant la craie de couleur appropriée.
Quand mon premier groupe est arrivé, j’ai lancé avec enthousiasme : « aujourd’hui, nous allons apprendre à dire les couleurs en anglais. Je les ai inscrites au tableau alors nous allons les lire ensemble. »
Les élèves m’ont regardée avec une certaine détresse dans les yeux. L’un d’eux, un brave, a levé timidement la main. «Madame, nous n’avons pas encore appris à lire en français. Sommes-nous supposés savoir lire en anglais ? » Ciel ! Des élèves de première année en septembre ! Ce ne sont pas des adultes, évidemment qu’ils ne savent pas encore lire ! Vite, j’ai affiché mon plus beau sourire et je les ai rassurés : « Mais non, c’est une blague ! Je vais lire et vous répéterez après moi ». C’est ce qu’on appelle l’art de la récupération ! Ce jour-là, j’ai appris à communiquer en dessinant et en faisant bien des gestes.
Dans mon deuxième groupe, il y avait Francis. Dès le début du cours, il a sauté sur le pupitre et s’est mis à faire le clown. Quand je lui ai calmement demandé de descendre, il m’a regardé d’un air défiant et m’a simplement répondu : «Non. Et tu n’as pas le droit de me toucher». Je lui ai répondu que je n’avais pas l’intention de le toucher, qu’il était un grand de première année maintenant et qu’il allait descendre seul. «Que vas-tu faire si je ne descends pas ?»
Il faut parfois penser très vite. J’ai soupiré et j’ai répondu : «je n’aime pas faire cela, mais tu ne me donnes pas le choix. Pour chaque minute que tu vas faire perdre à la classe en restant debout sur ton pupitre, je le reprendrai à la récréation. Si je me fie à l’horloge, vous venez déjà de perdre 3 minutes de récréation.» La pression des pairs peut être très efficace. Les protestations ont fusé de toute part : «Francis arrête de niaiser, on veut jouer au ballon nous !» Finalement, le petit coquin s’est assis et ce sont quatre minutes de récréation que les élèves ont perdues. Car oui, je les ai retenus pendant quatre longues minutes pour pratiquer les salutations en anglais alors que les autres groupes s’amusaient dans la cour. Francis est venu me voir avant de quitter la classe pour me dire que «je n’étais pas gentille, que je n’avais pas le droit de couper le temps de récréation». Je lui ai répondu que j’étais au contraire très gentille, mais que pendant mon cours, il devait suivre mes consignes.
Une discussion avec la direction m’a permis de comprendre que Francis avait un trouble d’hyperactivité et que sa situation familiale n’était pas de tout repos. Malgré tout, le lendemain, Francis s’est sagement assis à son bureau et il a participé aux activités avec enthousiasme. D’un air espiègle, il a levé sa main et s’est exclamé : «moi, je connais un mot en anglais : ASS !» Rires. Et moi de répliquer «tu devrais utiliser le synonyme, qui est plus joli : BEHIND». Francis a bien appris sa leçon et j’ai eu l’occasion de le vérifier dix minutes plus tard, lorsque le directeur-adjoint a fait une annonce à l’intercom : «il y a des petits jackass qui font des pirouettes dangereuses sur leur planche à roulettes dans la cour et il faut que ça cesse»…
Évidemment, Francis ne rate pas cette occasion. Il me regarde et dit très fort : «le directeur-adjoint aurait dû dire jackbehind, n’est-ce pas ?
Dans un autre groupe, il y avait Mélanie, une mignonne blondinette aux grands yeux bleus qui, dès son arrivée dans ma classe, se cachait sous sa chaise. Je me suis assise par terre pour lui parler, mais elle refusait de me regarder. Tout au long du cours, malgré le fait que j’aie tenté par tous les moyens de l’inclure, elle est restée aussi fermée qu’une huître. Quand la titulaire est revenue chercher son groupe, elle m’a fait comprendre que ce n’était pas ainsi seulement avec moi, que Mélanie agissait de la même façon dans sa classe. «Je vais appeler les parents», m’a-t-elle dit.
Alors qu’il ne devait durer que deux jours, mon remplacement s’est prolongé et je suis finalement restée un mois à cette école primaire. Francis a éventuellement eu droit à l’aide d’une éducatrice spécialisée et il m’a avoué qu’il me trouvait plus fine qu’au début, même si je restais assez sévère… Au fil des jours, Mélanie est progressivement sortie de sa cachette et s’est mise à participer et parfois même, à me sourire. Quand j’ai annoncé aux élèves que j’allais quitter parce que leur enseignante d’anglais allait revenir, j’ai eu un petit pincement au cœur. Enseigner l’anglais à des jeunes de première année avait été plus exigeant que je ne l’avais anticipé, mais l’expérience s’était avérée un défi enrichissant autant sur le plan professionnel qu’humain. Lorsque Mélanie a quitté ma classe la dernière fois, elle m’a fait un câlin, s’est collée contre moi pendant une longue minute et m’a dit de sa toute petite voix : «si tu ne peux plus être mon professeur d’anglais, peux-tu être ma maman ?». Je vous l’avoue, j’ai craqué. Et encore aujourd’hui, je me demande ce que Mélanie est devenue.
En ce début d’année scolaire, en dépit de tout ce qui se dit sur le monde de l’éducation, je souhaite à tous les enseignants de ne jamais douter de la noblesse de leur mission et du pouvoir d’influence qu'ils exercent. Et je leur souhaite autant de bonheur que j'en ai eu au contact de mes élèves.
* Tous les noms dans ce texte sont fictifs afin de préserver l’anonymat de mes anciens élèves.
La tornade médiatique
Il n’avait jamais demandé d’attention. C’est d’ailleurs pourquoi il n’avait jamais participé aux concours d’entrepreneuriat, ni aux galas des chambres de commerce. Il se méfiait des émissions comme L’œil du dragon. S’il avait démarré sa propre entreprise dans les années ‘90, ce n’était pas parce qu’il se croyait le meilleur, ou parce qu’il aspirait à devenir riche ou une vedette. Ce n’était même pas pour donner une compagnie en héritage à ses descendants. Il était en affaires parce que c’était un entrepreneur-né, un entrepreneur dans l’âme et dans le cœur. C’était une façon pour lui de réaliser ses passions tout en gagnant honorablement sa vie.
Pendant plus de vingt ans, il a bûché, sans jamais compter ses heures. Il a investi son argent personnel et il en a parfois perdu. Il a fait des erreurs et il a trouvé des solutions. Face à des difficultés, il a rué dans les brancards, il s’est battu pour bâtir sa compagnie, puis pour se démarquer sur le marché.
Il a fait travailler des gens, beaucoup de gens, au fil des ans. Des gens qui, grâce à l’entreprise qu’il avait créée, pouvaient gagner leur vie, nourrir leur famille et payer leurs comptes. Il s’occupait de ses employés et les traitait bien, car il les considérait comme sa plus importante ressource, et il s’assurait qu’ils bénéficient des succès de l’entreprise.
Sa compagnie, tout comme lui personnellement, a payé des taxes et des impôts, sans essayer de se défiler. Il a toujours bien payé ses fournisseurs. Par ailleurs, quand un de ses bons clients était financièrement à l’étroit et avait de la difficulté à payer ses factures, il se montrait compréhensif et le laissait respirer. Il respectait ses compétiteurs parce qu’il savait qu’eux aussi travaillaient dur pour se faire une place au soleil. Il accueillait des stagiaires pour contribuer à préparer la relève. Il refusait de s’associer à des entreprises douteuses ou d’essayer de frauder le système. À sa façon, il a contribué à l’économie québécoise et il a fait sa marque dans son domaine, même au niveau international. Et dans la communauté d’affaires, il était hautement respecté.
Son entreprise a grandi. De huit employés au début, il employait plus de cent personnes, vingt ans plus tard. D’un petit local sur la rive-nord de Montréal, il est passé à une grande usine à Laval, avec des centres de distribution dans l’ouest du pays et aux États-Unis.
Son business, c’était aussi son fonds de retraite. Quand il a vendu son entreprise, il aurait pu s’asseoir sur ses lauriers, pour ne pas dire, sur son foin, et profiter de la vie. Mais la fibre entrepreneuriale était trop forte. Il avait encore ce besoin viscéral de bâtir quelque chose. Et puis, il y avait une cause qui lui tenait diantrement à cœur : l’environnement.
Il s’est à nouveau lancé. Il a à nouveau investi son argent personnel. Il voulait planter des arbres. Pourquoi ? Parce qu’il trouve ça beau, une forêt. La verdure, ça rend les gens heureux, plus sereins, des études le disent, et en plus, c’est prouvé, ça capte du carbone, ça purifie l’air. Il a investi dans une entreprise qui développe des projets forestiers pour restaurer des écosystèmes détériorés et enrichir la biodiversité en milieu urbain. Ce n’est pas facile d’avoir l’imprévisible Dame nature comme partenaire d’affaires. Mais il s’est entouré de gens hautement qualifiés et compétents dans le domaine. Il a insisté pour que les plus hauts standards de l’industrie soient suivis et que l’entreprise soit accréditée par un organisme reconnu. Il est allé sur le terrain voir les projets, pour planter lui-même des arbres et comprendre. Il a décidé de redonner aux communautés qui s’impliquent dans les projets, comme ceux au Mexique.
Encore une fois, il ne compte pas ses heures, et quand il fait des erreurs, il cherche des solutions. Il a des compétiteurs et si certains font des choses douteuses, il refuse de les dénoncer. Il veut se concentrer à faire les choses correctement. Tranquillement, il développe des projets excitants et prometteurs, il s’adjoint des partenaires et des clients, il s’assure que les normes soient respectées pour que la crédibilité et l’intégrité de l’entreprise demeure intactes.
Et puis, bien malgré lui, les arbres sont devenus un sujet d’actualité…
Une jeune suédoise de 16 ans est débarquée en Amérique pour plaider la cause de l’environnement. Près d’un demi-million de gens sont descendus dans les rues de Montréal pour dénoncer la crise climatique. La cause environnementale est devenue le plus important enjeu de la campagne électorale en cours au pays. «Plantez des arbres», disait la jeune Greta. «Moi, je vais planter des arbres pour compenser mes émissions de gaz à effets de serre», disaient certains politiciens. Il n’en fallait pas plus pour qu’un journaliste s’intéresse lui aussi à la chose.
L’homme d’affaires n’a jamais cherché la lumière des projecteurs. Et donc, quand son associé lui annonce qu’un journaliste l’a appelé pour lui poser des questions sur les sites de plantation, il est un peu agacé. Mais il dit à son associé : «réponds-lui en toute transparence. Nous faisons les choses correctement et nous n’avons rien à cacher. » C’est ce que l’associé a fait. Il a parlé des problèmes rencontrés, des sites qui n’avaient pas fonctionné. Il a répondu aux questions avec honnêteté. Il lui a raconté les bons coups et les projets prometteurs, mais il a trouvé que le journaliste, un peu harceleur, essayait de lui faire dire des choses qui n’étaient pas exactes. Il ne restait plus qu’à attendre pour voir l’article.
Les jours ont passé et, rien. L’homme d’affaires a pensé que le journaliste avait peut-être renoncé à écrire l’article. Ou que son éditeur avait décidé de garder l’espace du journal pour des nouvelles plus importantes. Puis, tôt un matin, le téléphone s’est mis à sonner. L’article était paru. En première page.
Le titre l’a frappé au visage comme un coup de masse. «Où sont les arbres ?» disait-il en gros caractères bien gras. Il a regardé la photo qui ornait la première page du journal d’un air hébété. Un tas de roches. Il ne comprenait pas.
Il a lu l’article, s’indignant davantage à chaque paragraphe, se demandant sans cesse : «mais qu’est-ce que j’ai fait de mal ?»
Pour la première fois de sa carrière, il venait de se frotter au merveilleux monde des médias. Et il n’aimait pas la sensation. Combien de fois m’avait-il entendue, au fil des ans, me plaindre de la façon dont certains journalistes couvraient le réseau de l’éducation et les commissions scolaires, à quel point ils étaient parfois injustes dans leurs propos, et comment ils tronquaient les histoires pour mettre l’accent sur le sensationnel dans leurs articles? Voilà que c’était son tour de goûter au même plat amer. Je lui avais déjà dit que si on présentait aux représentants des médias le plus parfait des mannequins, superbement coiffé et habillé du plus bel ensemble d’un grand couturier, ils s’efforceraient de trouver un petit accroc dans l’étoffe d'un vêtement, photographierait cette maille en gros plan, et trouveraient le moyen d’en faire le titre de leur article. C’est leur travail : présenter des faits qui captent l’attention. Pour les explications, le dosage, on repassera, seulement si l’espace le permet, car les articles doivent être concis. Un journaliste doit se concentrer sur les faits, les bons, mais surtout les plus juteux. Les articles doivent être lus. Les journaux doivent être lus. Ils doivent attirer et garder des abonnés. Les médias se défendront en disant qu’ils ont le devoir d’informer. Ah oui, c’est vrai. Mais pour un jeune journaliste d’enquête, quand son article fait la «une» du journal, c’est une consécration. Il appelle sa parenté la veille pour le lui annoncer, il se dit qu’il fera laminer l’article. Et pour faire la «une», il ne suffit pas d’informer. Il faut donner un choc. En mettant l’accent sur la maille dans le tissus.
La réaction de l’homme d’affaires ce matin-là? «Je vais mettre la clé dans la porte. C’est beau la résilience, mais j’en ai assez. J’abandonne. »
Avait-il été malhonnête ? Non. Avait-il tenté de cacher des faits ? Non. Avait-il fait quelque chose d’illégal ? Non. Comme tous les gens en affaires, il avait eu à résoudre des problèmes, et oui, il avait dû corriger des erreurs de parcours, des erreurs sans conséquence tragique. Qu’avait-il à se reprocher ? Rien. Rien, sinon d’avoir demandé à son équipe d’être transparent avec un journaliste qui avait un sujet d’actualité dans sa mire. On ne pouvait même pas l’accuser d’avoir cherché la publicité autour de son projet. Alors, pourquoi abandonner ? Par respect pour les employés, pour les partenaires et les clients, il avait le devoir de ne pas déclarer forfait sans se battre. Que faire alors?
Il fallait réagir et répondre. Mais comment et à qui ? Il était hors de question d’attaquer le journaliste. Il avait fait son boulot, et on ne pouvait l’accuser d’avoir menti dans son article. Il n’était certes pas un spécialiste de l’environnement, et ses connaissances en gestion des forêts étaient probablement limitées, mais un journaliste sait reconnaître un arbre quand il en voit un, et surtout, un problème quand il n’y en pas de forêt là où il devrait y en avoir une. Bien sûr, la façon dont les faits étaient présentés, les bouts de citations publiés et les photos choisies mettaient l’accent sur un côté de la médaille plus que sur l’autre, le côté qui faisait mal. La façon dont l’article était rédigé pouvait porter à confusion, certaines informations étant manquantes. Rien qui puisse être qualifié de label diffamatoire, évidemment. Les médias connaissent bien les limites de leur terrain de jeu.
Il était donc persuadé qu’envoyer une réponse au journal ne servirait à rien. Comme il faudrait un texte de plusieurs pages pour réfuter, expliquer ou remettre en contexte chaque fait, la réplique, si seulement publiée, serait surement coupée, faute d’espace, et cela ajouterait à la confusion. En plus, le journaliste visé aurait droit de réplique, et donc le dernier mot. N’est-ce pas ainsi qu’un simple article peut engendrer une polémique qui dure plusieurs jours ?
Un seul commentateur radio, de ceux que j’appelle affectueusement les «crieurs de galerie», a repris l’affaire. Il a reçu le journaliste la journée-même en entrevue, s’est indigné en ondes avec lui, a fait des mises en garde… Sans vérifier quoi que ce soit au préalable. C’est ainsi qu’on se complait dans le sensationnalisme. Le lendemain, une chroniqueuse a aussi tenté de bien faire son travail en jugeant les gens qui veulent compenser leurs émissions de gaz carbonique : selon elle, on achète des arbres pour se déculpabiliser et se permettre de ne pas changer ses habitudes, comme on allait à la confesse pour recevoir l’absolution et se donner bonne conscience. Eh bien… Merci de décourager la population à faire quelque chose de positif pour l’environnement, ma chère ! Mais faut-il rappeler que nous n’avons pas tous la possibilité, comme Greta, de nous déplacer en bateau à voile ? Tout en changeant nos habitudes et en essayant de trouver de meilleures solutions pour l’environnement, ne pouvons-nous pas tenter de rendre le monde plus beau et moins pollué en plantant des arbres ?
Il est vrai que travailler avec la nature, c’est prendre un grand risque. Bien des éléments sont hors de notre contrôle. Quand on plante un arbre, il est difficile de prédire, même en prenant toutes les précautions possibles, si une maladie va s’y attaquer, si une tempête le fera plier, si les mauvaises herbes essaieront de l’étouffer, si un motoneigiste le décimera en passant dessus par mégarde. On espère qu’il deviendra beau, touffu et fort et on met tous les efforts pour l’aider à pousser bien droit. S’il meurt, on a le choix de s’empresser de le remplacer ou d’évaluer d’abord ce qu’il faut faire pour que le nouvel arbre ne subisse pas le même sort. Mais baisser les bras n’est pas une solution. Il ne faut pas seulement mettre l’accent sur l’arbre qui est mort. Il faut aussi contempler les forêts autour, celles qui existent comme celles en devenir. Et continuer de rêver à en créer d’autres. C’est un peu comme avoir des enfants : certains peuvent mourir en bas âge, d’autres tombent malades, d’autres pourraient mal tourner et devenir des parasites ou pire, des criminels. Alors, je vous le demande : devrions-nous arrêter de faire des enfants ?
Des amis, des partenaires, des gens du milieu et des scientifiques ont appelé l’homme d’affaires. Ils étaient indignés, fâchés par la façon dont l’article avait été rédigé. Certains ont offert d’écrire au journaliste. Il a refusé. En bon capitaine, il a plutôt choisi de laisser la tempête passer, puis de réunir son équipe pour constater les dégâts et voir s’il était possible de tout rebâtir. «Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts».
La tornade est passée. Une lettre d’explication a été acheminée à tous les partenaires et les clients. La réaction a été encourageante. Son entreprise n’est pas morte, il n’a pas encore eu à mettre la clé dans la porte. Toutefois, ce sont les prochains mois qui détermineront si l’homme d’affaires pourra continuer à planter des arbres. Une chose est certaine : s’il le fait, ce sera en se tenant le plus loin possible des politiciens et des journalistes.
Note : quelques jours plus tard, un commentaire de l'éditeur à l'effet qu'il y avait certains faits erronés dans l'article est paru dans une version électronique sur Internet. Malheureusement, peu de gens ont vu ce commentaire.
De plus, dans sa chronique parue en Novembre 2019, intitulée «Le poids des mots», Isabelle Hachey écrit : «Je comprends le poids des mots. Je comprends que les manchettes, les sujets, les angles abordés contribuent à former l'opinion publique. J'ai toutefois l'impression qu'on prête beaucoup (trop?) de pouvoir aux médias. Les journalistes ont la responsabilité de bien choisir leurs mots, certes... Évidemment, dans un monde où le cycle de la nouvelle est plus rapide que jamais, il arrive que les journalistes fassent des gaffes... Dans le tourbillon d'une salle de nouvelles, il s'en commet tous les jours.»
Rencontre du 1er type
Je me pinçais pour être certaine de ne pas rêver. Seule dans l’obscurité, allongée sur le divan neuf dans mon salon qui sentait la peinture fraiche, je songeais à ce qui me rendait particulièrement heureuse et optimiste en cette nuit de mai. J’avais un conjoint aimant et complice, j’exerçais une profession qui me comblait, j’avais deux beaux enfants en santé, j’étais bien entourée par ma parenté et mes amis. En prime, nous venions de déménager dans notre maison de rêve. Que pouvais-je espérer de plus?
Ce soir là, rien ne laissait présager que notre vie allait complètement basculer en moins de quelques heures.
Tout a commencé quelques jours plus tard, alors que je suis allée chercher mes enfants à la garderie. Préoccupée, la gardienne m’a informée que ma fille avait été amorphe pendant l’après-midi. «Elle n’a pas voulu jouer, elle a à peine mangé, elle ne voulait que dormir. En plus, elle a le nez qui coule.»
J’ai regardé ma petite Véronique qui, en effet, ne semblait pas dans son assiette. Je lui ai touché le front, mais elle n’était pas fiévreuse. «Je vais la surveiller de près. Elle couve probablement quelque chose» ai-je répondu.
À la maison, j’ai vérifié sa température à quelques reprises. Tout semblait normal. Si elle ne faisait pas de fièvre, il n’y avait pas trop raison de s’inquiéter, n’est-ce pas ? Elle paraissait enrhumée et se plaignait qu’elle avait soif. Je lui ai donné de grands verres d’eau, un repas léger et après un bon bain, je l’ai mise au lit. Je me disais qu'une bonne nuit de sommeil allait lui faire grand bien.
Pendant la nuit, Véronique s’est levée à quelques reprises pour aller à la toilette. «Les grands verres d’eau ont fait effet», me suis-je dit. Le lendemain matin, la petite était en forme, de bonne humeur et elle ne faisait toujours pas de fièvre. Elle a déjeuné et semblait tout-à-fait apte à aller à la garderie.
Pourtant, lorsque je suis retournée chercher les enfants en après-midi, la gardienne m’a mentionné que Véronique avait manqué d’énergie toute la journée, qu’elle avait de nouveau refusé de manger et qu’en plus, elle semblait constamment essoufflée. Je l’ai donc amenée à la clinique.
Le médecin lui a examiné la gorge, les oreilles, l’a auscultée, a même fait prendre une radiographie de ses poumons. Rien ne semblait clocher. Le docteur supposait qu’elle faisait peut-être une petite réaction allergique au pollen et à la poussière. C’était plausible puisque notre terrain ressemblait encore à un grand carré de sable parsemé de mauvaises herbes. Nous sommes donc parties avec une prescription pour un bronchodilatateur en main.
Loin de s’améliorer, au cours des heures qui ont suivi, l’état de Véronique s’est rapidement détérioré. Elle pouvait à peine se tenir debout. Tout ce qu’elle arrivait à faire, c’était de boire de l’eau et aller à la toilette. Puis, le soir, mon conjoint m’a fait remarquer que les lèvres et les mains de la petite étaient en train de bleuir.
«Elle manque d’oxygène !» me suis-je écriée. «Ce n’est pas normal.»
Sans perdre une minute, j’ai enfoncé une petite couverture, un pyjama, Coco le lapin en peluche, deux bouteilles d’eau et deux livres dans un sac à dos, et j’ai installé Véronique dans son siège d’auto. Direction : l’hôpital. Nous attendrions le temps qu’il faudrait pour voir un médecin, mais j’allais avoir le cœur net sur ce qui clochait avec ma fille. Pendant ce temps, mon conjoint allait rester à la maison avec fiston.
À l’urgence, nous avons à peine eu le temps de nous assoir qu’on a appelé Véronique au triage. L’infirmière qui nous a reçues m’a écoutée attentivement. Elle a commencé son examen puis a fait monter la petite sur un pèse-personne.
« Elle pèse 25 livres. C’est peu pour un enfant de son âge.»
-«Impossible!» m’écriai-je. «À son rendez-vous médical annuel il y a quelques mois, elle pesait 32 livres !».
À la clinique, la veille, le médecin avait tout vérifié, sauf son poids.
L’infirmière a immédiatement pris un petit appareil dans son tiroir.
«Viens ma belle, je vais te faire un «pic-pic» sur le doigt. On va vérifier quelque chose.»
Elle a piqué le bout du doigt de Véronique, a mis une goutte de sang sur une languette et a regardé l’appareil qui s’est mis à biper.
«Madame, je vais vous demander d’aller avec votre fille dans la salle numéro 5. Le médecin va passer vous voir dans quelques minutes.»
Inquiète au plus haut point, je me suis assise dans une petite salle, ma «pinotte» de trois ans sur mes genoux. Avec le nombre de personnes qui attendaient à l’urgence, si nous passions aussi rapidement de la salle d’attente au médecin, c’est que ma fille couvait certainement quelque chose de très grave. De quoi pouvait-il s’agir ? Méningite ? Fibrose kystique ? Malformation cardiaque ? Cancer ? J’essayais de garder mon calme, mais je sentais l’anxiété me serrer la gorge.
Au bout d’un moment qui m’a semblé une éternité, une jeune femme est entrée. Elle s’est présentée, mais je n’ai pas retenu son nom. C’était le médecin de garde. Elle m’a demandé ce qui s’était passé, m’a posé des questions sur l’état de Véronique. Puis doucement, elle m’a annoncé : «nous allons lui faire subir des tests, mais déjà, avec les symptômes qu’elle présente, nous sommes pratiquement certains que votre fille fait du diabète.»
Comme si elle m’avait raconté une mauvaise blague, je me suis mise à rire aux éclats. Était-ce une réaction nerveuse ou un signe de soulagement parce le médecin n’avait pas prononcé le vilain mot qui commence par un C?
« Mais voyons, Ça ne se peut pas ! Ni moi, ni mon conjoint sommes diabétiques. Et puis, regardez-la, elle est maigre comme un pic ! Le diabète, n’est-ce pas une maladie de personnes qui font de l’embonpoint ?»
-«Cela n’a rien avoir avec le diabète de type 1, Madame.»
J’étais en état de choc.
«Nous vous expliquerons tout si le diagnostic se confirme. Pour l’instant, nous allons prendre Véronique en charge. »
Je me suis sentie aspirée dans un tourbillon. Les infirmières s’affairaient autour de ma fille qui me regardait d’un air affolé. Je lui faisais des sourires et des clins d’œil pour la rassurer, mais tout ce que je voulais faire, c’était de pleurer.
Le résultat des analyses est revenu et on m’a confirmé qu’il s’agissait bien du diabète,que Véronique était en acidocétose – un mot que nous apprendrions à connaitre – et qu’on devait la mettre sous perfusion. Le problème, c’est qu’elle était déshydratée et, par conséquent, il serait difficile de lui trouver une veine. On m’a demandé de me coucher sur ma fille et de la tenir bien en place. «Elle ne doit absolument pas bouger». Pendant vingt minutes, trois infirmières lui ont farfouillé les mains et les bras avec une aiguille. Véronique n’a pas bronché, mais de grosses larmes mouillaient ses joues. Pendant ce temps, je l’ai serrée contre moi, je lui ai parlé tout doucement, lui ai répété à quel point elle était courageuse et gentille.
Un autre médecin m’a expliqué qu’elle serait surveillée étroitement pendant les douze prochaines heures, et qu’elle serait hospitalisée pendant quelques jours. «Vous nous l’avez amenée juste au bon moment», me dit-il. «Les valeurs normales de glycémie se situent entre 4 et 7. La sienne était à 54. C’est un miracle qu’elle ne soit pas dans le coma. »
Comme une automate, je suis allée régler le dossier de Véronique aux admissions, puis j’ai appelé mon conjoint pour le mettre au courant. J’étais épuisée, mais j’ai retenu mes sanglots en tentant de lui raconter ce qui se passait. Au téléphone, il me posait mille questions auxquelles je n’avais pas de réponse. Nous étions tous les deux bouleversés, sans trop comprendre ce que serait la suite.
Lorsque je suis revenue auprès de ma fille, elle dormait. J’ai enfin pleuré. Sans son regard posé sur moi, je pouvais arrêter d’être forte. Je me sentais à la fois impuissante, coupable, confuse et surtout, j’avais peur. Je ne savais à peu près rien du diabète. Tout ce que je réussissais à me rappeler, c’était que les diabétiques pouvaient devenir aveugles et se faire amputer. Était-ce le sort qui attendait ma pauvre petite ?
On a installé Véronique dans une chambre. Pendant toute la nuit, aux quinze minutes, une équipe est venue prendre ses signes vitaux et vérifier sa glycémie. On m’a installé un lit de fortune pour que je puisse m'allonger, mais j’ai été incapable de fermer l’œil.
Au petit matin, j’ai rencontré son médecin traitant, de la clinique du diabète. Il m’a annoncé que ma fille était hors de danger. Il a pris le temps de s’assoir avec moi et de m’expliquer : le diabète de type 1 apparait toujours de façon brutale pendant l’enfance. Pour l’instant, on n’en connaissait pas la cause. La majorité des enfants diabétiques n’avaient pas d’antécédents familiaux. Contrairement au diabète de type 2, il n’est pas lié à un surpoids ou la sédentarité. Pour une raison inconnue, le système immunitaire de Véronique avait détruit les cellules du pancréas qui produisent l’insuline. Il n’y avait pas de cure. Elle allait devoir recevoir des injections d’insuline tous les jours, pendant toute sa vie.
«Et qu’est-ce que nous aurions dû faire pour que cela n’arrive pas ?» ai-je demandé
Il a soupiré.
«Rien, absolument rien. C’était écrit dans son ciel.»
Au cours des jours suivants, nous avons eu un cours en accéléré sur le diabète. Outre l’infirmière et le médecin, nous avons rencontré une nutritionniste et une travailleuse sociale. Puisque notre fille n’avait que trois ans, nous allions devoir gérer son diabète. Nous nous sommes familiarisés avec un nouveau vocabulaire, nous avons choisi un glucomètre, nous avons appris à vérifier la glycémie, à préparer et à administrer les injections d’insuline, à lire les étiquettes sur les produits alimentaires et calculer les glucides dans un repas, à reconnaitre les signes d’hypo et hyperglycémie. Nous devions rapidement nous adapter à une nouvelle réalité. La vie de notre fille en dépendait.
Au bout de cinq jours, Véronique a eu son congé et nous sommes retournés à la maison. La vie reprenait son cours, mais différemment.
Au fil des années qui ont suivi, il y a eu d’autres formations, des rendez-vous à la clinique du diabète quatre fois par année, de nombreuses prises de sang, d’autres hospitalisations, des ajustements constants de doses d’insuline, de nouveaux médecins. Le pharmacien du coin est devenu notre meilleur ami. Il a fallu expliquer, rassurer et former l’entourage de notre fille : la parenté, la gardienne, puis plus tard, le personnel de son école, ses camarades et leurs parents. Bien sûr, en vieillissant, Véronique a graduellement pris en charge ses vérifications de glycémie, ses injections et son alimentation. Il y a eu du déni, des inquiétudes, des frustrations, des préjugés à combattre et de nombreux défis à relever. Mais en dépit de tout cela – ou grâce à tout cela - Véronique a eu une enfance «normale».
Ma belle Véronique vit avec cette maladie chronique depuis qu’elle a l’âge de trois ans. On ne connait pas la cause du diabète de type 1 et il n’y a toujours pas de cure. Un jour, peut-être. La science fait de grands pas et déjà le traitement de la maladie a beaucoup évolué. Mais j’admire le courage, la discipline, la maturité, la détermination et surtout la résilience de ma fille, ainsi que de tous ces magnifiques enfants qui font du diabète. Je salue leurs familles aussi. Parce que leur vie a changé le jour où le diagnostic est tombé.
C’était écrit dans leur ciel.